 |
Nouvelle série, n°1
1er trimestre 2018 |
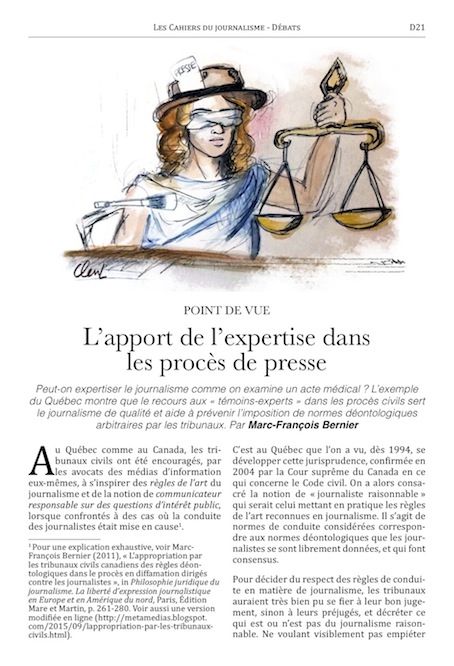 |
|
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER |
TÉLÉCHARGER |
||
POINT DE VUE
L’apport de l’expertise
dans les procès de presse
Peut-on expertiser le journalisme comme on examine un acte médical ? L’exemple
du Québec montre que le recours aux « témoins-experts » dans les procès civils sert
le journalisme de qualité et aide à prévenir l’imposition de normes déontologiques
arbitraires par les tribunaux.
Par Marc-François Bernier

Au Québec comme au Canada, les tribunaux civils ont été encouragés, par les avocats des médias d’information eux-mêmes, à s’inspirer des règles de l’art du journalisme et de la notion de communicateur responsable sur des questions d’intérêt public, lorsque confrontés à des cas où la conduite des journalistes était mise en cause1.
C’est au Québec que l’on a vu, dès 1994, se développer cette jurisprudence, confirmée en 2004 par la Cour suprême du Canada en ce qui concerne le Code civil. On a alors consacré la notion de « journaliste raisonnable » qui serait celui mettant en pratique les règles de l’art reconnues en journalisme. Il s’agit de normes de conduite considérées correspondre aux normes déontologiques que les journalistes se sont librement données, et qui font consensus.
Pour décider du respect des règles de conduite en matière de journalisme, les tribunaux auraient très bien pu se fier à leur bon jugement, sinon à leurs préjugés, et décréter ce qui est ou n’est pas du journalisme raisonnable. Ne voulant visiblement pas empiéter sur la liberté des journalistes, ils ont décidé d’assimiler ces derniers à des professionnels, au même titre que des médecins ou des avocats. Ils utilisent ainsi pour les journalistes le même test que pour les autres professionnels, c’est-à-dire le respect des règles de conduite qui s’appliquent dans les circonstances.
Dans la décision Néron c. Radio-Canada (2004), la Cour suprême du Canada a clairement exprimé que, pour évaluer la faute des journalistes, il « faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte2 ». Je soumets que la teneur du reportage fait référence à son contenu : vérité, rigueur du raisonnement, exactitude des affirmations, intérêt public des informations, etc. La méthodologie renvoie aux moyens utilisés par les journalistes : équité (procédurale) des méthodes tels les procédés clandestins ou les entrevues d’embuscade, l’équité dans la sélection des informations, incluant les omissions, le sensationnalisme, l’équilibre, le recours aux sources anonymes, le devoir de suite, etc. Le contexte fait référence aux motivations : l’intégrité journalistique, l’honnêteté intellectuelle et, surtout, la question des conflits d’intérêts.
Démarche journalistique
On constate que les tribunaux insistent sur la démarche journalistique. On parle ici d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultats, car on reconnait que les journalistes ont le droit à l’erreur de bonne foi, qui ne résulte pas de l’insouciance, de la négligence ou de la malice. Le plus haut tribunal estime ainsi avoir trouvé un équilibre entre la liberté de la presse et ses obligations eu égard aux droits des citoyens, ce que je désigne comme la liberté responsable de la presse dans une société démocratique. Cette expression revient d’ailleurs chez différents auteurs3 et s’inscrit dans le paradigme dominant de la responsabilité sociale de la presse de la célèbre Commission Hutchins (1948).
Cette jurisprudence résulte de litiges portés devant les tribunaux par des individus et des entreprises qui cherchaient à faire réparer des dommages causés, selon eux, par la diffusion d’articles et de reportages fautifs les concernant. Pour défendre leurs clients, les avocats des médias ont demandé qu’on ne se limite pas à la véracité des propos diffusés (obligation de résultats), mais à la qualité de la démarche journalistique (obligation de moyens). Implicitement et explicitement, cela renvoie à un ensemble de règles de conduite professionnelle énoncées dans des textes normatifs, ou inspirées de la tradition et de la pratique quand les textes sont silencieux.
Dans les provinces canadiennes où la Common Law est en vigueur, deux causes4 ont conduit la même Cour suprême du Canada à invoquer, en décembre 2009, une notion différente dans les termes, mais similaire sur le fond, soit la notion de communicateur responsable concernant des questions d’intérêt public. Cette notion importée de la jurisprudence anglo-saxonne internationale mobilise les normes déontologiques reconnues en journalisme.
La Cour suprême a mis de l’avant deux principes. Premièrement, pour pouvoir tirer profit de ce nouveau moyen de défense, il faut, comme l’indique son nom, que la communication porte sur une question d’intérêt public. Pour le tribunal, l’intérêt public concerne le contenu ou la substance de la communication dans son ensemble. L’intérêt public n’est pas l’intérêt du public (la curiosité publique) précise le plus haut tribunal. Par ailleurs, « il suffit qu’un segment de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information s’y rapportant ». Sans prétendre à l’exhaustivité, les juges considèrent que le public : « ... a véritablement intérêt à être au courant d’un grand éventail de sujets concernant tout autant la science et les arts que l’environnement, la religion et la moralité. L’intérêt démocratique pour que se tiennent des débats publics sur une gamme de sujets de cette ampleur doit se traduire dans la jurisprudence5 ».
Le deuxième principe veut que le défendeur (le média, le journaliste, mais aussi d’autres communicateurs éventuellement) soit en mesure de démontrer que la communication était responsable. Cela passe notamment par une démarche de vérification des allégations qui seront diffusées au public. Pour les juges canadiens, la liberté de presse « n’évacue pas la responsabilité. Il est capital que les médias se conduisent de façon responsable lorsqu’ils couvrent des faits concernant des questions d’intérêt public et qu’ils se conforment aux normes les plus exigeantes du journalisme6 ». D’autres critères seront aussi examinés, qui renvoient à une démarche journalistique exigeante et équitable (rigueur, exactitude, crédibilité des sources, gravité des allégations, etc.)
Il y a lieu ici de rappeler que la défense de communicateur responsable sur des questions d’intérêt public est arrivée au Canada par l’intermédiaire de la jurisprudence anglo-saxonne des pays du Commonwealth7. On pourrait spéculer sur les probabilités qu’elle puisse éventuellement influencer la Cour européenne des droits de l’homme et, par le fait même, avoir un impact sur les médias et les journalistes de pays francophones, comme la France ou la Belgique.
Une protection du journalisme de qualité
Pour s’instruire des règles reconnues en journalisme, le tribunal peut puiser lui-même dans des textes déontologiques, voire dans les décisions de dispositifs d’autorégulation (conseils de presse, ombudsman) ou de corégulation (Conseil canadien des normes de la radiotélévision par exemple). Le cas échéant, il prendra connaissance des rapports de témoins experts que les parties auront déposés avant l’audition.
Le témoin expert a un rôle très particulier et il doit en tout premier lieu être reconnu comme expert dans chaque procès où il est convoqué (sur la base de son expérience, de ses diplômes, de ses publications et du contenu de son rapport). Il arrive même que le tribunal lui refuse cette qualification. Il intervient comme un témoin d’opinion et non de faits. Son évaluation, nécessairement normative, doit idéalement se fonder sur les normes reconnues, l’expérience professionnelle et la connaissance de la recherche scientifique pertinente. Il doit l’expliquer et la justifier dans le cadre d’interrogatoires et de contre-interrogatoires, lors du procès. Il ne lui revient pas de décréter s’il y a eu faute ou non, il ne fait qu’émettre son opinion, ses conclusions ou ses constats selon les faits propres à chaque cause. Pour élaborer son opinion, il peut se limiter à sa connaissance personnelle, voire impressionniste, des règles déontologiques, au risque de voir son opinion être réfutée ou rejetée par le tribunal. Il peut aussi, et il devrait même, comparer les comportements des journalistes mis en cause avec les normes reconnues, cela d’autant plus qu’il possède une documentation exhaustive de chaque cas.
Les normes mobilisées dans un tel exercice se retrouvent dans des textes déontologiques (Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, Guide de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec), sans compter les textes normatifs propres à chaque média, le cas échéant, et d’autres sources canadiennes ou internationales au besoin. À cela s’ajoute sa connaissance du milieu journalistique, par le biais de la recherche scientifique et d’une expérience professionnelle.
Le témoin expert n’est pas là pour condamner ou défendre les journalistes. Son rôle est d’instruire le juge avec précision, rigueur et intégrité et ce dernier décide s’il rejette ou retient les opinions exprimées, en tout ou en partie. Il ne faut donc pas se vexer d’un rejet de la part du juge.
Rares procès
Au Canada comme au Québec, la contribution du témoin expert se fait principalement dans le cadre de litiges liés à la diffamation,8 qui conduisent rarement à des procès, pour différentes raisons.
La première est sans doute la qualité de la grande majorité des productions journalistiques, surtout au sein de médias qui disposent de salles de rédaction bien garnies en termes de journalistes d’expérience, possédant une formation universitaire pertinente et entourés de personnes compétentes.
La seconde raison est l’existence de dispositifs tels les conseils de presse ou un ombudsman, lorsqu’il y a des motifs de critiquer certaines pratiques journalistiques. Ils agissent tantôt comme médiateurs entre l’entreprise de presse et les citoyens qui ont des griefs à exprimer, tantôt comme instance de décision pour se prononcer sur lesdites pratiques. Ces dispositifs sont gratuits pour les plaignants et leurs sanctions ne sont que morales. Ils captent un certain nombre de plaintes qui, autrement, pourraient se rendre devant les tribunaux.
La troisième est qu’il faut être particulièrement déterminé à restaurer sa réputation et bien nanti pour se prévaloir d’un recours devant les tribunaux civils. Les poursuites civiles entraînent des coûts très élevés, de plusieurs dizaines de milliers de dollars minimalement, pour défrayer les honoraires des avocats et des experts, mais aussi les transcriptions d’interrogatoires hors cour, ou divers frais administratifs. De plus, il n’est pas rare que de telles poursuites prennent plusieurs années avant d’être tranchées par un juge. Cela explique que bon nombre se règlent à l’amiable, avant le procès.
La quatrième raison est que, même lorsque le tribunal leur donne raison, les citoyens lésés par des pratiques journalistiques se voient accorder des dédommagements qui ne couvrent pas les dommages matériels et moraux qu’ils ont subis, ni les honoraires qu’ils ont dû payer pour se rendre au bout du processus. Et ils risquent fort de devoir poursuivre leurs coûteuses démarches devant des tribunaux d’appel. Cela décourage bien des justiciables.
Ces obstacles protègent les médias et leurs journalistes de poursuites, les sérieuses comme les frivoles, sauf exception. Cela explique vraisemblablement que dans le cadre de diverses enquêtes scientifiques, les journalistes soucieux de préserver leurs liberté et autonomie professionnelles s’inquiètent davantage des contraintes provenant de leur propre média, des pressions des sources et des annonceurs, que de poursuites civiles peu probables.
20 ans d’expertise

On l’a vu, l’importance croissante du témoin expert en journalisme est une conséquence des stratégies de défense mises de l’avant par les avocats représentant les médias. En obtenant de faire reconnaître le droit à l’erreur des journalistes, ils ont obligé les juges à examiner la qualité de la démarche journalistique.
Depuis 1997, je suis sollicité afin de témoigner dans des dossiers mettant en cause les pratiques journalistiques, sur la base d’une expérience professionnelle alors longue de presque 20 ans, ainsi que de recherches et publications en éthique et déontologie du journalisme.
L’expert en journalisme doit agir sans complaisance corporatiste ni hostilité idéologique, ce qui ne le prive pas d’émettre des jugements critiques qui déplaisent ou nuisent inévitablement à une des parties. Bien entendu, ses services sont sollicités et retenus sur la base de ses convictions et connaissances, lesquelles ne doivent pas se conformer aux désirs de la partie qui retient ses services.
Il arrive de dire à un client potentiel qu’il n’a aucune chance de convaincre un juge que tel journaliste n’a pas respecté ses obligations, et qu’il vaut mieux laisser tomber. En d’autres circonstances, il faudra éduquer un éventuel plaignant sur les normes reconnues en journalisme, si bien que celui-ci abandonnera ses velléités de poursuite civile pour se tourner vers le Conseil de presse du Québec ou l’ombudsman de Radio-Canada, voire un spécialiste des relations publiques pour faire valoir son point de vue sur la place publique.
Si les mandats d’expertise demeurent rares – quelques-uns par année seulement – ils sont le plus souvent utiles pour que les parties en arrivent à une entente à l’amiable. En réalité, les couteux procès sont presque l’exception.
Bien que certaines décisions des tribunaux puissent avoir mauvaise presse, surtout quand on s’active à en exagérer la portée réelle pour alimenter des craintes non fondées, il y a lieu de croire que celles qui se fondent sur les règles de l’art contribuent à améliorer la qualité du journalisme. Si elles peuvent impacter négativement les intérêts particuliers des entreprises de presse et de certains journalistes, elles contribuent indéniablement au droit du public à un information de qualité, rigoureuse, équitable et intègre. Elles peuvent refroidir les salles de rédaction qui s’emballent parfois, sans inhiber nécessairement le journalisme de qualité. L’intérêt public est alors bien servi.
Ces décisions protègent également les journalistes, qui sont des employés dont l’autonomie professionnelle est limitée par des injonctions patronales. Ils peuvent ainsi contester, avec des chances de succès variables, les demandes abusives de certains responsables de médias. Le fait que des transgressions à la déontologie puissent conduire à des procédures judiciaires coûteuses a de quoi freiner de telles demandes.
D’une certaine façon, les médias n’échappent pas aux exigences de plus en plus élevées de la société face à ceux et celles qui prétendent travailler pour l’intérêt public : parlements, professions, institutions d’enseignement, corps policiers, spécialistes de la santé, etc.
Je doute qu’il soit possible, et même souhaitable, pour les médias et leurs journalistes d’échapper à ce phénomène. Il est une incitation à la qualité, à l’excellence et à la bonne gouvernance que les médias eux-mêmes exigent des autres acteurs sociaux. On peut même soutenir que l’intérêt public est mieux servi quand les journalistes sont encouragés à respecter la déontologie qu’ils se sont librement donnée depuis plus d’un siècle.
Quand ils assument la liberté responsable de la presse.
Marc-François Bernier est professeur
à l’Université d’Ottawa.
1
Pour une explication exhaustive, voir Marc-François Bernier (2011), « L’appropriation par les tribunaux civils canadiens des règles déontologiques dans le procès en diffamation dirigés contre les journalistes », in Philosophie juridique du journalisme. La liberté d’expression journalistique en Europe et en Amérique du nord, Paris, Édition Mare et Martin, p. 261-280. Voir aussi une version modifiée en ligne (http://metamedias.blogspot.com/2015/09/lappropriation-par-les-tribunaux-civils.html).
2
Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron, (2004, CSC 53), au paragraphe 59 de la décision. J’ai été le témoin expert de Néron dans cette cause devenue historique.
3
John C. Merill (1989), The dialectic in journalism: Toward a responsible use of press freedom, Baton Rouge. LA: Louisiana State University Press, Clement Assante (1997), Press Freedom and Development: A Research Guide and Selected Bibliography, Westport Greenwood Publishing Group, ou encore Jacek Sobczak et Jedrez Skrzypczak (eds) (2015), Professionalism in Journalism in the Era of New Media, « Catalysts for professionalization of journalists », p. 27-37.
4
Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640 et Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712.
5
Voir Grant c. Torstar Corp.
6
Op. Cit.
7
Kenyon, Andrew. T. et Marjoribanks, Tim (2008), « The future of “responsible journalism” Defamation law, public debate and news production », Journalism Practice, 2(3), 372-385.
8
On retrouve aussi parfois le témoin expert dans le cadre de griefs entre employeur et syndicat de journalistes, quand cela porte sur des questions professionnelles.
Référence de publication (ISO 690) : BERNIER, Marc-François. L'apport de l'expertise dans les procès de presse. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2018, vol. 2, no 1, p. D21-D26.
DOI:10.31188/CaJsm.2(1).2018.D019






