 |
Nouvelle série, n°10 2nd semestre 2023 |
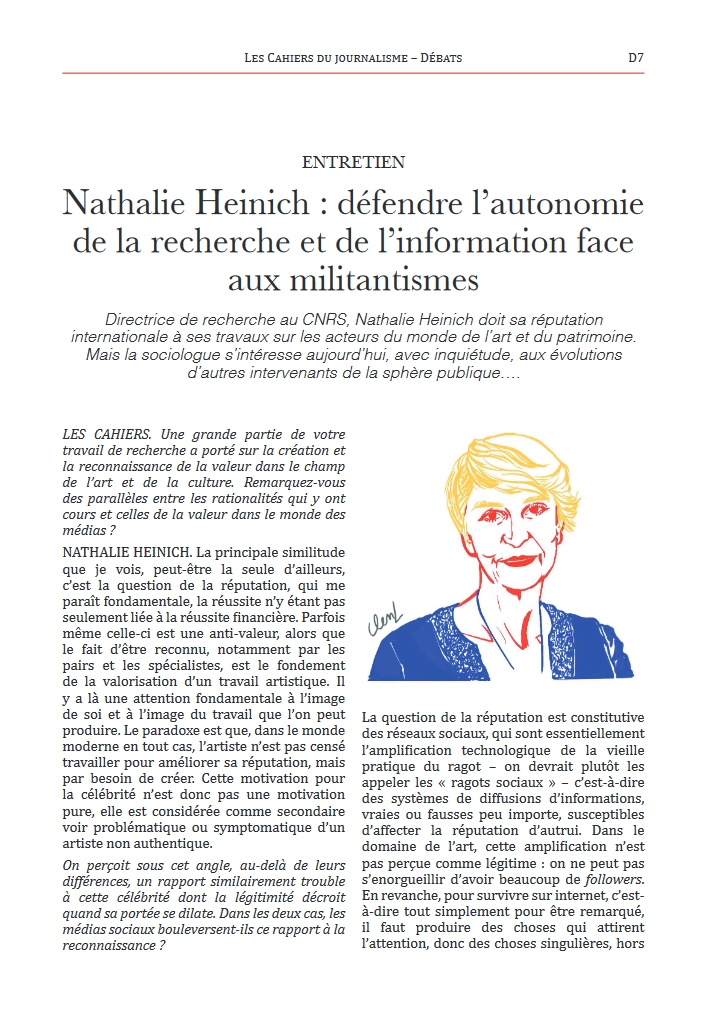 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
ENTRETIEN
Nathalie Heinich : défendre l’autonomie de la recherche et de l’information face aux militantismes
Directrice de recherche au CNRS, Nathalie Heinich doit sa réputation internationale à ses travaux sur les acteurs du monde de l’art et du patrimoine. Mais la sociologue s’intéresse aujourd’hui, avec inquiétude, aux évolutions d’autres intervenants de la sphère publique…

LES CAHIERS – Une grande partie de votre travail de recherche a porté sur la création et la reconnaissance de la valeur dans le champ de l’art et de la culture. Remarquez-vous des parallèles entre les rationalités qui y ont cours et celles de la valeur dans le monde des médias ?
NATHALIE HEINICH – La principale similitude que je vois, peut-être la seule d’ailleurs, c’est la question de la réputation, qui me paraît fondamentale, la réussite n’y étant pas seulement liée à la réussite financière. Parfois même celle-ci est une anti-valeur, alors que le fait d’être reconnu, notamment par les pairs et les spécialistes, est le fondement de la valorisation d’un travail artistique. Il y a là une attention fondamentale à l’image de soi et à l’image du travail que l’on peut produire. Le paradoxe est que, dans le monde moderne en tout cas, l’artiste n’est pas censé travailler pour améliorer sa réputation, mais par besoin de créer. Cette motivation pour la célébrité n’est donc pas une motivation pure, elle est considérée comme secondaire voir problématique ou symptomatique d’un artiste non authentique.
On perçoit sous cet angle, au-delà de leurs différences, un rapport similairement trouble à cette célébrité dont la légitimité décroit quand sa portée se dilate. Dans les deux cas, les médias sociaux bouleversent-ils ce rapport à la reconnaissance ?
La question de la réputation est constitutive des réseaux sociaux, qui sont essentiellement l’amplification technologique de la vieille pratique du ragot – on devrait plutôt les appeler les « ragots sociaux » – c’est-à-dire des systèmes de diffusions d’informations, vraies ou fausses peu importe, susceptibles d’affecter la réputation d’autrui. Dans le domaine de l’art, cette amplification n’est pas perçue comme légitime : on ne peut pas s’enorgueillir d’avoir beaucoup de followers. En revanche, pour survivre sur internet, c’est-à-dire tout simplement pour être remarqué, il faut produire des choses qui attirent l’attention, donc des choses singulières, hors du commun, bizarres, originales, y compris par la nudité, la sexualité, enfin tout ce qui permet de marquer une forme de transgression.
Vous parlez là des médias sociaux, mais ce point ne s’applique-t-il pas tout autant à la création artistique contemporaine, domaine où s’efforcer de choquer en transgressant les codes sociaux a presque tourné au cliché ?
C’est vrai, les deux peuvent avoir cette caractéristique en commun. Pour pouvoir émerger, il faut montrer que l’on fait quelque chose qui n’a pas été fait exactement à l’identique, que l’on renouvelle quelque chose. Mais il y a un élément d’élitisme qui est très fort dans l’art contemporain : ce qu’on fait n’est pas forcément accessible au grand public. Ce n’est pas le cas dans la création de contenus sur internet qui vise au contraire à avoir le maximum de public et doit donc faire appel à des formes relativement éprouvées qui finalement, derrière l’ostentation de recherche d’originalité, renvoient quand même à un répertoire assez standardisé.
L’influence des journalistes est relativement peu perceptible dans vos travaux sur la reconnaissance artistique. Est-ce parce qu’elle y est plus faible qu’on ne pourrait le croire ?
Les journalistes font partie des instances qui concourent à la visibilité d’une proposition artistique, mais dans le cas des arts plastiques ils arrivent plutôt à la fin des processus de reconnaissance, qui impliquent d’abord les pairs, ainsi que les galeristes et les collectionneurs (c’est-à-dire le marché), et les commissaires d’expositions et les conservateurs. C’est via les médias que le grand public a accès à la connaissance du processus, mais à un moment où les choses sont déjà établies.
Voilà qui est assez différent de secteurs moins déroutants du journalisme culturel comme le cinéma, le livre ou la musique : serait-ce qu’en l’espèce les journalistes spécialisés ont besoin, un peu comme les journalistes scientifiques, de la validation préalable des experts du domaine ?
Ils ne se retrouvent pas tout d’un coup face à une œuvre d’art décontextualisée, elle a été précadrée par le travail des intermédiaires publics et privés, qui vont permettre à des journalistes arrivant dans une galerie ou une exposition de savoir que l’artiste dont il est question a été reconnu par les spécialistes. C’est à partir de là que le journaliste choisira d’évoquer ou non tel ou tel créateur et d’en parler sous un angle ou un autre.
Si vous donniez une conférence dans une école de journalisme, quels sont les plus utiles enseignements que vous retireriez pour eux de vos décennies de travail sur la notoriété et la visibilité dans la sphère de la création en général ?
Je n’aurais pas envie de leur parler d’art parce que ce n’est pas forcément le plus important pour eux. Je leur parlerais avant tout de l’importance de se différencier et de différencier les informations qu’ils produisent de celles qui circulent sur les réseaux sociaux. Je pense que c’est vraiment un enjeu fondamental aujourd’hui : il est essentiel de mieux faire comprendre au public la différence entre ce qu’il peut attendre de médias professionnels, faits par des journalistes professionnels, ou de revues scientifiques rédigées par des scientifiques, et le genre de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un travail pédagogique à faire pour expliquer aux jeunes, notamment, qu’un journaliste professionnel est soumis à de fortes contraintes déontologiques pour que ce qu’il publie puisse être considéré comme valable par ses pairs. Les contraintes d’un chercheur pour publier un texte sont encore plus grandes. Or je pense que les jeunes n’en sont pas conscients et donc qu’ils ne peuvent faire la différence.
Plusieurs recherches ont en effet démontré le niveau effarant de cette confusion. Une foule de programmes d’éducation aux médias plus ou moins inspirés se proposent d’ailleurs de la réduire, mais il semble bien difficile d’échapper dans ce cadre à l’une ou l’autre des fictions qui s’affrontent en la matière, une vision hypercritique à la Chomsky ou à l’inverse l’idéalisation de principes journalistiques qui sont moins respectés que vous ne semblez le suggérer…
Vous voulez dire que dans les écoles de journalisme, par exemple, on n’enseigne plus la différence entre un éditorial et un reportage, ou entre une opinion et un fait ? Si les journalistes veulent continuer à être payés pour faire du journalisme, il faut qu’ils fassent autre chose que ce qui circule sur les réseaux sociaux. L’idéalisation reviendrait à croire que les pratiques réelles sont conformes aux principes que j’évoquais, et qui relèvent de la déontologie. Or la déontologie se situe sur le plan des valeurs, qui sont la visée collectivement reconnue par une profession. La réalité des pratiques peut être plus ou moins conforme, mais il est essentiel d’apprendre à distinguer entre ce que les journalistes sont censés faire et ce que font les influenceurs en ligne.
Mais si l’on explique par exemple qu’un journaliste doit être impartial alors que ce point est contesté par certains d’entre eux, ça ne facilitera pas forcément la compréhension du public…
Il ne s’agit pas de prétendre que les journalistes sont objectifs, mais qu’il y a une distinction nette à observer entre les domaines où ils se doivent d’être objectifs et les domaines où ils peuvent s’autoriser une marge d’opinion personnelle, c’est très différent. Les journalistes ont parfaitement accès à l’expression de leur opinion, sous certaines contraintes : c’était l’objet d’une enquête que j’avais faite il y a près de quarante ans. Ce qui m’intéressait, c’était le contraste entre une déontologie qui valorise l’objectivité, d’un côté, et de l’autre le fait que les journalistes prestigieux sont ceux qui donnent leur opinion, c’est-à-dire ceux qui font des éditoriaux.
Ou a fortiori ceux des grands reporters qui ont conquis le droit au « je »…
Ainsi que les grands reporters, je les incluais en effet. Je trouvais intéressant de mettre en évidence la coexistence de deux modes de valorisation du travail de journaliste : un type de valeur qui passe par la mise entre parenthèses du sujet, de la subjectivité, et un autre qui passe au contraire par l’ostentation de la subjectivité. Mon idée n’était pas de rabattre l’un sur l’autre mais justement d’expliciter ce système de valeurs contradictoires qui cohabitent dans le monde du journalisme. En revanche, si les journalistes mélangent les deux, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis car ils se privent de la possibilité de faire la différence avec l’opinion du premier crétin venu sur les médias sociaux. Dire « moi je pense que », c’est ce qu’il y a de moins intéressant dans une économie de l’attention où l’on est déjà saturé d’opinions. Ça ne nous donne pas accès à la réalité des choses, ça nous donne simplement accès au point de vue de quelqu’un qui n’a souvent pas de compétence particulière.
N’y a-t-il pas tout de même un solide marché pour tous ceux qui expriment ce que d’autres ont envie d’entendre, dans la sphère des médias mais aussi dans celle de la recherche où vous vous opposez vivement à cette tendance ?
N’exagérons pas leur audience, même si celle-ci se rend la plus visible possible. Ces « académo-militants », comme je les ai nommés, ont surtout du succès auprès du petit cercle des gens qui pensent comme eux, c’est-à-dire qui estiment qu’il n’y a pas de savoir objectif, que tout doit être déconstruit, que le vécu individuel et subjectif est infiniment supérieur à toute connaissance méthodique et que donner son opinion est le nec plus ultra du travail d’un universitaire. C’est à mon avis un dévoiement total de la profession de chercheur et d’enseignant. Mais ils seront oubliés d’ici quelques décennies, alors que les travaux sérieux laisseront une empreinte bien plus durable.
Pourtant un Derrida – puisque vous parliez de déconstruction – est toujours abondamment cité 50 ans plus tard. Bien moins par les profs que par les doctorants, certes, mais la sorte de « main invisible du marché » que vous semblez invoquer ne paraît pas fonctionner non plus pour le marché des idées…
La main invisible du marché n’a rien à voir ici : il s’agit d’un concept métaphysique.
Ça me semblait plutôt un argument d’ordre utilitaire, non ?
Les deux ne sont pas antithétiques puisque c’est l’idée qu’une sorte de divinité utilitariste gouvernerait le monde économique, soit deux erreurs de raisonnement majeures : par la métaphysique, et par l’utilitarisme, c’est-à-dire la réduction des intérêts humains à l’utilité matérielle. Quand je pense que certains continuent à y croire… Mais ce que j’évoquais est très différent. C’est le fait que les productions culturelles ou scientifiques existent dans un espace des possibles où elles sont jugées par des gens qui ont les moyens d’en évaluer la qualité, soit parce que ce sont eux-mêmes des producteurs, soit parce que ce sont des spécialistes, et que ces gens-là font peu à peu le ménage entre ce qui est original et ce qui ne l’est pas, ce qui tient la route et ce qui ne tient pas, ce qui est intéressant et ce qui ne l’est pas. Donc il ne s’agit pas du tout de la « main invisible » c’est une main extrêmement visible pour peu qu’on la regarde.
Et c’est donc à ce ménage que vous donnez vous-même la main, et de façon de plus en plus visible, face aux sensibilités militantes qui s’accentuent au sein des sciences humaines et sociales ?
L’Université est en effet confrontée à un débordement de médiocres travaux à la mode portés par les adeptes actuels du féminisme radical, de l’intersectionnalité, du décolonialisme et d’autres fariboles militantes : il est essentiel de préserver l’autonomie du savoir et la vraie recherche face aux productions de très faible qualité scientifique de ce qu’on appelle le « wokisme ».
Justement, est-il bien judicieux d’employer cette étiquette englobante dont, aux États-Unis, les franges les plus conservatrices du parti républicain font un usage passionné ?
Quand le mot « wokisme » est arrivé en France, il était évidemment marqué par cette connotation d’extrême droite, et l’un des problèmes, maintenant, c’est d’expliquer qu’il n’y a pas seulement derrière ce mot une levée de boucliers ultraconservateurs mais aussi des réalités extrêmement problématiques, qu’il est légitime de critiquer au nom d’authentiques valeurs de gauche. Le wokisme renvoie a un mode de pensée très précis que l’on retrouve à la fois dans le neoféminisme, dans le décolonialisme ou l’intersectionnalité : ils ont en commun des caractères bien marqués qui font qu’il est parfaitement légitime de les subsumer sous un même terme – je l’ai montré dans Le wokisme serait-il un totalitarisme ?1 Alors, est-ce qu’il faut trouver un terme X qui soit autre que « wokisme » au motif que le mot est utilisé par l’extrême droite américaine, je n’en sais rien. Ce serait bien, mais aucun ne désigne mieux ce dont on parle, donc…
Vous en parlez de façon argumentée sur le fond mais plutôt cinglante sur la forme. De telles prises de position n’entrent-elles pas en contradiction avec ce que vous écriviez par ailleurs : « [C]e n’est pas s’engageant dans les controverses que le sociologue peut en éclairer les tenants et les aboutissants2 » ?
Non, car mes prises de position contre le wokisme et l’académo-militantisme s’inscrivent dans des supports de publication qui n’ont rien à voir avec la recherche, et c’est toute la différence. Ce que certains ne veulent pas comprendre, c’est la notion fondamentale de séparation des arènes. C’est-à-dire la distinction essentielle entre, d’un côté, l’arène scientifique, avec tous les supports de recherche, et de l’autre l’arène de l’intervention politique ou civique, avec les essais, les tribunes, etc. Les journalistes, eux, n’ont qu’une arène, mais elle comprend des espaces d’expression différents, par exemple les différentes rubriques dans les journaux, ce qui donne les moyens de se repérer. Dans la recherche, ces espaces sont censés être totalement séparés. Ce que je soutiens, c’est qu’un intellectuel a parfaitement le droit de prendre des positions dans l’espace public à condition que dans son travail de chercheur il n’introduise pas des biais liés à ces positions. Quant au style, il est vrai que quand je suis mue par l’indignation, j’ai tendance à écrire de façon assez incisive. Je ne sais pas m’investir dans ce type d’écrits d’intervention sans y mettre une forme d’affect qui se sent dans mon écriture, peut-être quelquefois de façon un peu trop tranchante pour l’efficacité de l’expression.
Cependant, puisque cette séparation de l’arène savante est largement transgressée – comme d’ailleurs celle des faits et des commentaires journalistiques – on peut s’interroger sur sa survie à terme…
Il y a toujours beaucoup de bons chercheurs pour la maintenir, et même s’ils sont moins visibles dans l’espace public leur travail est bien plus durable. La confusion dans le système de la recherche provient largement du fourmillement des petites revues en ligne qui est un effet pervers des nouvelles technologies. Ces microrevues se réclament de l’évaluation par les pairs, mais elles fonctionnent en cercles clos avec des évaluations de complaisance qui favorisent la publication de choses qui ne tiennent pas debout. La profusion des studies, basées sur des objets de recherche et non pas sur des disciplines, va dans le même sens. Ces environnements attirent des gens qui sont mus non pas par la volonté de savoir mais par le souci de démontrer qu’ils ont raison de penser ce qu’ils pensent.

Photo : B. L. - CdJ
Les approches interdisciplinaires centrées sur des objets ne peuvent-elles apporter un éclairage spécifique pertinent ? Je pense évidemment à ma propre famille, les sciences de la communication et notamment à ce que les anglophones appellent les media studies, mais on pourrait aussi bien mentionner les sciences de l’éducation, voire les sciences de la santé…
On peut certainement bénéficier des approches interdisciplinaires, mais les grandes disciplines forment une architecture intellectuelle importante parce qu’elles fournissent des cadres conceptuels, des cadres méthodologiques, des ancrages bibliographiques qui doivent être maîtrisés pour qu’on puisse faire avancer les savoirs. En tout cas, si l’on ne donnait pas aux étudiants des outils correspondants aux différentes disciplines, je ne vois pas ce qu’ils pourraient produire. Mais je parlais essentiellement des studies focalisées sur des objets qui sont associés à des discriminations et qui les abordent dans une perspective militante, avec des études qui ne font souvent que répéter ce que l’on sait déjà ou démontrer ce qui n’est pas une hypothèse mais un postulat, formulé dans un vocabulaire totalement stéréotypé (« domination », « discrimination », « patriarcat », etc.) qui relève plus du slogan que de l’analyse.
Le monde universitaire et les médias, tant anglophones que francophones, semblent polarisés par ces approches. Entre la virulence de leurs adulateurs et la sévérité de ceux qui les rejettent, reste-t-il une place pour un examen dépassionné de certains de leurs apports ou doit-on fatalement se déclarer soit totalement pour, soit totalement contre ?
Tout dépend de ce qu’on en fait. En première année de sociologie, c’est très bien de parler de « construction sociale » face à des néophytes, de façon à dénaturaliser leur conception du monde. En revanche, quand des chercheurs continuent à ressasser des évidences dans des textes dont la conclusion se résume à « c’est socialement construit », on est loin du niveau que l’on peut attendre de professionnels de la recherche. Ce n’est pas penser, c’est empêcher de penser. Ça nous fait perdre du temps. Ça nous interdit de comprendre pourquoi les acteurs tiennent à penser que telle chose n’est pas une construction sociale mais une donnée de nature, alors que c’est un point essentiel. Ça nous interdit de comprendre les degrés d’inscription des faits dans des données biologiques ou dans des données historiques, etc. Donc ça nous interdit de faire le travail d’observation du degré de constructivisme, si je peux dire. De la même façon, il est très bon que l’on apprenne en première année de lettres l’importance de montrer qu’il y a eu des femmes écrivaines, puisqu’elles étaient peu visibles dans le corpus traditionnel, mais ça ne justifie pas d’introduire dans les bibliographies des ouvrages littérairement médiocres uniquement parce qu’ils ont été écrits par des femmes.
L’alternative entre « totalement pour » et « totalement contre » ne vise pas à comprendre, mais seulement à discréditer. Même mes travaux en sociologie de l’art ont été très critiqués au début par des spécialistes qui s’étaient imaginé que j’étais « contre » l’art contemporain. Mais le pire a été mon livre sur Bourdieu : ce n’était pas une charge contre lui mais un bilan ambivalent, qui montrait à la fois ce qu’il y a de formidable dans sa sociologie, ses apports évidents, et les impasses ou les aspects moins glorieux de son travail. Mais les journalistes l’ont lu soit comme un éloge, soit comme un pamphlet. En général plutôt comme un pamphlet.
Les journalistes n’ont pas été les seuls à le lire comme ça, à ce qu’il me semble…
Oui, mais là je leur en veux quand même, parce qu’ils ont vraiment été à côté de la plaque. Ils n’ont pas lu ce que j’écrivais parce qu’ils avaient en tête ce modèle selon lequel on est soit un thuriféraire, soit un opposant.
Pour autant, cette querelle est restée relativement confinée à la sphère intellectuelle. On ne peut pas en dire autant de vos écrits d’intervention sur les problèmes que posent les études « identitaires ». À quoi bon prendre le risque d’être étrillée sur les réseaux sociaux comme une J.K. Rowling de la sociologie puisque de toute façon aucun de ceux qui ont essayé de discuter les certitudes des militants n’a jamais réussi à les ébranler ?
Franchement, je me moque bien de ce qui peut se dire sur les médias sociaux, puisque je ne les regarde pas. Pour le reste, c’est comme si vous me demandiez « à quoi bon voter ? » Ça me paraît nécessaire parce que c’est la seule façon que l’on a d’exercer son devoir de citoyen. Là, c’est un devoir de sociologue. Est-ce que mes écrits sont utiles ou pas ? J’espère que oui, mais c’est un pari que je fais. Je ne compte pas toucher ceux qui sont déjà embarqués dans une secte puritaine woke, pas plus qu’on ne peut convaincre un complotiste, mais il y a aussi beaucoup de gens de bonne foi qui se posent des questions et que l’on peut aider à y voir plus clair. C’est par exemple le but de mon petit livre sur la notion si galvaudée d’« identité3 ».
Dans la même veine sceptico-pédagogique, vous n’avez pas hésité à déconstruire – si j’ose dire – la bonne vieille notion de « pouvoir », totalité menaçante comme l’œil de Sauron contre laquelle les esprits romantiques se plaisaient tant à brandir des épées en bois. Malheureusement, vous n’avez pas appliqué ce scalpel au fameux « pouvoir des médias ». Voici une occasion de compléter ce point.
J’avais d’abord écrit dans les années 1990 un article sur la fragilité des pouvoirs littéraires, et ça m’avait beaucoup amusée d’observer que, dans ce domaine, les différents pouvoirs – de publication, de consécration et de financement – sont en réalité soumis à des contraintes complexes, et vulnérables à un risque constant de discréditation. L’ouvrage collectif sur le pouvoir auquel j’ai contribué bien plus récemment questionnait plus systématiquement cette notion, qui amalgame de multiples sources de pouvoir et de multiples modalités d’exercice se contraignant mutuellement. Et puis ces pouvoirs ne sont pas forcément nuisibles par nature, ils sont souvent des nécessités de la vie sociale. Il en va simplement de même des pouvoirs des médias qui, comme les autres, sont multiples, limités et soumis à la surveillance collective, mais qui sont aussi très fragiles.
Pour en revenir à vos travaux de recherche, ceux que vous inscrivez dans l’arène scientifique, vous vous êtes notamment intéressée aux enjeux de la visibilité médiatique4. En quoi constitue-t-elle, pour reprendre vos termes, « un fait social total » ?
En étudiant cet objet sous différents aspects – historique, économique, psychologique, etc. – j’ai remarqué que la visibilité engageait à un point insoupçonné la totalité des dimensions de la vie sociale. Ce phénomène est tellement visible, évident, qu’on n’en perçoit pas toute l’ampleur. Il s’est accompagné d’un déplacement de l’attention que l’on accordait à la spécificité des productions culturelles vers la singularité des personnes elles-mêmes, avec un effacement de la distinction entre leurs vies publiques et privées. Or, cette emprise de la médiatisation de soi a modifié en profondeur les valeurs, sur le plan non seulement symbolique mais aussi moral, juridique, économique, etc.
Mais est-ce bien nouveau ? Après tout Virgile s’ébahissait déjà de la puissance de la renommée et Renaudot se lamentait au XVIIe siècle des pressions de tous ceux qui voulaient voir leur nom dans sa Gazette ?
La visibilité n’est justement pas la renommée. Elle est le produit du développement des moyens de diffusion technique de l’image par la photographie et le cinéma, puis par la télévision et les médias numériques. C’est vraiment la présence de l’image d’une personne dans l’espace public, présence permettant aux gens de reconnaître, c’est-à-dire de mettre un nom sur un visage. Le capital qui en résulte est différent du capital économique et du capital social, mais il est très inégalement réparti lui aussi, au point de créer un nouveau type d’élite. On peut le mesurer trivialement par la différence entre le nombre de personnes par qui l’on est reconnu et celui que l’on reconnaît soi-même. Et, naturellement, c’est la clef de la marchandisation de l’influence sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux et ailleurs : à l’apogée de la télévision, le présentateur du journal télévisé incarnait l’actualité pour une grande partie du public.
Oui, mais il s’appuyait sur une grande expérience professionnelle et il était soumis à des règles déontologiques, ce qui n’est pas le cas des influenceurs sur internet. On en revient ici à ce que nous disions du pouvoir des médias traditionnels : beaucoup de gens s’en inquiètent toujours, et il est vrai qu’il reste important d’en prévenir les nuisances éventuelles, mais ces problèmes-là sont infiniment moins graves que ceux qu’engendrent les réseaux sociaux. Arrêtons donc de faire du journalisme l’arbre qui cache la forêt : le pouvoir incontrôlé des réseaux sociaux est bien plus redoutable !
À défaut d’être le problème les journalistes peuvent-ils être la solution, notamment par leur travail d’établissement ou de rétablissement des faits ?
En partie, mais c’est loin de tout résoudre puisque ceux qu’ils atteignent sont des publics informés. Les articles de fact-checking, notamment, profitent à ceux qui les lisent mais pas à ceux qui ne s’alimentent qu’en opinions extrêmes sur les réseaux sociaux. C’est bien ce qui rend cette situation inquiétante.
D’un public à l’autre, il reste tout de même la possibilité de répondre par un lien vers un article examinant factuellement les affirmations sur une question : sans s’illusionner sur son pouvoir de remédiation, peut-on considérer le journalisme comme un espace de rationalité de référence fondé sur les faits ?
Absolument ! Même s’il est loin d’être parfait, c’est un pôle de professionnalité plus capital que jamais pour la vie sociale. Mais si les militantismes idéologiques arrivaient à le détourner de cette position, sa crédibilité n’y résisterait pas et lui non plus. 
Propos recueillis par Bertrand Labasse5
1
Albin Michel, 2023.
2Des valeurs : une approche sociologique, Gallimard, 2017, p. 17.
3Ce que n’est pas l’identité, Gallimard, 2018.
4De la visibilité : excellence et singularité en régime médiatique, Gallimard, 2012.
5Certains propos ont été synthétisés pour assurer la fluidité de cet entretien. Les notes sont de la rédaction.
Référence de publication (ISO 690) : HEINICH, Nathalie, et LABASSE, Bertrand. Nathalie Heinich : défendre l’autonomie de la recherche et de l’information face aux militantismes. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2023, vol. 2, n°10, p. D7-D14.
DOI:10.31188/CaJsm.2(10).2023.D007






