 |
Nouvelle série, n°3
1e semestre 2019 |
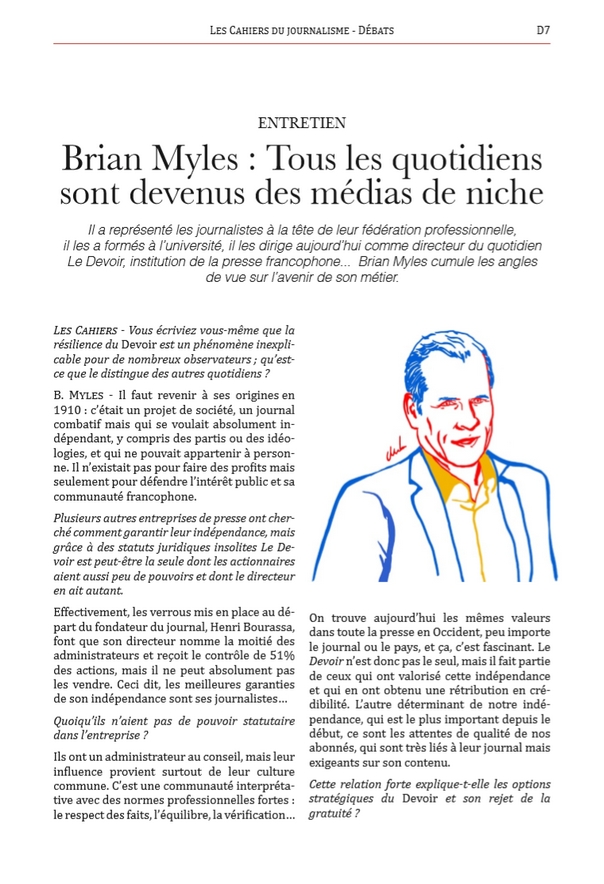 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
ENTRETIEN
Brian Myles : Tous les quotidiens sont devenus des médias de niche
Il a représenté les journalistes à la tête de leur fédération professionnelle, il les a formés à l’université, il les dirige aujourd’hui comme directeur du quotidien Le Devoir, institution de la presse francophone... Brian Myles cumule les angles de vue sur l’avenir de son métier.
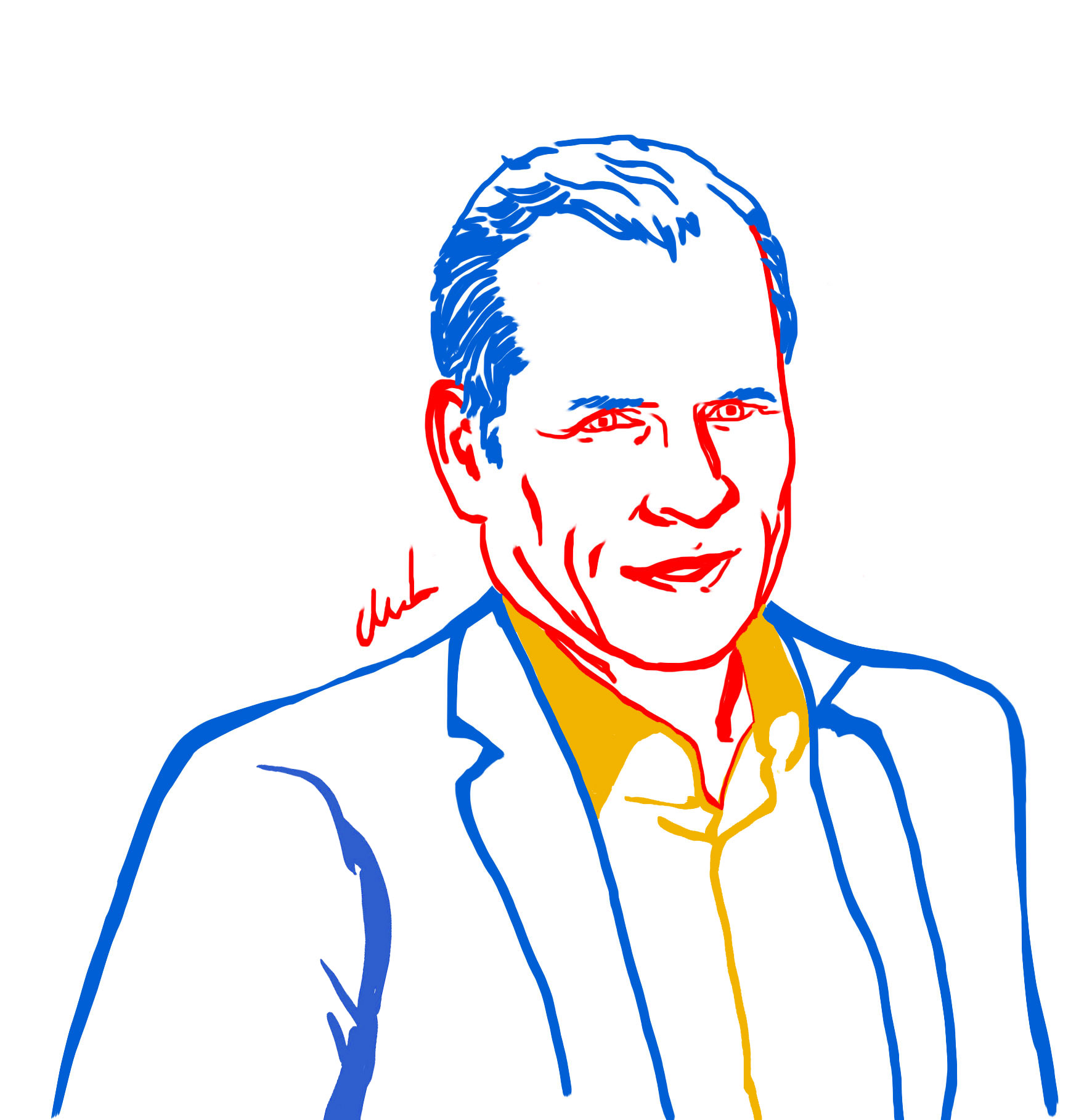
LES CAHIERS – Vous écriviez vous-même que la résilience du Devoir est un phénomène inexplicable pour de nombreux observateurs ; qu’est-ce que le distingue des autres quotidiens ?
B. MYLES - Il faut revenir à ses origines en 1910 : c’était un projet de société, un journal combatif mais qui se voulait absolument indépendant, y compris des partis ou des idéologies, et qui ne pouvait appartenir à personne. Il n’existait pas pour faire des profits mais seulement pour défendre l’intérêt public et sa communauté francophone.
Plusieurs autres entreprises de presse ont cherché comment garantir leur indépendance, mais grâce à des statuts juridiques insolites Le Devoir est peut-être la seule dont les actionnaires aient aussi peu de pouvoirs et dont le directeur en ait autant.
Effectivement, les verrous mis en place au départ du fondateur du journal, Henri Bourassa, font que son directeur nomme la moitié des administrateurs et reçoit le contrôle de 51 % des actions, mais il ne peut absolument pas les vendre. Ceci dit, les meilleures garanties de son indépendance sont ses journalistes…
Quoiqu’ils n’aient pas de pouvoir statutaire dans l’entreprise ?
Ils ont un administrateur au conseil, mais leur influence provient surtout de leur culture commune. C’est une communauté interprétative avec des normes professionnelles fortes : le respect des faits, l’équilibre, la vérification… On trouve aujourd’hui les mêmes valeurs dans toute la presse en Occident, peu importe le journal ou le pays, et ça, c’est fascinant. Le Devoir n’est donc pas le seul, mais il fait partie de ceux qui ont valorisé cette indépendance et qui en ont obtenu une rétribution en crédibilité. L’autre déterminant de notre indépendance, qui est le plus important depuis le début, ce sont les attentes de qualité de nos abonnés, qui sont très liés à leur journal mais exigeants sur son contenu.
Cette relation forte explique-t-elle les options stratégiques du Devoir et son rejet de la gratuité ?
Si nous avons pu tenir, c’est parce que nous avons toujours compté sur les revenus d’abonnements, beaucoup plus que sur les revenus publicitaires. Au Devoir, sept dollars sur dix proviennent des lecteurs et des donateurs. Même si nous avons été l’un des premiers journaux à ouvrir un site internet, nous n’avons jamais voulu donner notre contenu pour avoir plus d’audience. Si l’on regarde la cartographie des modèles d’affaires, la ligne de fracture ne passe pas entre l’imprimé et le numérique, elle passe entre le gratuit et le payant. En ce qui me concerne, je réfute totalement l’idée que l’information peut être un service gratuit : ma conviction, c’est que le modèle de l’abonnement reste le plus porteur d’avenir à une époque ou la plus grande partie des revenus publicitaires est partie chez Google et Facebook.
C’est peut-être plus facile à dire quand on vise une élite culturelle et politique restreinte que quand on considère la société toute entière : pensez-vous qu’il sera toujours possible de bien informer celle-ci dans 20 ou 30 ans ?
Je n’en ai aucune idée : c’est une éternité dans notre monde où ce que l’on peut faire de mieux, ce sont des plans stratégiques à trois ans. Je n’ai aucun malaise à occuper notre créneau, qui est moins étroit qu’on le pense, mais, en même temps que je défends la singularité du Devoir, je reconnais et je comprends les autres besoins. Je me sens très concerné par toutes les solutions qui permettront de préserver la diversité des voix et de servir différentes communautés de lecteurs.
Une autre particularité liée à ce positionnement du Devoir est qu’il est peut-être le plus petit « quotidien de référence » qui soit : comment parvient-on à tenir un tel rang avec 30 ou 40 000 acheteurs, abonnements numériques compris ?
Vous parlez des éditions de semaine : nous atteignons 55 000 le samedi. Sur nos plateformes numériques, Le Devoir rejoint 1,7 million de visiteurs uniques par mois. Si l’on compare les chiffres à la population, je suis très fier que le nombre de nos abonnés numériques au Québec corresponde proportionnellement à celui du Monde en France. Les critères censés définir un « quotidien de référence » restent discutés : quand on regarde le profil de nos lecteurs, le niveau de notre contenu et l’influence de nos pages, y compris les tribunes que nous publions, je crois que nous jouons notre rôle.
Mais non sans difficultés… vous disiez que Le Devoir n’avait pas été fondé pour engranger des profits : cet objectif a clairement été rempli si l’on considère la fragilité permanente de ses finances depuis un siècle. Est-ce la démonstration offerte à tous que l’on peut faire beaucoup avec peu ?
Cela démontre que l’on peut survivre très longtemps à condition de reposer sur une communauté de lecteurs très fidèles et de leur apporter une information qui correspond à leur exigence. À preuve, Le Devoir a connu quatre années de rentabilité dans les six dernières années. Et nos pertes furent limitées lors des deux années déficitaires. On parle beaucoup de philanthropie pour aider les journaux aujourd’hui : au Devoir, elle remonte à 1916. C’était presque une quête de charité car le navire vacillait, mais on a constaté que cet appui était pérenne tant qu’il s’inscrivait dans un lien fort avec les lecteurs. Bien sûr, notre budget nous oblige à être très prudents dans nos décisions : on ne peut pas faire d’erreur. Nous n’avons pas les moyens d’investir certains créneaux ou de couvrir trop souvent des sujets à l’étranger. Parfois par choix, parfois par nécessité, on s’oriente sur des domaines où nous pouvons offrir plus de valeur ajoutée, comme la politique, l’éducation, la santé, la culture ou l’environnement, un thème sur lequel nous avons été précurseurs.
C’est une autre similitude avec Le Monde, du moins celui d’Hubert Beuve-Méry dont la gestion était aussi austère que les pages et qui, comme vous, payait plutôt mal. Mais Le Monde d’aujourd’hui s’intéresse à son bassin linguistique au-delà ses frontières, à l’instar du New York Times et du Guardian : cette mondialisation des gros joueurs vous fait-elle peur ?
Bien sûr, nous n’avons pas la taille du Monde, avec qui nous entretenons d’ailleurs de très bonnes relations. Il est tout à fait logique qu’il veuille s’étendre à la francophonie comme d’autres le font dans le monde anglophone. Le Devoir n’a jamais été un « gros joueur » de sa vie : c’est un esquif rapide et agile, même si c’est moins confortable qu’un paquebot. Et il connaît très bien les eaux dans lesquelles il navigue.
En somme, il n’existerait pas de taille idéale dans la flottille des quotidiens.
Il y a différentes façons de s’adapter, de couvrir différents créneaux : au bout du compte, nous n’occupons tous que des niches par rapport aux plateformes en ligne. Même les journaux qui ont choisi la gratuité. Au début du XXe siècle, la presse incarnait les « mass medias » mais ce n’est plus ce que nous sommes. Si l’on regarde aujourd’hui nos succès à tous, c’est toujours par rapport à une niche, qu’elle soit petite ou grande.
Et si l’on regarde les problèmes ?
Lorsqu’on se rencontre dans des congrès internationaux et qu’on commence à parler ensemble, on réalise que nos problèmes sont similaires et que nos audiences se comportent souvent de manière similaire. Que les choix stratégiques que l’on fait ont des impacts similaires. Nos concurrents sont les mêmes : c’est Google et Facebook. La question pour tous, c’est la transformation radicale des habitudes de consommation et la préservation des revenus nécessaires à notre activité.

Brian Myles. Photo : B.L.
Ce qui suppose notamment de différencier la valeur et la crédibilité de cette activité par rapport à tous les autres contenus diffusés. Comment peut-on progresser dans ce domaine ?
L’un des défis est de combattre les amalgames. C’est l’importance du journalisme qu’il faut affirmer, pas l’importance des médias, la fonction du journalisme qu’il faut préserver, pas l’industrie des médias. Les fausses nouvelles, ce n’est pas mon problème, c’est celui des plateformes qui les diffusent : si nous avions fait le centième de ça, nous serions tous en faillite. Mais quand on parle des « médias », les gens confondent tout, alors qu’il n’y a pas une commission d’enquête qui n’ait pas commencé par une enquête journalistique.
Se pourrait-il que les journalistes et les éditeurs soient en partie responsables de cette confusion, ayant échoué à définir clairement ce qu’ils sont et ce à quoi ils s’engagent ?
Les médias sérieux, rigoureux, prennent des mesures pour s’assurer que leur public comprenne leurs règles, mais ceux qui ne les respectent pas auront toujours le droit de s’extraire de la communauté au nom de la liberté d’expression. J’ai soutenu à une époque l’idée d’une appellation contrôlée, mais c’était peut-être une perte de temps. L’angoisse identitaire des années 2010 face aux blogueurs et aux communicateurs a cédé la place à un autre type d’angoisse sur la survie même du métier. De plus, les journalistes ont toujours été hésitants à revendiquer des droits, des privilèges particuliers pour eux-mêmes, ils ont le sentiment d’un conflit d’intérêts. L’éducation aux médias et l’autorégulation me paraissent plus porteuses à long terme.
En matière d’autorégulation professionnelle, la longue expérience du Québec paraît à la fois illustrer ses vertus et ses écueils. Quels enseignements peut-on en retirer ?
Nous nous sommes dotés en 1973 d’un conseil de presse qui est indépendant du gouvernement et comprend des représentants des éditeurs, des journalistes et du public. Certains médias ont décidé de le quitter, mais nous sommes tous d’accord pour que l’adhésion ne devienne jamais obligatoire. Bien que des décisions semblent parfois discutables ou peu cohérentes avec des décisions plus anciennes, Le Devoir le soutient, comme beaucoup d’autres entreprises de presse écrite ou audiovisuelle, car ça reste le meilleur système que l’on ait trouvé jusqu’à présent. La principale amélioration que l’on peut espérer serait de mieux garantir la composition tripartite des comités qui étudient les plaintes : il arrive que les représentants du public composent la moitié d’un comité et il semble que la rectitude politique, les sensibilités particulières, s’invitent de plus en plus dans les débats.
La question des aides à la presse, qui est posée depuis bien longtemps en Europe, est très récemment devenue brûlante au Canada. Comment trouvez-vous que les pouvoirs publics fédéraux et provinciaux l’abordent ?
C’est le jour et la nuit : auparavant, même la profession ne voulait pas en entendre parler, à part un fonds pour la presse périodique, car nous avions peur de l’ingérence politique. Aujourd’hui, on ne voit pas comment les journaux pourraient perdurer sans aides publiques. Les détails précis des mesures sont en train d’être arrêtés, mais les principes qui ont été exposés semblent aller dans le bon sens. En particulier le crédit d’impôt sur la masse salariale car ce qui coûte cher, c’est de payer des bons journalistes et de leur donner du temps pour faire leur travail. C’est une perspective agnostique : elle vise l’information générale, celle qui permet aux citoyens d’avoir un jugement sur les affaires de la cité, mais elle concerne à la fois le journalisme gratuit ou payant, numérique ou imprimé. L’exonération des dons, comme c’est le cas pour les organismes de bienfaisance, sera aussi une bonne chose, car elle aura un effet multiplicateur. Ça pourrait aussi être le cas du crédit d’impôt offert aux particuliers pour leurs abonnements, mais s’il reste limité à 15 % de cette dépense, il n’aura pas d’impact. Au Québec les 35 % d’allègements sur les investissements numériques en auront beaucoup plus.
Ce qui semble plus difficile, c’est de protéger les producteurs d’information de la prédation des géants d’Internet.
Dans ce domaine, la logique du gouvernement fédéral est complètement irresponsable. L’argument est que les taxer reviendrait à taxer les contribuables, mais on pourrait dire la même chose de toutes les taxes de vente perçues à l’intérieur du pays, alors que ces ventes-là servent l’économie et la culture locales. L’équité fiscale c’est essentiel, et les taxes récupérées devraient alimenter un fonds pour la culture et les médias.
Pensez-vous que l’extension des « droits voisins » obtenue par les éditeurs européens soit une idée féconde ?
Je suis ambivalent. Surtout en ce qui concerne Google. Sa façon d’utiliser des hyperliens est respectueuse du droit d’auteur, il ne reproduit pas le contenu complet et comme il redirige vers nos sites, il contribue à générer du trafic, à nous rendre visibles. Il redonne aussi un peu en offrant des données comme celles de Google analytics. Le risque, ce serait qu’un jour Google cesse de référencer les contenus de la presse traditionnelle : le trafic, ça a une valeur et Google en est pourvoyeur, beaucoup plus que Facebook qui est totalement irresponsable, qui ne génère pas beaucoup de trafic et qui change d’algorithme selon son bon plaisir.
Donc, le vrai combat serait celui de la taxation des revenus publicitaires détournés des entreprises d’information ?
Cette privation des revenus de la publicité a été énorme, jusqu’à 66 % de moins en dix ans dans certains journaux. Mais il y a d’autres questions dont il faudrait aussi s’occuper sérieusement, en particulier l’encadrement démocratique et éthique des algorithmes qui président à la découvrabilité des contenus. Il ne peut pas y avoir d’écosystème viable pour l’information francophone s’il n’y a pas un régulateur quelque part pour niveler le terrain de jeu.
Les géants du Web pourraient-ils vraiment être forcés de donner accès à leurs algorithmes ?
Je n’y crois pas du tout : ce sont des secrets de fabrication aussi fermés que la recette du ketchup Heinz (rire). Mais je suis convaincu que l’on peut législativement encadrer leurs résultats. On doit leur appliquer des principes comme ceux de la Déclaration de Montréal sur l’intelligence artificielle, qui requiert notamment que les systèmes puissent être soumis à un examen démocratique, qu’ils restent compatibles avec la diversité sociale et culturelle et qu’ils ne restreignent pas l’éventail des choix et des expériences personnelles. Il faudrait s’appuyer sur ce texte pour sortir dès maintenant de l’idée qu’un algorithme est une technologie désincarnée.
La question de l’exception culturelle se présente sous un nouveau visage et les gouvernements ne peuvent se permettre d’être attentistes. Les professionnels non plus : on se replie dans des situations de niche accrochées aux pourtours de la révolution numérique mais il n’est pas interdit de penser qu’un jour, c’est l’activité journalistique comme une forme de langage qui ne sera plus là. Et le journalisme, c’est le canari dans la mine de la démocratie.
On connaît peu de patrons de presse qui aient auparavant été responsables d’association ou de syndicat de journalistes : comment le directeur du Devoir et l’ex-président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dialoguent-ils dans votre tête ?
Ils ne dialoguent pas trop, sans quoi je deviendrais fou (rire). Il y a des choses qui ne changent pas. On ne peut pas exercer l’une ou l’autre de ces fonctions si l’on n’a pas à cœur l’information et si l’on ne valorise pas le métier de journaliste ou la liberté de la presse. Je peux même avoir plus d’écoute auprès des gouvernements en tant que directeur de journal que je n’en avais à la tête de la FPJQ. Par exemple, avec des responsables de Québecor, de La Presse et de Radio Canada, nous avons réussi à faire avancer le dossier de la protection des sources qui ne bougeait pas. Ce qui change c’est que quand je me couche, j’ai la responsabilité des emplois de 120 personnes et de la survie d’un journal. Ce n’est pas que les idées ou les principes sont différents, c’est qu’on doit se demander s’ils rendent la chose rentable à la fin de l’année. Ça oblige à avoir un autre regard, avec un sentiment d’urgence que les journalistes, parfois, ne comprennent pas tout à fait.
Autre originalité, peu de directeurs étaient professeurs de journalisme à plein temps lorsqu’ils ont été nommés à la tête d’un journal. En quoi ces expériences d’enseignant puis de gestionnaire, mais un gestionnaire qui continue à citer des travaux universitaires, s’éclairent-elles mutuellement ?
Pour moi ce sont comme des couches successives de ma vie : elles se superposent mais aucune ne disparaît. Tous ces aspects sont liés bien que certains, par exemple l’aspect pédagogique, soient moins mis en avant selon le contexte. Les travaux théoriques m’ont aidé et m’aident toujours à voir certaines choses avec plus de recul, même s’il y en a – je ne veux citer personne – qui ne me semblent pas plus pertinents aujourd’hui qu’hier.
À l’inverse, est-ce qu’avoir dirigé un quotidien changerait les choses si vous retourniez un jour en salle de cours ?
Oui, j’essaierais d’être plus un mentor, de me mettre à la place des étudiants pour mieux les aider pendant une période de turbulences et d’inquiétude dans leur vie. En tant que directeur, une grosse partie de mon rôle est de gérer les relations humaines, de comprendre les espoirs et les déceptions des membres du personnel, les rapports entre eux. J’étais très exigeant pour préparer les étudiants à un métier qui est dur, stressant, mais peut-être que j’ai ébranlé la confiance en soi de ceux qui n’étaient pas prêts : il est difficile d’aller chercher leur valeur dans ce cas là. D’un autre côté, peut-être que je botterais encore plus de derrières pour que les étudiants se passent un peu de Google et des réseaux. Avant, on leur disait de lâcher leur téléphone et d’aller sur le terrain, maintenant on leur dit de lâcher Facebook et on espère qu’ils se serviront de leur téléphone pour parler avec quelqu’un. 
Propos recueillis par Bertrand Labasse, avec Marie-Ève Carignan*.
* Certains propos ont été synthétisés pour assurer la fluidité de cet entretien.
Référence de publication (ISO 690) :MYLES, Brian, LABASSE, Bertrand, et CARIGNAN, Marie-Ève. Brian Myles : Tous les quotidiens sont devenus des médias de niche. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2019, vol. 2, n°3, p. D7-D12.
DOI:10.31188/CaJsm.2(3).2019.D007






