 |
Nouvelle série, n°3
1e semestre 2019 |
 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
POINT DE VUE
La chute, le regain, et la chute de la confiance dans les médias
Parler des « médias » plutôt que des journalistes était une invention de l’équipe de Richard Nixon pour décrédibiliser ceux-ci, souligne Michael Schudson. Un demi-siècle plus tard, dans un contexte politique plus polarisé que jamais, faire comprendre l’activité journalistique reste un défi redoutable.
Par Michael Schudson
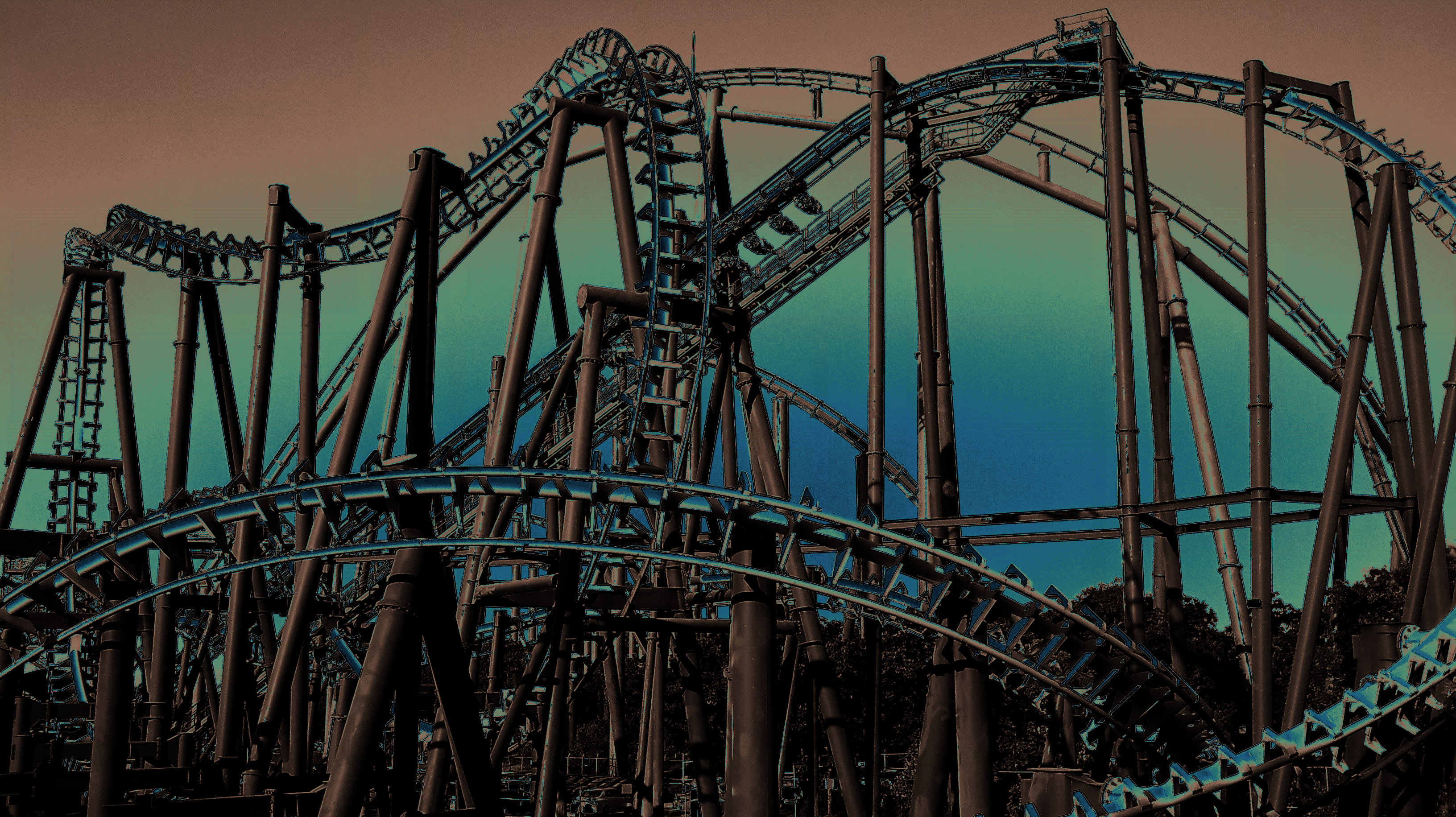
Illustration, d’après photo Isaac Oliva / Pixabay
C
’est l’inquiétude de notre époque, et l’on a l’impression que le ton du sentiment anti-presse est le plus enflammé que l’on ait connu depuis la fondation de la République. En fait, tous les présidents depuis George Washington, y compris Thomas Jefferson (dont la statue se dresse devant la Columbia Journalism School, où je travaille) ont estimé que les journaux étaient bourrés de mensonges. Les rédacteurs en chef n’avaient pas beaucoup de respect pour leur propre espèce, se provoquant parfois en duel. Et il y a une tradition de violence populaire à l’égard des médias, notamment contre les journaux abolitionnistes avant la guerre civile et contre les institutions et journalistes noirs à divers moments par la suite – une question, non pas de méfiance, mais de haine et de peur.
Les sondages nous ont permis de mesurer la confiance du public dans la presse et de la comparer à celle d’autres institutions. Au fil des décennies pour lesquelles de telles données ont été publiées, on a constaté que les gens avaient tendance à voir le journalisme sous un jour plus favorable que celui de la Maison-Blanche ou du Congrès, mais moins fiable que la médecine, l’éducation, l’armée, les organisations religieuses ou les grandes entreprises. Dans les années 1970, la confiance en toutes ces institutions a commencé à décliner. C’était peut-être un correctif nécessaire à la complaisance qui s’était développée – dans le public et les médias – et qui avait peut-être favorisé trop de confiance : nous avons accepté les mensonges du président Eisenhower à propos de l’avion espion U2, les mensonges du président Kennedy sur l’insuffisance de notre armement nucléaire, les mensonges du président Johnson sur la guerre au Vietnam, les mensonges du président Nixon sur le Watergate. Il a fallu la révolution culturelle des années 1960 pour faire tomber ce niveau de déférence trop généreux envers les bastions du pouvoir des États-Unis. Le résultat a été ce que Daniel Kreiss, spécialiste des médias, a appelé un niveau de « scepticisme civique » approprié dans une société démocratique.
En ce qui concerne plus particulièrement « les médias », avant que les informations télévisées ne s’installent dans les salons des États-Unis (dans la seconde moitié des années 1960) avec un ton prudent, mesuré, tellement sobre et soporifique, il n’y avait rien que l’on appelle « les médias ». Il y avait plusieurs grands quotidiens métropolitains dans pratiquement toutes les grandes villes américaines et l’on savait qu’ils avaient des engagements politiques d’une manière ou d’une autre dans la page éditoriale. Mais « les médias » en tant que terme général pour ce que l’on appelle maintenant « les médias dominants » n’était pas d’usage courant. Son entrée réelle dans le vocabulaire américain a été stratégiquement promue par la Maison-Blanche sous Nixon. Évoquer les journalistes en tant que « la presse » leur concédait un avantage émotionnel, une aura de rectitude et de protection liée au du Premier Amendement. Cet avantage – inacceptable pour Nixon, dont les assistants ressentaient que les journalistes avaient un préjugé défavorable à son égard – pouvait être supprimé en appelant les journalistes « les médias ». William Safire, qui rédigeait des discours pour Nixon, décrit dans son mémoire Before the Fall (1975), comment l’administration a poussé l’expression « les médias ». À la Maison-Blanche, se souvient-il, « la presse est devenue ‘‘les médias’’ parce que le mot avait une connotation manipulatrice, publicitaire, englobante et que la presse le détestait ». Safire se souvient que Nixon considérait les journalistes comme ses adversaires et avait déclaré à ses collaborateurs que « la presse était l’ennemi » une douzaine de fois en sa présence.
Le moment est peut-être venu pour les journalistes de reconnaître qu’ils écrivent à partir d’un ensemble de valeurs et non simplement de la poursuite désintéressée de la vérité. Ceci ne sera pas facile.
Même si l’on peut convenir que la confiance dans le gouvernement et les médias était trop élevée avant Nixon, il est possible que la confiance soit aujourd’hui tombée trop bas. Un scepticisme sain est-il devenu un cynisme civiquement nuisible ? C’est ce dont se nourrit Donald Trump : susciter une méfiance envers les médias telle que près de 40 % des Américains semblent accepter presque tout ce qu’il dit, même face à des informations irréfutables montrant le contraire, comme une sorte de doigt dans l’œil des prétendues élites.
Le problème ici transcende la présidence Trump : les vieux jours du reportage rituellement objectif (il a dit / elle a dit) n’ont pas disparu, mais leur importance a diminué à partir des années 1970, car les médias traditionnels ont de plus en plus insisté sur l’analyse dans le traitement de l’information, un peu moins de « qui, quoi, quand, où » et plus de « pourquoi ». Le journalisme a connu un changement culturel profond au cours de cette période.
Les limites de l’objectivité rigide ont été comprises et le journalisme a commencé à assimiler la nécessité de l’interprétation, comme en témoignent à la fois les études quantitatives et les souvenirs des journalistes. Plus récemment, The Watchdog Still Barks (2018) de Beth Knobel montre une croissance continue du nombre d’enquêtes d’investigation et d’autres types de reportages à l’initiative des journalistes entre 1991 à 2011. Confrontés aux graves problèmes économiques qui affectent les journaux, les principaux quotidiens métropolitains ont continué autant que possible à poursuivre un journalisme énergique et analytique. Ceci fait reposer sur les lecteurs une grande responsabilité pour discerner eux-mêmes la différence entre ce qui peut être considéré comme factuel et ce qui représente le jugement du journaliste – jugement qui, aussi consciencieux soit-il, va au-delà des faits documentés.
Les organes de presse devraient s’expliquer eux-mêmes pour communiquer la différence entre les rubriques d’information et la page éditoriale (plus du quart des Américains ne comprennent pas la distinction) ; pour montrer comment ils collectent leurs nouvelles ; pour clarifier pourquoi ils ne peuvent parfois pas divulguer leurs sources ; pour expliquer pourquoi cela compte que presque toutes les autorités scientifiques estiment que la composante la plus importante du réchauffement de la planète est l’activité humaine.
Il est peut-être temps, également, que les journalistes reconnaissent qu’ils écrivent à partir d’un ensemble de valeurs et non simplement de la poursuite désintéressée de la vérité. Ce ne sera pas facile, car les journalistes nient depuis des décennies que leurs valeurs personnelles ont quoi que ce soit à voir avec leurs reportages. Et pourtant, la plupart adhèrent, avec une certaine passion, à des valeurs professionnelles, tout comme les médecins prennent au sérieux le serment d’Hippocrate. Les journalistes des grands médias sont presque tous convaincus que : (1) ils devraient rechercher la vérité ; (2) ils devraient obliger le gouvernement à rendre des comptes ; et (3) les responsables gouvernementaux, tant élus que nommés, sont au service du public et ne devraient pas être au pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Je suppose que ces valeurs trouveraient écho chez les lecteurs, si seulement elles étaient revendiquées.
Comme de nombreux autres journalistes, Margaret Sullivan, chroniqueuse médias au Washington Post, s’inquiète du faible niveau de confiance des Américains envers les médias. En discutant avec des consommateurs d’informations à ce sujet, elle a remarqué que ceux-ci étaient plus conciliants et nuancés que les sondages ne semblaient l’indiquer. Tom Rosenstiel, directeur exécutif de l’American Press Institute, lui a dit que pour beaucoup de gens, « il y a ‘‘les médias’’ (mauvais) et il y a ‘‘mes médias’’ (plutôt bons). » De même, a-t-il noté, les gens accordent peu de crédit au Congrès mais pensent que leurs propres représentants locaux font bien leur travail.
La plupart des gens, cependant, sont occupés à vivre leur vie – c’est-à-dire qu’ils ne pensent pas profondément aux médias, même s’ils ressentent, selon les termes de Rosenstiel, « un malaise ou une frustration générale ».
Sullivan suggère que le journalisme pourrait regagner un peu de confiance en se consacrant à des sujets qui touchent la vie des gens ordinaires et en se débarrassant d’une attitude dédaigneuse qui plastronne implicitement : « Je suis plus intelligent que mon public ». À la fin, elle entonne un refrain connu : « Plus de transparence. »
Si l’on préconise plus de transparence de la part de la presse parce que cela permet un journalisme plus informatif et plus complet, très bien – une plus grande propension à « montrer son travail » pourrait rendre le journalisme plus éclairant. Mais je ne pense pas que cela renforcera la confiance à son égard.
Ce n’est pas ce qu’ont fait les médias qui a réduit cette confiance. Ce qui est arrivé récemment (je crois), c’est que beaucoup de gens ont pu se rendre compte qu’une petite élite devenait très, très riche alors qu’ils étaient eux-mêmes à la traîne. Le gouvernement ne procurait ni l’inspiration ni les politiques concrètes pour rendre quiconque plus confiant. Et les politiques devenaient de plus en plus polarisées. Les démocrates sont beaucoup plus susceptibles d’être « systématiquement libéraux » et les républicains « systématiquement conservateurs » en matière de fiscalité, de dépenses publiques, de réglementation et de protection de l’environnement qu’ils ne l’étaient cinquante ans plus tôt, lorsque la confiance dans les médias était plus grande.
Serait-il utile que les médias soient plus transparents quant à la façon dont ils produisent les nouvelles ? Peut-être un tout petit peu. Ce qui aiderait vraiment, ce serait une réduction, grâce à la politique, des inégalités économiques et de l’inégalité de la reconnaissance sociale et de la dignité. Ceci, j’espère, conduirait à une réduction de la polarisation politique et à une réduction concomitante de la propension des politiciens à chercher des applaudissements pour des déclarations extrêmes, y compris le dénigrement des opposants politiques.
Il n’est peut-être pas surprenant d’apprendre que la mission que s’est attribué le journalisme de tenir le gouvernement imputable nuit à la confiance du public. Au cours des quarante dernières années, le « journalisme d’imputabilité » est devenu une caractéristique déterminante des rédactions. Les nouvelles sont beaucoup moins déférentes qu’elles ne l’étaient autrefois pour les institutions et les gens au pouvoir. C’est peut-être une bonne chose, mais ça veut aussi dire que beaucoup de gens vont se méfier des médias, en particulier lorsque leurs politiciens préférés ou les partis auxquels ils s’identifient sont évalués de façon critique ou ouvertement mis en cause par une enquête, une information ou une opinion journalistique. Peu importe le nombre de rencontres avec des journalistes parrainés par les entreprises de presse ou la quantité de précisions qu’elles fournissent sur l’origine de chaque bribe d’information. Ce que les gens n’aiment pas dans les médias, c’est leur critique implicite ou explicite de leurs héros. C’est tout simplement plus réconfortant et, il faut le reconnaître, plus humain de blâmer le messager que de prendre les rapports critiques au sérieux.
« Les médias » sont plus responsables, plus précis, mieux fondés sur des analyses sophistiquées (plutôt que sur des réflexes partisans) qu’ils ne l’ont jamais été auparavant. Mais l’opinion politique a accru sa polarisation. Et elle est renforcée par la presse : alors que se désintègre le modèle d’affaires autrefois fiable de la collecte des nouvelles, la politique polarisée devient, malheureusement, un sujet délectable à rapporter pour des médias hautement concurrentiels. Il est plus tentant, par exemple, de couvrir la fermeture du gouvernement1 comme un match sportif entre Donald Trump et Nancy Pelosi que d’expliquer ce qu’une fermeture du gouvernement implique réellement. Nos meilleurs organes de presse tentent de le faire, mais la grosse information du jour dans la catégorie « fermeture du gouvernement » a tendance à éclipser les conflits à Washington. Qu’est-ce qu’une fermeture gouvernementale signifie pour les employés fédéraux, pour les remboursements d’impôt, pour l’inspection des aliments, pour le nombre de préposés de la sécurité des transports dans les aéroports, pour l’accès aux parcs nationaux. Tout ceci implique de traiter beaucoup plus de choses que ce sur quoi le Congrès et la Maison-Blanche peuvent s’entendre et sur le temps que cela pourrait prendre. Il faut couvrir le sujet partout dans le pays où les travailleurs fédéraux sont mis à pied, pas seulement Washington.
Le journalisme pourrait-il infléchir sa passion pour l’actualité traitée comme un match sportif ? Je vois mal ceci se produire ; au contraire, les choses empirent avec le cycle de l’information sur 24 heures. Le journalisme pourrait-il rompre avec son aspiration à réclamer des comptes aux politiciens et à les traiter avec scepticisme ? J’espère que non, même si ceci pourrait accroître la confiance qu’on lui accorde.
Certaines choses sont plus importantes que ce que les gens répondent aux sondeurs qui leur demandent s’ils ont confiance. Une de ces choses est le journalisme responsable et centré sur la transparence des pouvoirs. 
Michael Schudson est professeur à la Columbia Journalism School2.
1
Interruption de l’activité des administrations états-uniennes tant que leur budget n’est pas voté (NdT.)
2La première version de cet article est parue en anglais dans la Columbia Journalism Review, 58(1), 2019, p. 27-33. Traduction française : B. Labasse.
Référence de publication (ISO 690) :SCHUDSON, Michael. La chute, le regain, et la chute de la confiance dans les médias. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2019, vol. 2, n°3, p. D19-D22.
DOI:10.31188/CaJsm.2(3).2019.D019






