 |
Nouvelle série, n°3
1er semestre 2019 |
 |
||
|
RECHERCHES |
||||
|
TÉLÉCHARGER LA SECTION |
SOMMAIRE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
Vivre les représentations médiatiques de son trouble mental
Blandine Rousselin, Université Paris 2 Panthéon-Assas
Résumé
Cet article s’intéresse aux discours sur le traitement médiatique des problèmes de santé mentale de personnes se présentant comme atteintes de troubles mentaux sur le Web. On étudiera, avec une analyse de corpus et des entretiens, comment les personnes concernées perçoivent les contenus médiatiques véhiculant des représentations sociales stigmatisantes sur la santé mentale, renforçant la stigmatisation, la discrimination et le rejet préexistants. Comment vivent-elles le fait de voir le trouble dont elles sont atteintes représenté ainsi et quelles positions adoptent-elles à ce sujet ? Elles expriment des critiques sur le vocabulaire employé par les journalistes, considéré comme discriminant et les représentations associant troubles mentaux et violence. En revanche, les approches médiatiques donnant la parole aux personnes avec l’expérience d’un trouble mental et les angles didactiques sont plébiscités.
Abstract
This paper studies the discourses about the media treatment of mental health issues of individuals presenting themselves as having mental disorders on the Web. We will study, through a corpus analysis and interviews, how those individuals perceive the media contents conveying stigmatizing social representations about mental health, reinforcing the pre-existing stigma, discrimination and rejection. How do they live seeing the disorder they are suffering from being represented this way and what is their stance on this subject ? They express criticism regarding the vocabulary used by journalists, which is considered to be discriminating, and the representations associating mental disorders and violence. On the other hand, media approaches giving voices to people experiencing mental disorder and using a didactic angle are commended in these discourses.
DOI: 10.31188/CaJsm.2(3).2019.R009
C
omment la société les gère, les barjots, les schizos et les autres… / Bonkers Bruno Locked Up / Quand la maladie mentale tue / Prozac Kids Go Violent. Ces gros titres, trouvés dans des espaces en ligne où s’expriment des personnes se présentant comme atteintes de problèmes de santé mentale, ont été publiés dans des médias français et anglais (respectivement : La Provence, The Sun, France 2, The Sun). Ils reflètent un traitement médiatique de la santé mentale stigmatisant et véhiculent des représentations sociales péjoratives sur les troubles mentaux. Anderson et al. soulignent ainsi que :
les études de la couverture médiatique [de la santé mentale] dans de nombreux pays montrent qu’elle est généralement inexacte et stigmatisante car elle associe fréquemment les personnes ayant des problèmes de santé mentale à la violence et à la criminalité ou les décrit comme des victimes sans espoir1 (Anderson et al., 2018, p. 1).
L’étude IPSOS de 2014, Perceptions et représentations des maladies mentales, souligne qu’en France, la perception des troubles mentaux est marquée par la stigmatisation. On y indique que :
les Français [sont] gênés à l’idée de partager leur intimité avec des personnes atteintes de maladies mentales : à 52 % pour vivre sous le même toit, à 35 % pour travailler dans la même équipe et à 30 % partager un repas (Ipsos, FondaMental et Klesia, 2014, p. 20).
Cela représente des proportions élevées montrant que les troubles mentaux peuvent être une source de rejet social. Selon Alezrah, « les troubles psychologiques suscitent encore méfiance et réserves car l’"autre" est considéré comme différent quand les affections médicales ou chirurgicales nous semblent plus familières et entraînent plus facilement compassion et aide » (Alezrah, 2005, p. 334). Il souligne que cela vient de la « […] difficulté à considérer l’autre comme semblable, à s’identifier à lui, [ce qui] est à la base des processus d’exclusion, de toutes les exclusions » (ibid., p. 334).
Cela correspond à la notion de stigmate proposée par Goffman qui utilise ce terme pour « désigner un attribut qui jette un discrédit profond » sur la personne (Goffman, 1975, p. 13). Il explique qu’en présence d’un individu, un autre individu peut remarquer un ou des signes montrant qu’il a un attribut le rendant différent des autres personnes faisant partie de la catégorie à laquelle il pourrait lui aussi appartenir. Or, Goffman souligne qu’à partir du moment où l’on remarque cet attribut, l’individu qui le porte :
[…] cesse d’être pour nous une personne accomplie et ordinaire et tombe au rang d’individu vicié, amputé. Un tel attribut constitue un stigmate, surtout si le discrédit qu’il entraîne est très large […] (ibid., p. 12).
Goffman illustre ses propos avec, entre autres, l’exemple d’une personne ayant été hospitalisée pour des troubles mentaux : « Intentionnellement ou de fait, l’ancien malade mental dissimule de l’information quant à son identité sociale réelle, reçoit et accepte un traitement fondé sur de fausses suppositions à son propos » (ibid., p. 58). Les relations avec les autres, ceux que Goffman nomme les « normaux », vont en être affectées, créant dans situations où les personnes atteintes de troubles mentaux sont stigmatisées.
Alezrah souligne que pour « dé-stigmatiser les personnes souffrant de troubles mentaux, [il faut] travailler sur les représentations collectives et personnelles pour démystifier ces pathologies, les mieux connaître, les mieux soigner » (Alezrah, 2005, p. 334). Il explique que les médias, avec l’influence qu’ils peuvent avoir sur l’opinion publique, participent à la construction de ces représentations sociales, que l’on définit comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 2003, p. 53). Anderson et al. soulignent qu’en plus de participer à la stigmatisation :
[…] les représentations négatives des troubles mentaux dans les médias peuvent avoir un impact direct sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale en réduisant leur niveau d’estime de soi, en les décourageant à demander de l’aide, en augmentant leur expérience de discrimination et en entravant ainsi le processus de rétablissement personnel et clinique2 (Anderson et al., 2018, p. 1).
Plusieurs études ont été réalisées sur la façon dont les médias traitent les problèmes de santé mentale (Anderson et al., 2018 ; Costes et Dumas, 2018 ; De Ryinck, 2017 ; L’Observatoire société et consommation, 2015 ; Whitley, 2012 ; Whitley et Berry, 2013 ; entre autres). Celle de Costes et Dumas s’intéresse à la façon dont les personnes concernées par les troubles mentaux perçoivent cette couverture médiatique, mais les autres se concentrent presque exclusivement sur le traitement médiatique en lui-même. Or, selon Costes et Dumas, les « perceptions [des personnes concernées] de ce qui est dit sur la santé mentale restent insuffisamment abordées dans le champ de la recherche » (Costes, Dumas, 2018 : en ligne). Pour tenter de répondre à ce besoin, nous adoptons comme elles cet angle de recherche et proposons d’étudier les discours des personnes atteintes de problèmes de santé mentale sur le traitement médiatique de cette thématique dans des espaces d’expression en ligne (blogs, micro-blogs, chaînes YouTube, réseaux socionumériques : Facebook, Twitter et Instagram).
Étant donné les exemples de gros titres à connotation péjorative présentés ci-dessus et les résultats des études effectuées sur le traitement médiatique de la santé mentale qui soulignent qu’il participe à renforcer la stigmatisation déjà existante envers les personnes atteintes de troubles mentaux, nous nous interrogeons sur la façon dont les personnes reçoivent les représentations sociales des troubles mentaux véhiculés dans les médias et sur comment elles vivent le fait de voir le trouble dont elles sont atteintes représenté de cette manière. Plusieurs questions peuvent se poser pour répondre à cette problématique en se basant sur leur pratique d’expression en ligne. Nous nous interrogeons notamment sur les thématiques présentes dans leurs discours à ce sujet ainsi que sur les positions adoptées vis-à-vis de ces contenus médiatiques, par exemple si certaines approches médiatiques sont critiquées ou dénoncées et si oui, lesquelles et pour quelles raisons ? À l’inverse, on peut se demander si d’autres sont plébiscitées, encouragées par les personnes concernées et si des revendications vis-à-vis de ces représentations sont exprimées. Enfin, nous nous demandons s’ils s’expriment sur les conséquences pour eux de la diffusion de ces représentations sociales dans les médias.
On étudiera, dans un premier temps, la réception sur le Web de la désignation des troubles mentaux et des troubles du spectre de l’autisme dans les représentations médiatiques, notamment concernant le langage utilisé par les journalistes qui est considéré dans certains cas comme étant « péjoratif », « discriminant » et « abusif ». On analysera, dans un second temps, comment les individus concernés perçoivent les représentations sociales associées aux personnes atteintes de troubles mentaux dans les médias et les discours qu’ils tiennent sur les approches médiatiques employées par les journalistes pour traiter cette thématique.
Cadrage théorique, méthodes d’enquête et corpus
Ce travail de recherche en sciences de l’information et de la communication (SIC) adopte une approche interdisciplinaire et mobilise des références issues des SIC, de la sociologie ainsi que de la psychologie sociale. Courbet souligne à cet égard que :
la psychologie sociale et la psychologie permettent de développer la dimension humaine dans les théories de l’information et de la communication en donnant aux SIC des ressources théoriques pour mieux comprendre les êtres humains dans des situations de communication, en tant que membres de collectifs sociaux, en interaction grâce aux systèmes langagiers sémio-linguistiques, verbaux et non verbaux, et aux médias (Courbet, 2008, p. 12).
Le concept des représentations sociales, et en particulier le rôle joué par les médias dans celles-ci, a été théorisé, entre autres, en psychologie sociale. Les psychologues sociaux se sont intéressés aux effets des médias dans les processus communicationnels, et notamment aux « rôles des médias dans la violence sociale, dans nos représentations du monde [ainsi que dans] les stéréotypes et attitudes […] » (ibid., p. 12), thématiques qui sont au cœur de cet article. La notion de représentation sociale proposée en psychologie sociale permet, on va le voir, de saisir comment les médias participent à leur diffusion et est donc particulièrement adaptée à l’objet d’étude. Ces concepts théoriques issus de la psychologie sociale vont être mobilisés, mais les méthodes d’enquête employées et les questionnements posés sont ceux des SIC.
Cette recherche repose sur une analyse de corpus réunissant vingt espaces numériques gérés par des personnes atteintes de troubles mentaux et des personnes autistes3. Chacun de ces « espaces » est composé d’un ou plusieurs dispositifs principaux : un blog (x14) et/ou une chaîne YouTube (x8) et/ou un micro-blog Tumblr (x8), avec pour certains des réseaux socionumériques associés (Twitter [x12] et/ou Facebook [x12] et/ou Instagram [x8]). Cela représente un total de 62 entités. Les publications du corpus abordant ou utilisant des contenus médiatiques sont au nombre de 56. Une analyse de ces contenus a été réalisée en déterminant, pour les articles écrits par les créateurs des espaces, quels sont les médias mentionnés, si des exemples précis sont donnés (d’articles, de gros titres, etc.), quels sont les messages principaux et les réactions des créateurs à propos de ces contenus (point de vue sur les contenus : critiqués, plébiscités, commentés, etc., et pour quelles raisons). Dans les contenus médiatiques partagés, afin de déterminer les approches choisies, nous avons analysé quels sont les sujets abordés, l’angle choisi par le journaliste, à qui est donnée la parole (une personne concernée ou non), le langage employé pour se référer aux personnes touchées et si des explications sont présentes sur les troubles.
Pour compléter l’analyse de corpus, onze entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les créateurs de ces espaces, avec un employé du programme anglais anti-stigmatisation Time to Change et avec l’un des membres fondateurs de l’association PromesseS, qui rassemble des proches de personnes touchées par les schizophrénies.
Le Web, outil de dénonciation du langage
Les désignations des personnes atteintes de troubles mentaux et des troubles mentaux eux-mêmes ont beaucoup changé au fil du temps. Demailly présente les différentes dénominations employées pour se référer aux personnes atteintes de troubles mentaux depuis l’Antiquité grecque classique jusqu’au début du XXIe qui permettent de se rendre compte de la façon dont le régime de désignation évolue selon les époques (Demailly, 2011, p. 38-39) :
- Folie ; mania pendant l’Antiquité grecque classique
- Follus ; Stultius ; Fol ; les fous ; les idiots au Moyen-Âge
- Les fous ; les idiots ; la « folie sacrée » pendant la Renaissance
- Les insensés à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle
- Les fous ; les aliénés au début du XIXe siècle
- Les malades mentaux au XXe siècle
- Le handicap psychique, mental, cognitif ; les maladies psychiques ; la souffrance psychique ; health disorders ; les usagers de la psychiatrie ; la figure du déficit à la fin du XXe siècle (1990) et au début du XXIe siècle.
Au fil du temps, on observe un glissement vers un vocabulaire plus médical et dont les connotations se veulent plus neutres. Il existe également au sein de la psychiatrie elle-même des conflits pour catégoriser les troubles mentaux et définir leurs limites. Les classifications standardisées utilisées actuellement, le DSM-V et la CIM-11, sont provisoires et mises à jour périodiquement avec un processus de négociations complexe et long. Demailly précise que ces catégorisations sont compliquées par le fait qu’il y a « […] très peu de preuves matérielles, de "marqueurs" aujourd’hui pour objectiver un trouble subjectif, et ni les analyses biologiques, ni l’imagerie médicale ne peuvent objectiver une maladie mentale […] » (Demailly, 2011, p. 30).
De plus, Demailly souligne que « toutes les segmentations sont performatives et engagent des représentations sociales de son étiologie et de l’action correctrice préférable » (Demailly, 2011, p. 25). Les classifications et les dénominations employées au sein de celles-ci sont donc associées à des représentations sociales. Or, Jodelet explique :
[qu’on] reconnaît généralement que les représentations sociales, en tant que systèmes d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales. De même interviennent-elles dans des processus aussi variés que la diffusion et l’assimilation des connaissances, le développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales, l’expression des groupes, et les transformations sociales (Jodelet, 2003, p. 53).
Concernant la santé mentale, Jodelet précise par exemple que les mêmes représentations ne sont pas associées aux notions de « folie », de « maladie mentale » et de « dépression ». Ainsi, elle indique que lorsqu’il a été demandé à des enquêtés de qualifier les comportements en termes d’anormalité et de dangerosité de personnes étiquetées comme « folles », « malades mentales » ou « dépressives » :
il apparaît […] qu’une personne qualifiée de folle ou de malade mentale est rangée par plus de 90 % des interviewés dans les catégories "anormal" et "dangereux". Ce qui n’est pas le cas pour les dépressifs. Au fou et au malade mental correspondent des comportements violents (meurtre, viol, inceste), pour plus des trois quarts de la population ; pour près de la moitié, un discours bizarre. Aux dépressifs correspondent la tristesse, l’anxiété, le fait de pleurer souvent, l’isolement, le retrait social, le suicide (Jodelet, 2015, p. 214).
Ces représentations sociales sont donc centrales pour les personnes concernées puisqu’elles peuvent être source de stigmatisation, de rejet et d’isolement et avoir des conséquences sur leurs relations sociales, leur identité et leur estime d’elles-mêmes.
Velpry soutient également que « la question de la dénomination des personnes souffrant de troubles mentaux graves, [est un] enjeu actuel d’importance et complexe […] » (Velpry, 2004, p. 60), auquel les médias peuvent participer. Demailly soutient aussi que « les désignations et le rapport au trouble mental ont des enjeux politiques » (Demailly, 2001, p. 37). Elle prend l’exemple d’un article sur le suicide publié dans le journal du Parti communiste L’Humanité et explique que « l’imputation du suicide pratiquée […] n’est pas la même que l’imputation réalisée dans un autre journal [parce qu’elle] est systématiquement plus du côté de la sociogénèse dans L’Humanité » (ibid., p. 37), ce qui n’est pas le cas dans d’autres journaux. Cela signifie selon elle que « les discours sur le malheur psychique sont ainsi des enjeux collectifs idéologiques […] » (ibid., p. 37).
De nombreux enjeux sont donc associés à la désignation et aux représentations sociales des troubles mentaux, y compris dans les médias. L’analyse des discours des personnes se présentant comme atteintes de troubles mentaux en ligne montre que pour elles, le vocabulaire utilisé pour désigner les troubles mentaux dans les médias est dans certains cas « inapproprié », « péjoratif », « discriminant », « abusif ». Elles dénoncent cela sur leurs espaces en ligne et relèvent les conséquences associées à ces usages pour les personnes concernées.
Dénoncer le langage « insultant », « péjoratif » et « discriminant »
Dans un article du blog My Autistic Dance intitulé « I Am #Autistic, Not Your Bogeyman », la créatrice dénonce l’utilisation par un journaliste américain, George Will, travaillant pour Newsweek, du mot « autistique » comme une insulte pour qualifier une personne (ici Donald Trump) de « défectueuse » (defective). Dans un autre article, elle prend l’exemple d’un journaliste d’un quotidien britannique (dont elle ne donne pas le nom) qui emploie la phrase « remedial-level dipshit », une insulte difficile à traduire en français, pour décrire des enfants ayant un retard de développement. Ces deux exemples témoignent de l’utilisation de deux types de langage non approprié par des journalistes. La première est d’utiliser l’autisme, une différence de fonctionnement cognitif, comme une insulte. La seconde est le fait d’employer une insulte pour qualifier quelqu’un avec un handicap.
L’auteur du blog estime aussi que, lorsqu’il n’est pas insultant, le langage utilisé par les journalistes reste péjoratif et que les angles choisis portent uniquement sur les limitations des personnes autistes ou ayant des troubles mentaux ou des handicaps :
La majorité du langage utilisé dans les représentations du handicap est négative : ils parlent des déficits, de ce que nous ne pouvons pas faire, de la façon dont nous ne pouvons pas espérer correspondre aux normes établies pour les personnes capables4.
Ces propos sont considérés comme « discriminants » par les personnes s’exprimant sur les espaces en ligne de notre corpus et peuvent avoir des conséquences importantes pour les personnes concernées.
Dans un article du blog #3, la créatrice présente plusieurs instances dans lesquelles des médias (TV, journaux et personnalités publiques s’exprimant sur ceux-ci) ont utilisé, selon elle, des expressions « stigmatisantes » et « discriminantes » quand ils abordent la santé mentale. Elle cite deux exemples venant de la presse anglaise pour illustrer ses propos : un gros titre de The Sun, « Bonkers Bruno Locked up » (présenté en introduction, bonkers est une insulte utilisée pour parler d’une personne dite « folle ») et un gros titre de The Daily Mirror, « Killer pilot suffered from depression ». Ce titre fait référence au crash de l’avion de la compagnie Germanwings en mars 2015 pour lequel il a été dit dans les médias que le pilote souffrait de dépression et que ce serait la raison l’ayant poussé à faire écraser l’avion. L’auteure du blog explique pourquoi elle soutient que des propos de ce type sont discriminants :
[…] Dans les faits personne ne savait si l’incident avait un lien avec sa dépression et la plupart des personnes ayant une dépression n’ont jamais tué quelqu’un, de la même façon que la plupart des personnes sans dépression n’ont jamais tué quelqu’un5.
Pour elle, les journalistes ont mis en avant un lien de cause à effet trop rapidement entre la dépression et le crash de l’avion qui n’est pas justifié et participe à renforcer les clichés associés aux troubles mentaux.
Pour étayer ses arguments sur la discrimination, elle fait une comparaison entre les propos sur la santé mentale et les propos racistes. Elle prend l’exemple d’un commentaire raciste qui serait fait à la télévision et pour lequel la personne serait renvoyée. Elle estime que pour des propos similaires sur la santé mentale, il y a un double standard parce que la personne ne sera pas licenciée ou que ses propos seront ignorés, ce qui les rend ainsi plus « acceptables ». Elle demande sur son blog à ce que cela cesse en s’adressant directement aux journalistes comme en témoigne le titre d’un de ses articles : « Les médias doivent cesser d’ignorer les discriminations liées à la santé mentale6. » Elle insiste à plusieurs reprises sur le fait qu’une discrimination, quelle qu’elle soit, ne doit pas être ignorée :
La discrimination est une discrimination, qu’il s’agisse de la couleur de la peau d’une personne ou de son handicap. La discrimination est mauvaise à tous les niveaux et pourtant la discrimination en matière de santé mentale semble être ignorée dans les médias à maintes reprises7.
Elle accuse donc les médias mais également la société dans son ensemble d’ignorer la discrimination liée aux troubles mentaux et de participer à la renforcer. Pour corroborer ses propos, elle présente les conséquences que cela peut avoir pour les personnes touchées par les troubles mentaux, notamment le fait que cela peut empêcher les personnes de demander de l’aide par peur d’être discriminées, ce qui peut les mettre en danger, avec un risque accru de suicide par exemple. Enfin, elle s’adresse aux médias en soulignant le rôle qu’ils pourraient jouer pour réduire ces discriminations :
Les médias sont en position de force, ils peuvent soit éduquer beaucoup de personnes, soit causer beaucoup de dégâts. Il est temps qu ils se mobilisent et commencent à éduquer au lieu de faire du sensationnel et de discriminer8.
Elle dénonce également ici l’utilisation des troubles mentaux pour faire du sensationnalisme, une pratique répandue que Whitley et Berry présentent dans une de leurs recherches. Ils expliquent que certains journalistes « […] préfèrent utiliser la maladie mentale comme une opportunité pour faire du sensationnel et titiller, parfois de la façon la plus dramatique possible9 » (Whitley et Berry, 2013, p. 110). Ils précisent néanmoins que ce n’est pas le cas de tous les médias et que « certains journaux et journalistes adoptent une perspective de la santé mentale qui est progressiste et bien informée10 » (ibid., p. 110).
La créatrice du blog met justement en avant le rôle éducatif que peuvent avoir les médias dans la diffusion de représentations sociales plus « justes » sur la santé mentale. Cela a été relevé dans un rapport sur le traitement médiatique de la schizophrénie en France. Il indique que « le corpus médiatique, en tant que reflet et influenceur de l’opinion publique, tient un rôle structurant dans l’acceptation et l’intégration sociale de la pathologie » (L’Observatoire société et consommation, PromesseS, 2015, p. 9). Dans ce même rapport, les auteurs dénoncent l’utilisation du mot « schizophrénie » de façon inappropriée dans la presse comme pouvant être source de stigmate pour les personnes concernées.
Les exemples concernant ce trouble en particulier sont nombreux dans notre corpus. Le créateur du blog #15 y a consacré plusieurs articles. Dans l’un deux, il indique : « En sachant que les médias utilisent le terme "schizophrénie" à tort et à travers pour parler politique et que dans les films les tueurs fous sont ÉVIDEMMENT schizophrènes11. » Il souligne ici une utilisation « abusive » du mot schizophrénie ainsi qu’une représentation associée à la violence. Dans la suite de l’article, afin de répondre à cela, il remet en cause les clichés et stéréotypes véhiculés sur ce trouble. L’auteur a réagi à la Une publiée en septembre 2017 dans le journal La Provence (cité en introduction) avec une réponse au journal : « Les "barjots et schizos" vous crient ZUT. Parce que nous la politesse et le respect on les a appris à l’école contrairement à certains12. » Il faut noter que dans ce cas, le gros titre employait un langage péjoratif mais le contenu de l’article en lui même ne l’était pas, ce qui montre une volonté de faire vendre avec une forme de sensationnalisme placé en Une.
En entretien, le créateur de l’espace #15 nous a indiqué qu’il avait créé son blog avec l’objectif d’éduquer les gens : « Ce que j’ai remarqué, c’est qu’il y a des idées reçues, des clichés, des clichés véhiculés par les médias, par les films […] ; c’est vraiment entretenu par les journalistes13. » Il souligne ainsi le rôle des médias dans la diffusion de représentations sociales discriminantes mais également les conséquences que cela a eu pour lui :
Et ça m’a blessé parce que j’ai été confronté plusieurs fois à des remarques de personnes, même de personnel soignant. […] Et, donc c’est pour ça que j’ai créé le blog, c’est pour pouvoir faire passer des messages, un petit peu briser les clichés14.
Créer et publier sur son blog est donc une façon pour lui et les autres créateurs d’essayer de changer ces représentations en partageant un contre-discours basé sur leur expérience vécue. Ils s’adressent également aux journalistes pour réclamer des changements de leur part en soulignant les situations où ils emploient un langage discriminant.
Les discours des personnes concernées par les troubles mentaux sur le langage employé dans les médias à leur sujet expriment donc une certaine colère. Ils utilisent leurs espaces numériques personnels (blogs, réseaux sociaux) pour dénoncer cela, mais il existe aussi des initiatives mises en place par des collectifs et des associations.
Refuser l’emploi métaphorique du mot « schizophrénie »
L’utilisation du lexique des pathologies mentales dans des contenus médiatiques où le sujet principal n’est pas le trouble mental est également dénoncée par les personnes concernées. C’est notamment dans le cas du terme « schizophrénie » qui est employé de façon métaphorique dans des contextes médiatiques variés, comme le souligne l’auteur du blog #15 en s’adressant aux journalistes : « Quand vous arrêterez d’utiliser le mot schizophrénie (qui est une maladie grave) pour désigner un paradoxe, on se sentira moins manqués de respect !15 »
L’Observatoire Société et Consommation, à l’initiative de l’association PromesseS, a réalisé une analyse sémantique et lexicographique de plus de 1 000 articles16 et a montré que :
le discours médiatique tend à véhiculer, dans une large mesure, un sens fantasmé à l’antithèse de la réalité de la schizophrénie, maladie sévère, subie et dont la personne atteinte n’a aucune maîtrise (L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS, 2015, p. 6).
Les chercheurs ont déterminé que le terme est utilisé dans les médias de façon métaphorique principalement pour décliner « […] à l’infini l’image du double et désignant l’ambivalence, la contradiction, l’incohérence, le double langage... avec deux champs d’application privilégiés : le monde culturel et artistique et la vie politique » (L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS, 2015, p. 5) et non pour parler du trouble en lui-même. Or, ils soulignent que :
[…] la permanence de cette association "schizophrénie-double" colporte le soupçon de la non-authenticité de la maladie, et instille le doute profond que la maladie ne serait qu’un masque, cachant une possibilité de maîtrise ou de contrôle (L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS, 2015, p. 5).
Costes et Dumas relèvent que c’est également le cas pour l’utilisation du mot « bipolaire » pour le trouble bipolaire (Costes, Dumas, 2018). Elles soulignent que, in fine, ces usages « […] peuvent être source de préjugés et de comportements d’exclusion et de rejet vis-à-vis de l’autre alors cantonné, par effet d’étiquetage (Thoits, 1985), à une maladie en santé mentale » (Costes, Dumas, 2018 : en ligne). Elles ajoutent que :
les aspects sociaux liés à la maladie ou encore la stigmatisation dont les personnes atteintes de troubles psychiques peuvent être victimes se trouvent, quant à eux, fortement occultés dans le traitement médiatique (ibid.).
Ainsi, l’écueil est double puisqu’ils sont une source de stigmatisation dans la façon dont ils parlent de cette thématique et parce qu’ils n’abordent pas les expériences de stigmatisation vécues par les usagers. Selon elles :
[…] il en résulte une incompréhension qui génère de la peur au sein de la société et qui se révèle partagée puisque cette peur est aussi perceptible du côté des personnes atteintes de maladies psychiques elles-mêmes (ibid.).
Elles font référence ici à la notion d’« auto-stigmatisation » ou de « stigmate internalisé ». Bonsack et al. la définissent comme « […] le point de vue de la personne lorsqu’elle acquiesce aux stéréotypes qui la stigmatise et l’applique à elle-même ("je suis une personne paresseuse, nuisible et potentiellement dangereuse") » (Bonsack et al., 2013, p. 589). Dans ce cas, l’attribut stigmatisant est assimilé par la personne qui estime qu’elle correspond à ce qui est dit sur le trouble mental dont elle est atteinte. Cette internalisation a des conséquences sur la vie sociale ou professionnelle de l’individu. Costes et Dumas soulignent par exemple le déploiement de stratégies de dissimulation par les personnes pour se protéger. Dans notre corpus en ligne, cela va passer par l’utilisation d’un pseudonyme et la volonté de rester anonyme, qui correspond à la moitié des espaces analysés. En entretien, l’un des créateurs nous a indiqué avoir fait ce choix par peur de voir sa carrière professionnelle en danger si de potentiels employeurs venaient à apprendre qu’il était atteint d’un trouble mental.
Pour dénoncer cette utilisation métaphorique, l’association PromesseS a créé sur son site une rubrique qui s’intitule « Schizophrénie : À tort et à travers la presse » où elle recense des titres ou extraits de contenus médiatiques dans lesquels sont employés, selon eux, « à mauvais escient, de façon péjorative et erronée » les mots « schizophrène », « schizophrénie », « schizophrénique ». Plus de quarante exemples ont été recensés17, dont en voici quelques-uns :
- « Uber, les taxis et la schizophrénie de l’État français » (LeFigaro.fr, 08.06.15)
- « Le Royaume-Uni souffre de schizophrénie » (France Culture, 14.03.17)
- « Pour Aurore Berger (LREM), les Français sont schizophréniques et les retraités peuvent faire un effort » (LaDepeche.fr, 28.08.18)
- « La Norvège, ce faux ami de la planète - Enquête sur un pays schizophrène » (LesEchos.fr, 06.12.18)
La rubrique propose également des alternatives à l’emploi du mot « schizophrénie » pour certains des articles, en expliquant sa démarche : « Nous proposons à chaque fois au journaliste "le mot juste" qu’il aurait pu employer plus efficacement pour exprimer sa pensée… sans stigmatiser18. » Ainsi, pour l’exemple de l’article de LesEchos.fr, la phrase proposée est la suivante : « Enquête sur un pays dont la politique énergétique repose sur des logiques contradictoires ». L’objectif affiché est de montrer que le journaliste aurait pu utiliser un terme différent et qu’il est assez simple de ne plus employer le mot de façon métaphorique. Les lecteurs sont aussi appelés à partager sur la page Facebook des articles qu’ils auraient vu dans les médias employant le mot de façon « abusive ».
Sandrine Cabut, journaliste spécialisée dans la santé au quotidien Le Monde, s’est engagée à ne plus utiliser le mot « schizophrénie » de façon métaphorique dans ses articles et a appelé ses confrères à faire de même. Elle partage la page « À tort et à travers la presse » de PromesseS en tweet épinglé sur son compte Twitter pour expliquer son choix. Marion Paoli, qui a participé à la création de l’association, estime que sa démarche est « louable et efficace » et que « c’est positif parce que [son] message n’est pas vindicatif19 ». Elle souligne également la portée de ses actes en tant que journaliste au Monde et le rôle qu’elle peut avoir pour faire évoluer les pratiques en faisant ce choix.
Dénoncer et changer les représentations sociales
Le langage employé par les journalistes n’est pas le seul point dénoncé dans les discours en ligne qui sont également très critiques vis-à-vis des représentations sociales véhiculées dans les articles sur les personnes atteintes de troubles mentaux qu’ils considèrent comme étant très souvent négatives.
L’auteur du blog My Autistic Dance souligne par exemple que les personnes avec des handicaps, mentaux, psychiques ou physiques, sont :
décrites comme des objets de pitié. Un monstre des temps modernes exhibé afin que les personnes valides et sans différences cognitives puissent se sentir mieux dans leur peau, se sentir reconnaissantes d’être "normales"20.
Elle fait ici référence à la figure du monstre, une représentation sociale qui fait partie des frames utilisés de façon problématique dans les médias et présentés dans le rapport de De Ryinck (2017).
Or, selon elle, cette utilisation dans les médias de narrations toujours négatives pour raconter les expériences de personnes en situation de handicap participe à accentuer le rejet de la part des « normaux ». Elle dénonce ce qui est, pour elle, une volonté de créer un clivage entre deux groupes : « les personnes se disant normales » et « les autres » :
C’est la même chose lorsque ceux qui commettent des actes odieux comme des tueries de masse sont qualifiés de malades mentaux. Tout cela sert à distancer ces gens, à dire qu’ils ne sont pas comme "nous, les gens normaux". C’est ce qu’on appelle "l’altérisation", il y a nous, et il y a eux, les "autres"21.
On retrouve ici la référence à « eux versus nous », à « la folie versus la raison », dont parlent Foucault (1972) et Alezrah (2005), mais également aux groupes dits « déviants » étudiés par Becker. Il explique que « les groupes sociaux créent la déviance en énonçant les règles dont l’infraction constitue la déviance, en les appliquant à des personnes particulières et en les qualifiant d’étrangers au groupe22 » (Becker, 1963, p. 14). Cela est source de stigmatisation et d’exclusion et l’auteur du blog dénonce la participation des médias à la création de ces divisions.
Les troubles mentaux et l’autisme, de par leurs symptômes et caractéristiques, sont sources de difficultés de communication et de rapport aux autres (American Psychiatric Association, 2013 ; Anthony, 1993 ; Link, 1989). Or, en diffusant des représentations sociales négatives, les médias peuvent les accroître, notamment lorsqu’ils présentent de façon récurrente les personnes atteintes de troubles mentaux comme étant violentes et dangereuses.
Critiques de la représentation sociale
Les médias n’aident pas (surprise, surprise !) en cherchant activement à expliquer de nombreux actes de violence comme le résultat de maladies mentales, et en décrivant souvent l’antagoniste dans les thrillers et les films d’horreur comme souffrant de maladie mentale23.
La citation ci-dessus, extraite d’un article du blog My Autistic Dance abordant la santé mentale et l’autisme, montre que dans le corpus les créateurs prennent une position accusatrice vis-à-vis des médias en général, y compris de la fiction. Ils dénoncent l’association récurrente entre problèmes de santé mentale et actes violents qui, on l’a vu, est déjà une représentation sociale fortement associée aux termes « fou » et « malade mental ».
Costes et Dumas partagent trois catégories de représentations sociales liées aux personnes atteintes de troubles mentaux proposées par Jean-Yves Giordana qui sont « en premier lieu, […] la violence et la dangerosité ; en second, le caractère imprévisible et irresponsable et enfin la perception d’un comportement infantile » (Costes et Dumas, 2018 : en ligne). D’après De Ryinck, ces représentations sont présentes dans les contenus médiatiques et il les traduit par ce qu’il appelle des frames qui sont des angles d’approche utilisés de façon récurrente pour parler des personnes atteintes de troubles mentaux. Cinq d’entre eux sont des frames où « la personne avec un trouble psychique » est présentée comme « un problème » (De Ryinck, 2017, p. 21), ce qui peut être source de stigmatisation. Ces cinq frames sont « la peur de l’inconnu ; la maîtrise de soi ; le monstre ; le maillon faible ; la proie facile » (De Ryinck, 2017). Le frame de « la peur de l’inconnu » par exemple correspond à une méfiance vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux. Cela revient à penser qu’« en raison de leur trouble, elles sont imprévisibles et constituent un danger potentiel pour la société. Il faut les mettre à l’écart, en sécurité » (ibid., p. 23). Lorsque les médias associent troubles mentaux et violence, ils contribuent à renforcer ce frame et donc cette représentation sociale stigmatisante.
Costes et Dumas ont recueilli le point de vue de personnes concernées par les schizophrénies sur cette association récurrente dans les médias qui estiment que :
[…] le problème de la violence a tendance à n’être traité que d’un seul côté : peu de références sont faites aux agressions, qu’elles soient physiques ou verbales, subies par les personnes atteintes de troubles psychiques (Costes, Dumas, 2018 : en ligne).
À l’inverse, lorsqu’un acte violent est commis par une personne potentiellement atteinte d’un trouble mental, celui-ci est mis en avant. On peut citer l’exemple d’Anders Behring Breivik, responsable des attentats à Oslo et Utøya en 2011. L’Observatoire Société et Consommation dans son étude du traitement médiatique des schizophrénies a déterminé que dans les articles appartenant au « discours judiciaire24 », en lien avec le terme schizophrénie :
le nom de Breivik est mentionné à 147 reprises dans cette classe sur un total de 152 occurrences dans le corpus total, soit un poids de 97 % des unités de textes où l’occurrence est relevée » (L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS, 2015, p. 18).
Ils estiment que cela « […] fait de ce tueur une figure de la schizophrénie » (ibid., p. 18). Il y a donc dans les articles traitant de ce sujet une forte association entre le trouble en question et un acte violent, alors même que la schizophrénie était supposée, et non avérée, lors du procès. Costes et Dumas indiquent que face à ce traitement médiatique, les personnes concernées qu’elles ont interrogées « [...] évoquent une réelle souffrance par rapport aux représentations dont fait l’objet la maladie psychique » (Costes et Dumas, 2018 : en ligne).
Des propos similaires ressortent dans plusieurs articles et contenus publiés dans les espaces en ligne composant notre corpus. La créatrice de l’espace #18 indique dans un article de son blog que, pour elle, dans les médias, les journaux, mais aussi les œuvres de fiction, les personnes atteintes de troubles mentaux sont représentées comme des individus « dangereux », avec par exemple des « criminels » dépeints comme ayant un problème de santé mentale :
Il est rare que la santé mentale soit représentée dans les médias de façon positive. Dans les films, les livres, les chaînes d’info en continu et les chansons, la santé mentale est souvent représentée sous un angle négatif25.
Elle précise que les troubles mentaux peuvent causer des comportements agressifs, mais que ce n’est pas toujours le cas et que « souvent ceux qui ont des problèmes de santé mentale ont plus de risques d’être les victimes d’un crime26 » que l’inverse.
Dans l’espace #13, l’auteure souligne le fait que la schizophrénie est, selon elle, « liée injustement à des comportements violents », en précisant également que les personnes peuvent agir de manière violente mais que « […] la réalité est bien loin de l’image montrée dans la culture populaire27 ». Elle ajoute qu’une « personne qui souffre d’une maladie mentale est beaucoup plus susceptible de se blesser ou de se tuer elle-même28 ». On retrouve l’argument que les personnes atteintes de troubles mentaux risquent plus d’être en danger elles-mêmes que de mettre en danger les autres, alors que les médias ont tendance à diffuser une représentation inverse.
L’auteur de l’espace #3 insiste quant à elle sur le fait que lorsque les médias associent violence et trouble mental, ils parlent de cas isolés, exceptionnels et qui ne concernent pas la majorité des personnes atteintes de troubles mentaux. L’auteur de l’espace #9 a un discours similaire et dénonce le fait que dès qu'une personne atteinte de schizophrénie commet un crime, la presse en parle et cela a pour résultat une association systématique entre schizophrénie et violence : « On ne parle de la schizophrénie que lorsqu'un schizophrène tue. Mais pour combien de personnes dites normales qui tuent ?29 »
Ce discours souligne le fait que la presse semble, d’après elle, systématiquement parler des crimes commis par les personnes atteintes de schizophrénie, mais qu’elle ne le fait pas de façon aussi systématique pour les crimes commis par des « normaux » (au sens de Goffman, 1975). Elle estime elle aussi que les médias devraient parler du fait que la schizophrénie tue les personnes qui en sont atteintes (10 % des schizophrènes meurent de leur maladie d’après elle) plutôt que de parler des actes violents que certaines commettent :
Si les schizophrènes étaient des tueurs, la seule représentation à laquelle ils ont droit dans les médias, la France serait un champ de bataille permanent, puisqu’elle compte 600 000 schizophrènes30.
Avec cet argument, elle veut souligner que la majorité des individus atteints de schizophrénie ne sont pas dangereux, mais que les médias ne partagent pas de représentations de ces personnes.
L’auteure de l’espace #9 dénonce également le fait que, pour elle, les médias font de la propagande en véhiculant le message suivant : « Grâce à une efficace propagande dans les médias, beaucoup de gens sont persuadés que, sans traitement, tous les schizophrènes sont dangereux31. » L’utilisation du mot « propagande » dénote une réelle colère vis-à-vis de la couverture médiatique de la schizophrénie. Elle poursuit son explication en montrant pourquoi elle estime que c’est faux et en affirmant qu’elle est incapable d’être dangereuse : « Le danger, j’ai beau le chercher, je ne le vois pas. Ni folle dangereuse ni même armée pour la vie quotidienne, voilà l’étendue de ma dangerosité !32 » Elle nous a indiqué en entretien qu’elle avait créé son blog pour participer à faire changer ces représentations :
Ce qui m’a donné l’envie de créer un blog, c’est qu’en fait on parlait beaucoup de la maladie dans les médias associée à de la violence, par exemple parce qu’il y avait un schizophrène qui avait tué une infirmière et donc je me sentais un peu complice de ne pas en parler et le premier pas ça a été d’en parler sur Internet. L’objectif, c’était de faire comprendre aux gens ce qu’est la schizophrénie et de lutter contre les préjugés et les clichés33.
En utilisant des exemples issus de l’actualité, les créateurs des espaces en ligne analysés se servent de leurs plateformes pour diffuser un discours qui dénonce les représentations associant danger, violence et troubles mentaux présentes dans certains médias. On observe deux figures dans ces discours : celle, présente dans les médias, de la personne atteinte de troubles mentaux comme étant la responsable d’actes violents et celle, présente dans les discours des personnes concernées, de l’individu atteint de troubles mentaux comme étant la victime de ces représentations médiatiques mais également d’actes violents ou de rejet social.
Les créateurs ont choisi de développer, en se basant sur leur vécu, un contre-discours en partageant des représentations différentes sur le Web, outil qui permet à des « amateurs » (Cardon, 2010) d’avoir un espace d’expression auquel ils n’avaient pas forcément accès avant. En effet, selon Cardon, « […] Internet ouvre un espace de visibilité à des publications qui n’ont pas été soumises à une vérification préalable » (Cardon, 2010, p. 40) et les rend ainsi accessibles. Si elles restent dans ce qu’il nomme le « Web en clair-obscur34 », elles n’auront pas forcément un caractère public. Cependant, on va voir que certains des créateurs sont présents dans les médias traditionnels, ce qui place alors leur parole dans l’espace public.
De l’importance de donner la parole
En choisissant certaines approches journalistiques, les médias peuvent participer au processus de dé-stigmatisation, comme le soulignent Costes et Dumas. Elles estiment qu’il est « […] indispensable que les professionnels des médias soient associés à un tel travail de dé-stigmatisation » (Costes et Dumas, 2018 : en ligne). Elles expliquent qu’un rapport du Haut Conseil de la santé publique recommande :
[…] de développer un pacte de communication en santé mentale qui implique la presse, afin de s’assurer que les termes issus du vocabulaire de la psychiatrie ne sont pas employés dans un sens stigmatisant […], l’idée étant d’intervenir dès la formation des journalistes (ibid.).
Au Royaume-Uni, des programmes anti-stigmatisation sont mis en place. On peut prendre l’exemple de Time to Change qui est développé depuis 2007 en Angleterre. Ils élaborent et diffusent des campagnes en ligne, dans les médias, mais également sur le terrain auprès de différentes communautés, pour lutter contre la stigmatisation en donnant la parole à des personnes vivant avec un trouble mental. L’impact, positif, du programme a été évalué dans une recherche sur la façon dont la santé mentale est traitée dans les médias anglais. Anderson et al. ont ainsi déterminé qu’il y a eu plus d’articles traitant du sujet en quantité ainsi qu’une :
[…] augmentation de la proportion d’articles présentant la maladie mentale de manière anti-stigmatisante et une diminution proportionnelle simultanée de la représentation de la maladie mentale comme stigmatisante dans la couverture des journaux (Anderson et al., 2018, p. 6).
Selon eux, « il semble donc que l’augmentation de la couverture observée au fil du temps coïncide avec un glissement vers une couverture plus positive35 » (ibid., p. 6). Les médias peuvent donc changer la façon dont ils abordent les questions liées aux problèmes de santé mentale.
Cependant, dans une étude sur le traitement des troubles mentaux dans les journaux en langue anglaise au Canada, Whitley et Berry ont déterminé que :
ce qui est peut-être le plus inquiétant dans [leurs] conclusions, c'est l’absence totale de voix des personnes atteintes de maladie mentale dans les articles codés. Quatre-vingt-trois pour cent des articles codés ne comprenaient pas de citation ni même de déclaration paraphrasée d’une personne atteinte de maladie mentale36 (Whitley, Berry, 2013, p. 110).
Dans une étude similaire, basée sur des articles en langue française, Whitley indique que « […] seulement 14 % des articles citaient les déclarations de personnes atteintes d’une maladie mentale » (Whitley, 2012, p. 46).
Or, l’analyse des discours à ce sujet dans notre corpus souligne qu’il est important de donner la parole aux personnes concernées dans les médias pour qu’elles puissent raconter leur expérience. Les articles médiatiques partagés et plébiscités par les personnes sont ceux qui citent des personnes touchées et où elles peuvent témoigner de leur vécu. On y trouve des récits du vécu du trouble, du parcours de la personne, comment elle a été diagnostiquée, des symptômes, des conséquences sur sa vie quotidienne, la façon dont ses proches l’ont aidée, etc. Quatre créateurs du corpus ont eux-mêmes donné des interviews pour partager leur vécu du trouble dans des médias comme BBC Radio 4 ; France TV Slash ; Au Féminin ; Le Parisien.fr ; The Independent ; Stylist ; British GQ ; The Telegraph.
Cela donne un caractère public à leur parole, qui n’est plus uniquement accessible grâce au Web mais reconnue et présente dans l’espace public via les médias traditionnels (Cardon, 2010). Ils participent donc eux-mêmes à véhiculer dans les médias des discours sur les troubles mentaux tenus par les personnes concernées, en plus d’en diffuser sur leurs espaces en ligne. Ces récits se font à la première personne, via des interviews ou des témoignages écrits par la personne elle-même ou via des citations partagées par les journalistes. Or, Whitley et Berry estiment que « l’introduction de perspectives à la première personne peut humaniser l’expérience de la maladie mentale37 […] » (Withley et Berry, 2013, p. 111). En diffusant des contenus avec cette humanisation du vécu du trouble, les médias pourraient donc participer à dé-stigmatiser ces questions.
Marion Paoli, membre de l’association PromesseS et qui exerce en tant que journaliste, souligne également qu’il est important de donner la parole aux individus concernés, mais que cela doit être fait de façon respectueuse envers eux et leurs proches. Elle explique pourquoi :
le voyeurisme dans le journalisme, ça existe aussi. On a eu la preuve dans les trois derniers mois où on a reçu dans l’association des demandes extrêmement brutales de recherche d’un proche qui serait devenu SDF. On n’est pas à l’abri du sensationnalisme38.
Elle souligne donc que les journalistes doivent faire attention à la façon dont ils contactent les personnes lors des recherches de témoignages et être « dans le rapport humain39 ». Selon elle, « l’attention à l’autre devrait être constante40 » pour ne pas être source de souffrance pour la personne contactée. L’équilibre permettant de donner la parole aux personnes qui souhaitent s’exprimer, tout en ne créant pas de situations difficiles, peut donc être compliqué à trouver.
Enfin, l’Observatoire Société et Consommation a déterminé que dans les médias français qu’ils ont étudiés, pour la schizophrénie :
on ne trouve un véritable discours décrivant ou explicitant la maladie qu’à l’état de traces, soit noyées dans un discours médico-social qui s’attache plus à traiter de l’environnement de la maladie (structures de soins, exclusion, etc.), soit dans un discours scientifique, qui est faiblement présent (13 % seulement des occurrences), et traite majoritairement des effets du cannabis sur la santé, ou encore de l’implication des gènes dans les maladies du cerveau et non de la pathologie elle-même (L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS, 2015, p. 4).
Ils soulignent donc un manque d’articles où les troubles mentaux sont présentés de façon explicite. Or, dans les espaces en ligne de notre corpus, les contenus médiatiques ayant un angle didactique, avec des explications – sur les symptômes, diagnostics, conséquences pour la personne, traitements possibles, nombre de personnes concernées, etc. – sont mis en avant. Les personnes partagent des articles pédagogiques qui permettent de mieux comprendre les troubles mentaux et l’autisme et ce que signifie vivre avec au quotidien. Les contenus qu’elles produisent elles-mêmes, en se basant sur leur expérience, témoignent également de la nécessité de faire ce travail explicatif.
Des approches médiatiques prenant un angle éducatif permettraient donc de participer à la dé-stigmatisation et à une meilleure connaissance par l’ensemble de la population des troubles mentaux et des troubles du spectre de l’autisme. Cela permettrait de modifier les représentations sociales jusqu’ici associées à ces troubles dans l’imaginaire du grand public en le sensibilisant à ces thématiques.
Conclusion
Le programme anti-stigmatisation Time to Change a mesuré grâce à un sondage national utilisant l’Échelle des attitudes de la communauté à l’égard de la maladie mentale (Community Attitudes to Mental Illness Scale), les attitudes de la population anglaise vis-à-vis de la santé mentale. En 2017, à l’occasion des dix ans du programme, les résultats de l’enquête ont été diffusés. Le message principal était le suivant : « Ensemble, nous Time to Change et la société anglaise, nous avons amélioré les attitudes envers les maladies mentales de 9,6 %41. »
George Hoare, employé du programme, nous a précisé en entretien que « cela signifie que 4,1 millions de personnes ont amélioré leurs attitudes envers la maladie mentale, ce qui est beaucoup42 ». Ces changements ne sont pas uniquement expliqués par l’action de Time to Change et d’autres facteurs ont joué un rôle. Mais cela montre qu’il est possible en diffusant des messages avec des représentations sociales différentes des troubles mentaux, basées sur le vécu des personnes concernées, de faire changer les attitudes et de faire diminuer la méfiance et la « peur de l’autre » dont parle Alezrah et donc la stigmatisation et la discrimination qui en résultent.
En diffusant des discours en ligne et en témoignant de leur expérience vécue, les personnes autistes et les individus atteints de troubles mentaux participent à cela. Tout d’abord en mettant en visibilité (au sens de Callon et Rabeharisoa, 1999) la question des représentations médiatiques de la santé mentale. Ils dénoncent sur leurs espaces numériques le vocabulaire choisi par certains journalistes et les associations entre troubles mentaux et violence qui perpétuent les représentations sociales déjà existantes.
C’est également une façon pour eux d’exprimer leur désaccord et leur colère vis-à-vis des représentations sociales diffusées sur eux dans les médias et qui ne correspondent pas à leur expérience du trouble psychique ou de l’autisme. Il faut cependant préciser ici que l’analyse repose sur un corpus assez restreint et issu du Web uniquement, qui n’est donc pas représentatif de l’ensemble des discours à ce sujet. Elle se base sur les discours des personnes concernées, sur leurs ressentis et leur vécu en tant que personnes touchées directement par ces questions. Pour avoir un point de vue complémentaire, il serait intéressant d’interroger les journalistes qui produisent le contenu pour comprendre leurs choix et la façon dont ils traitent et perçoivent ces sujets.
Ensuite, pour répondre à ces approches « négatives » et essayer de les faire changer, les créateurs du corpus partagent des contre-discours, les leurs mais aussi ceux d’autres personnes, qui peuvent participer à dé-stigmatiser la santé mentale. Ils expliquent ce que sont les troubles mentaux et l’autisme avec un angle didactique en utilisant des formats variés : vidéos, articles, dessins, bandes dessinées, photographies, etc., sur différentes plateformes en ligne (blogs, Tumblr, chaîne YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) qui permettent de rendre accessibles ces informations à d’autres internautes.
Ils prennent également la parole dans les médias « traditionnels », lui donnant ainsi « un caractère public » (Cardon, 2010), pour témoigner de leur expérience ou souligner des problèmes liés à la prise en charge des troubles mentaux ou de l’autisme par exemple. Ils plébiscitent des contenus médiatiques ayant des approches plus « justes » selon leurs critères, à savoir donner la parole aux personnes concernées en les contactant de façon humaine et respectueuse au préalable, être didactique et véhiculer des messages plus positifs, comme par exemple la possibilité du rétablissement. Ils montrent ainsi que certains médias choisissent des angles qui ne sont pas stigmatisants et qu’ils participent à mettre en visibilité plus « justement » la santé mentale et les problématiques qui y sont associées ce qui peut, in fine, faire changer les représentations sociales à ce sujet. 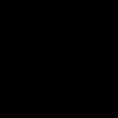
Blandine Rousselin est doctorante en Sciences de l’information et de la communication au Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias de l’Université Paris 2 Panthéon Assas.
Notes
1Traduction personnelle, texte original : « Studies of coverage in many countries show it to be generally inaccurate and stigmatising, as it frequently associates people with mental health problems with violence and criminality, or portrays them as hopeless victims. »
2Traduction personnelle, texte original : « […] negative media representations of mental illness can directly impact on people with mental health problems by reducing their level of self-esteem, discouraging help-seeking behaviours, increasing their experience of discrimination and thus impairing the processes of both personal and clinical recovery ».
3Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) font partie du DSM-V, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Cependant, les personnes autistes revendiquent le fait que l’autisme n’est pas une maladie mentale mais un mode de fonctionnement cognitif différent, nommé la neurodivergence. Dans une démarche de respect des choix des personnes concernées, nous faisons donc la distinction dans le vocabulaire utilisé pour nous référer aux personnes atteintes de troubles mentaux d’un côté et aux personnes autistes de l’autre dans notre travail de recherche. Les personnes autistes militent également pour que soit employée l’expression « personne autiste » et non pas « personne avec autisme », ce que nous allons faire dans cet article.
4Traduction personnelle, texte original : « The majority of language used in depictions of disability is negative: it’s all about deficits, what we can’t do, how we can’t hope to match the standards set for the able » [Extrait d’un article du blog #13, My Autistic Dance, 18.04.15].
5Traduction personnelle, texte original : « […] in actual fact nobody knew if the incident had anything to do with his depression and most people with depression have not killed anyone just the same as most people without depression have not killed anyone » [Extrait d’un article du blog #3, 27.06.15].
6Traduction personnelle, texte original : « The Media Need to Stop Ignoring Mental Health Discrimination ».
7Traduction personnelle, texte original : « Discrimination is discrimination regardless of whether that is about colour of a person’s skin or a person’s disability. Discrimination is wrong on every level and yet discrimination around mental health seems to be ignored in the media time and time again » [Extrait d’un article du blog #3, 27.06.15].
8Traduction personnelle, texte original : « The media are in a powerful position, they can either educate a lot of people or cause a lot of damage. It’s about time they stepped up and began educating instead of sensationalising and discriminating » [Extrait d’un article du blog #3, 27.06.15].
9Traduction personnelle, texte original : « Others preferred to use mental illness as an opportunity to sensationalize and titillate, sometimes in the most dramatic manner possible » (Whitley, Berry, 2013, p. 110).
10Traduction personnelle, texte original : « Some newspapers and individual journalists took a progressive and well-informed perspective on mental illness » (ibid., p. 110).
11Extrait d’un article du blog #15, 29.05.2017.
12Extrait d’un article du blog #15, 12.09.17.
13Extrait d’entretien avec le créateur de l’espace #15, 05.12.17.
14Ibid.
15Extrait d’un article du blog #15, 24.11.17.
16De presse quotidienne nationale avec Le Monde, Libération, Le Figaro et La Croix ; de presse magazine hebdomadaire avec Le Point, L’Express, Paris Match ; de presse régionale avec Le Parisien.
17En date du 14.01.19.
18Extrait de la page présentant l’initiative sur le site de PromesseS.
19Extrait d’entretien avec Marion Paoli, 23.01.19.
20Traduction personnelle, texte original : « Portrayed as objects of pity. a modern-day freak show exhibited so that the able-bodied and those without cognitive differences can feel better about themselves, feel thankful that they are "normal" » (Extrait d’un article du blog #13, My Autistic Dance, 18.04.15).
21Traduction personnelle, texte original : « It’s the same when those who commit evil abhorrent acts like mass shootings are referred to as mentally ill. It’s all used to distance those people, to say they're not like "us normal folks". It's called "othering": there’s us, and there’s them, the "others" » (Extrait d’un article du blog #13, My Autistic Dance, 05.10.17).
22Traduction personnelle, texte original : « […] social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders » (Becker, 1963, p. 14).
23Traduction personnelle, texte original : « The media doesn’t help (surprise, surprise!) by actively seeking to explain many violent acts as the result of mental illnesses, and often describing the antagonist in thrillers and horror movies as mentally ill » (Extrait d’un article du blog My Autistic Dance, 13.08.14).
24Ils ont déterminé quatre classes de discours où le terme schizophrénie est mentionné : « Classe 1 : « discours judiciaire », 11 % du corpus analysé ; Classe 2 : « discours culturel », 56 % ; Classe 3 : « discours scientifique », 13 % ;Classe 4 : « discours médico-social », 20 % » (L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS, 2015, p. 16).
25Traduction personnelle, texte original : « lt is rare for mental health to be portrayed within the media in a positive light. From films to books, news channels to songs, mental illness is often portrayed in a negative light » (Extrait d’un article du blog #18, 19.04.17).
26Traduction personnelle, texte original : « Often those who suffer with their mental health are more likely to be the victims of crime » (Extrait d’un article du blog #18, 19.04.17).
27Traduction personnelle, texte original : « unfairly linked to violent behavior » ; « the reality is far far removed from the picture painted in popular culture » (Extrait d’un article du blog #13 My Autistic Dance, 13.08.14).
28Traduction personnelle, texte original : « a person who suffers from a mental illness is far more likely to harm or kill themselves » (Extrait d’un article du blog #13, My Autistic Dance, 13.08.14).
29Extrait d’un article du blog #9, 13.04.11.
30Ibid.
31Extrait d’un article du blog #9, 14.04.11.
32Ibid.
33Extrait d’entretien avec la créatrice de l’espace #9, 25.09.17.
34Dans les quatre formes de prise de parole en public proposées par Cardon, cela signifie que la personne qui parle est un amateur et la personne dont on parle est « un quidam ne faisant l’objet d’aucune reconnaissance particulière » (Cardon, 2010, p. 43).
35Traduction personnelle, texte original : « Our findings suggest that there has been an increase in the proportion of articles which present mental illness in an anti-stigmatising manner and a simultaneous proportional decrease in the depiction of mental illness as stigmatising in newspaper coverage. It thus appears that the increase in coverage observed over time coincides with a shift towards more positive coverage » (Anderson et al., 2018, p. 6).
36Traduction personnelle, texte original : « Perhaps what is most concerning about our findings is the complete absence of voice for people with a mental illness in the articles coded. Eighty-three per cent of articles coded did not include a quotation or even paraphrased statement from someone with a mental illness » (Whitley et Berry, 2013, p. 110).
37Traduction personnelle, texte original : « Introducing first-person perspectives can humanize the experience of mental illness […] » (Whitley et Berry, 2013, p. 111).
38Extrait d’entretien avec Marion Paoli, 23.01.19.
39Ibid.
40Ibid.
41Extrait d’entretien avec George Hoare, Time to Change, Evaluation Manager, 07.12.18.
42Ibid.
Références
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.), Arlington, VA : American Psychiatric Publishing.
Anderson, Catriona, Robinson, Emily J., Krooupa, Anna-Maria et Henderson, Claire (2018). Changes in newspaper coverage of mental illness from 2008 to 2016 in England. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-8.
Anthony, William (1993). Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 4(16), 11-23.
Alezrah, Charles (2005). Considérer l'autre comme "semblable". L'information Psychiatrique, 81(4), 333-336.
Becker, Howard. S. (1963). Outsiders ; studies in the sociology of deviance. New York : The Free Press (ebook).
Bonsack, Charles, Morandi, Stéphane, Favrod, Jérôme et Conus, Philippe (2013). Le stigmate de la "folie" : de la fatalité au rétablissement. Revue Médicale Suisse, 588-592.
Callon, Michel et Rabeharisoa, Vololona (1999). La leçon d’humanité de Gino. Réseaux, 95, 197-233.
Cardon, Dominique (2010). La démocratie Internet, Promesses et limites. Paris : Éditions Le Seuil, La République des Idées.
Costes, Mylène et Dumas, Aurélia (2018). Santé mentale et schizophrénie [En ligne] : journals.openedition.org/communication/8313, 03.12.18.
Courbet, Didier (2008). Les apports de la psychologie sociale et de la psychologie aux sciences de l’information et de la communication ; pour un pluralisme épistémologique, théorique et méthodologique en SIC. Les Cahiers de la SFSIC, 3, 12-13.
Demailly, Lise (2011). Sociologie des troubles mentaux. Paris : La Découverte, Repères.
De Ryinck, Patrick (2017). Tous fous ? Parler autrement de la santé mentale. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.
Foucault, Michel (1972). Histoire de la folie à l'âge classique. Paris : Gallimard.
Goffman, Erving (1975). Stigmate ; les usages sociaux des handicaps. Paris : Éditions de Minuit.
Ipsos, FondaMental et Klesia (2014). Perceptions et représentations des maladies mentales. Paris : Fondation FondaMental.
Jodelet, Denise (2003). Représentations sociales : un domaine en expansion. Dans Denise, Jodelet, Les représentations sociales (p. 45-78). Paris : Presses Universitaires de France.
Jodelet, Denise (2015). Représentations sociales et mondes de vie. Textes édités par Nikos Kalampalikis. Paris : Les Éditions des Archives contemporaines, Collection : Psychologie du social.
L’Observatoire Société et Consommation, PromesseS (2015). L’image de la schizophrénie à travers son traitement médiatique, Analyse lexicographique et sémantique d’un corpus de presse écrite entre 2011 et 2015. Paris : Association PromesseS.
Velpry, Livia (2004). Ce que disent les personnes confrontées à un trouble mental grave. Expérience de la maladie et des prises en charge, et modes de vie. Dans Michel Joubert, Santé mentale, ville et violences (p. 35-60). Toulouse : Érès.
Whitley, Rob (2012). Stigmatisation et maladie mentale. Dans Fleury MJ, Grenier G, (eds), État de situation sur la santé mentale au Québec et réponse du système de santé et de services sociaux (p. 44-48). Québec : Gouvernement du Québec.
Whitley, Rob et Berry, Sarah (2013). Trends in newspaper coverage of mental illness in Canada : 2005-2010. The Canadian Journal of Psychiatry, 58(2), 107-112.
Référence de publication (ISO 690) : ROUSSELIN, Blandine. Vivre les représentations médiatiques de son trouble mental. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2019, vol. 2, n°3, p. R9-R28.
DOI:10.31188/CaJsm.2(3).2019.R009






