 |
Nouvelle série, n°3
1er semestre 2019 |
 |
||
|
RECHERCHES |
||||
|
TÉLÉCHARGER LA SECTION |
SOMMAIRE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
Santé mentale et création : une mutation des représentations esthétiques
Cécile Croce, Université Bordeaux Montaigne
Résumé
L’attention que l’art porte à la création qui l’inaugure parallèlement aux progrès des sciences médicales avec la psychanalyse a remis en cause l’opposition santé/maladie qui s’évalue à l’aune de la norme (Foucault). L’art n’est du domaine ni de la santé ni de la maladie qu’il frôle dans ses formes extrêmes. Lorsque Dubuffet relève les œuvres émanant de « marginaux » notamment asilaires, tandis que des médecins s’intéressent aux productions de leurs patients au point d’en établir des collections (Prinzhorn), le lien entre art et maladie est réinterrogé. L’« art brut » remet aussi en cause la norme arti¬stique. Ceux qui étaient autrefois mis au banc de la société, les « malades mentaux », allaient pouvoir participer des idéaux culturels, à leur ouverture à la diversité dont nous héritons aujourd’hui. Or, qu’il s’agisse des avancées psychanalytiques ou des théories de l’art, il apparaît que la véritable question est celle du processus de création (De M’Uzan, Gagnebin) ; elle aura pour conséquence un élargissement esthétique, travaillé par ailleurs par l’art, qui médiatise le déplacement des problématiques de la « santé ».
Abstract
The focus of art on creation, which usher in at the same time the scientific medical progress with psychoanalysis, calls for the question: opposition health/illness that is evaluated in regard to the standard (Foucault). Art is not a part of heath or illness, interacting with it only by a sliver. When Dubuffet notices the works originating from the « outsiders », especially from the asylums, whereas the physicians take an interest in their patient's production, going as far as collecting them (Pinzhorn), the link between art and illness is questioned again. The "art brut" (outsider art) also recalls the question of artistic standard. Those who once were on the outside of society, the « mentally ills », could finally play a part in developing cultural ideals, in their openness and diversity we inherited of today. Yet, whether the advances in psychoanalysis or in art theories, it is becoming clearer that the true question is that of the creative process (De M’Uzan, Gagnebin). It will cause an aesthetic broadening, worked furthermore by the art, which publicised the displacement of "health" issues.
DOI: 10.31188/CaJsm.2(3).2019.R065
D
e la « folie » à la « maladie », les représentations désignent des individus exclus d’une société qui repose sur une « norme » qui institue une certaine conception du « normal ». Or celle-ci, comme le posent Daniel Marcelli et David Cohen, recouvre quatre points de vue différents : « le normal en tant que santé, opposé à la maladie » ; « le normal en tant que moyenne statistique » ; « le normal en tant qu’idéal, utopie à réaliser ou à approcher » ; « le normal en tant que processus dynamique, capacité de retour à un certain équilibre » (Marcelli et Cohen, 2012, p. 5). La question de la santé ou de la maladie est donc une définition du normal parmi d’autres. Pourtant, elle apparaît prégnante avec les avancées des sciences médicales, et en particulier celles qui approfondissent les données psychiques comme nouvel éclairage de la « folie » et différencient ses multiples formes, déclinaisons, structurations, conditions, possibilités de soins. Les « déraisons » de l’âge classique deviennent, selon Foucault, alourdies par le poids d’une « faute », celle de l’ignorance de l’individu à ses propres procès psychiques, celle de son inconscient, qu’il s’agirait alors de faire avouer (Foucault, 1972, p. 315)1. Toutefois, précise l’auteur, la psychanalyse aura su faire retour à la déraison, en faire l’expérience. Plus encore, elle sera confrontée à une nouvelle énigme avec les grandes œuvres qui échappent à ses grilles (Nietzsche, Van Gogh, Artaud) :
Désormais, par la médiation de la folie, c’est le monde qui devient coupable (pour la première fois dans le monde occidental) à l’égard de l’œuvre ; le voilà requis par elle, contraint de s’ordonner à son langage, astreint par elle à une tâche de reconnaissance, de réparation ; à la tâche de rendre raison de cette déraison et à cette déraison (Foucault, 1972, p. 556-557)
Nous voulons confronter ces représentations scientifiques de la folie appelée maladie établies par la psychanalyse à celles proposées par l’art. Car il se trouve que, depuis la fin du XIXe siècle, au moment de la naissance de la psychanalyse et de la sécularisation de l’art occidental vis-à-vis d’une donnée référente, d’une Idea (Panofsky, 1989), une rencontre mêlée de malentendus et de quiproquos va s’opérer entre l’art et la psychanalyse autour de la question de la « santé mentale ». Elle trouve son point d’orgue dans l’art brut « inventé » par Jean Dubuffet et se poursuit jusqu’à aujourd’hui sous une forme assez différente, diffuse, engageant un regard esthétique renouvelé. Parallèle aux préoccupations artistiques émergeant des le début du XXe siècle dans ses formes les plus subversives avec la performance, c’est effectivement une remise en question du « monde », de la société qui porte l’œuvre, que les proximités de l’art et de la « folie » travaillent. La clef de la rencontre entre les sciences psycho-médicales et de l’art sera l’attention au processus de création. C’est elle également qui permettra de reposer la question du « normal » qui ne paraît plus pouvoir être contenue, avec la création artistique dans aucune des quatre catégories proposées par Daniel Marcelli et David Cohen.
Dans un premier temps, nous interrogerons l’art selon la psychanalyse, pour échouer à le faire « avouer » se situer du côté de la « santé » ou de la « maladie » ; puis, les cartes ayant été battues, nous examinerons comment les sciences psycho-médicales ont pu rencontrer l’art sur le terrain de la « folie ». Leur semblable intérêt pour les productions des « marginaux », en particulier asilaires, par-delà sans doute les raisons de cet intérêt, recouvre un examen du processus de création dont les approches, du côté de la psychanalyse ou du côté des arts, méritent d’être précisées. Cependant, c’est une rencontre toute nouvelle, en accord avec le devenir pluriel des arts, qui dessine notre actualité et revisite les notions de « santé » et de « normal » ; elle sera soulevée dans le troisième temps de notre étude.
L’art : santé ou maladie ?
En ce qui concerne le domaine de l’art, la psychanalyse s’est d’abord intéressée à l’artiste : Léonard de Vinci (Freud, 1910/1927), Giovanni Segantini (Abraham, 1911/2000), Edgard Poe (Bonaparte, 1933). Cependant, la place de l’art dans la société, ne fût-ce que par la reconnaissance de celui-ci et l’appréciation qui l’élève au rang d’idéal, de Hérault de la civilisation, a été aussi bien questionnée. Cette approche témoigne de la conception par la psychanalyse du sujet comme un individu social. Elle rejoint aussi la représentation de l’art par rapport à son propre positionnement dans la société. L’art est-il santé ou maladie de la société qui le porte ? C’est aux dysfonctionnements sociaux et sociétaux que l’art s’affronte à partir du début du XXe siècle.
L’art constitue une valeur sociétale. Selon Freud, il offre des « satisfactions substitutives en compensation des plus anciennes renonciations culturelles » (Freud, 1927, p. 20). L’art offre aux citoyens un accès à quoi ils ont dû renoncer :
À l’origine, l’artiste est un homme qui, ne pouvant s’accommoder du renoncement à la satisfaction pulsionnelle qu’exige d’abord la réalité, se détourne de celle-ci et laisse libre cours dans sa vie fantasmatique à ses désirs érotiques et ambitieux. Mais il trouve la voie qui ramène de ce monde du fantasme vers la réalité.
Comment ? « Grâce à ses dons particuliers, il donne forme ses fantasmes pour en faire des réalités d’une nouvelle sorte, qui ont cours auprès des hommes comme des images très précieuses de la réalité » (Freud, 1927/1971, p. 141). L’artiste suivrait une voie particulière, celle du procès de la sublimation qui, selon la psychanalyse, est un destin particulier de la pulsion, lui permettant de trouver un nouveau but non sexuel en des objets socialement valorisés (Freud, 1910/1927). Le spectateur, lui, bénéficierait d’un « élargissement bénéfique » de son Moi, d’un agrandissement de ses capacités de liaison (Gagnebin, 2006). Il semblerait que ces remarques situent l’art comme la bonne santé de la société – une bonne santé édifiée en fonction du « normal » en tant qu’utopie, une quête qui court toujours le risque de proposer des modèles à atteindre.
Pourtant, à l’endroit même où l’art est présenté comme Hérault de notre civilisation, il remet en cause nos valeurs culturelles. Le futurisme italien et russe, le constructivisme, dada, s’opposent à l’art établi. Se proclamant anti-art, dada provoque le scandale, défie les autorités (arrestations et censures attestent de sa réussite). S’il prend le contrepied de l’art traditionnel, c’est parce que celui-ci est la marque de cette « société absurde » qui a produit la guerre et que disjoint de la réalité sociale et politique ; il s’agit de le renouveler, à partir d’une table rase de ses principes et d’une attention nouvelle à la créativité2. Dans ses Considérations actuelles sur la guerre et la mort, Freud articule les valeurs sociales et les désillusions engendrées par la guerre. Alors que nous acceptions le renoncement à nos pulsions égoïstes en échange de la garantie du respect des normes pour la vie en communauté, voici que l’État, garant d’une telle organisation sociale, exige le hors-la-loi fait loi (Freud, 1915/1984). Les désillusions que provoque la guerre, explique Freud, sont la fin d’une illusion, celle de l’homme civilisé. Le Surmoi-Idéal du Moi social (associé à l’État) se faisant l’allié de nos pulsions, nous jette dans la barbarie comme leur écho extérieur, dans la guerre.
Au sortir de la Seconde guerre mondiale, c’est encore la désillusion vis-à-vis de la société qui fait le lit de l’actionnisme viennois3. Dans la société conservatiste de la Vienne des années 50, qui continue à tolérer les mouvements fascistes, les actionnistes viennois mènent des actions extrêmes qui leur valent emprisonnement et exil (Hermann Nitsch et son Orgien Mysterien Theater, Gunter Brus, Rudolf Shwartzkogler, Otto Muelh). Par leurs violences débridées, chaotiques, leurs références à l’Holocauste, la religion, les rituels primitifs, elles ressemblent à une fixation au trauma de la guerre. Les performances des actionnistes viennois en donneraient une répétition de la loi sans cesse hors-la-loi si violente et brutale qu’elle en apparaît une réitération, en deçà de toute représentation, lorsque l’action balbutie ses efforts pour donner consistance à la loi ou au code artistique émergeant de ses chaos. Elles versent aussi dans l’excès du triomphe du chaos, de l’ordre de l’orgiaque ou de l’extase, cherchant « l’autre jouissance » (Croce, 2015, p. 102). Il n’est pas question ici de ménager un espace sublimatoire au spectateur mais au contraire de le choquer. La violence et la brutalité de telles actions ne font pas figure d’exception : c’est le caractère même de la performance, art en action, de faire intrusion dans la sphère du spectateur (Croce, 2015, p. 89-95 ; Croce, 2012). Cette mutation artistique s’inscrit dans l’histoire (et dans ses crises) depuis la Première guerre mondiale et se poursuit jusqu’à nos jours, avec un moment d’acmé à la fin des années 60 et début des années 70. Ces actions, échouant à agrandir les capacités de liaison du Moi du spectateur, court-circuitant ses processus d’élaboration, ne témoignent-elles pas de la maladie de la société qui les porte ?
Au niveau de l’individu créateur, il apparaît également que les actionnistes viennois sortent du destin pulsionnel engagé dans l’art, la sublimation. Ils rejoindraient alors nombre de créateurs en marge de l’art (et de la « santé mentale ») pour lesquels Murielle Gagnebin identifie les procès psychiques au plus proche du déplacement, de la formation réactionnelle ou de la perversion, plutôt que de la sublimation. Cependant, nous ne pouvons pas trancher en opposant d’un côté l’art reconnu, portant les valeurs de la société, témoignant de la bonne santé de l’individu, et d’un autre côté la maladie dans les productions hors normes. Et ceci pour (au moins) deux raisons.
Premièrement, si l’art, effectivement, n’est pas un signe de maladie selon la psychanalyse, il n’est pas sûr qu’il soit un signe de bonne santé. Lorsque Freud analyse les procès psychiques en jeu chez Léonard de Vinci, il constate que certains moments de désublimation et d’arrêt dans la création par Léonard laissent place à l’affleurement de ses tendances névrotiques. Pour autant, si l’artiste trouve un certain équilibre dans sa création, rien ne saurait affirmer que son art est un signe de « bonne santé ». Michel de M’Uzan parle d’un véritable « enfer » pour l’artiste qui ne peut échapper à son irrépressible besoin de création et toutes les souffrances qu’il entraîne, tant il va toucher à ce qui remet en cause son intégrité narcissique. Pour l’artiste, l’art n’est pas bonne santé mais voie inévitable (De M’Uzan, 2008 ; De M’Uzan, 2015). Tente-t-il ainsi de réparer une faille profonde ? Pointe-t-il une maladie4 ? Il s’agira de préciser ce qu’en psychanalyse nous pouvons nommer « maladie », car les névroses menaçant le travail créateur de Léonard de Vinci par des blocages ne peuvent être comparés aux remontées engagées dans le processus créateur5.
Deuxièmement, ainsi que l’art, la sublimation doit être pensée avec le tissage social et culturel formé aux imaginaires de la constitution de la société, comme le montre Cornélius Castoriadis. Selon Castoriadis, « la sublimation n’est rien d’autre que l’aspect psychogénétique ou idiogénétique de la socialisation de la psyché considérée comme processus psychique » (Castoriadis, 1975, p. 454). « Ce qui donc est en cause dans la sublimation telle que nous l’entendons ici n’est ni seulement ni nécessairement la désexualisation » de la pulsion, mais l’instauration d’une intersection non vide du monde privé et du monde public, conforme, « suffisamment quant à l’usage, aux exigences posées par l’institution de la société telle qu’elle se spécifie chaque fois » (Castoriadis, 1975, p. 455). La considération de la sublimation s’avère tant accrochée à celle de la constitution sociétale et de ses représentations (inconscientes) qu’il serait absurde de juger de la valeur sublimatoire de l’art en dehors du jugement sur la société elle-même. Toutefois, la sublimation au sens de Castoriadis est comprise comme activité sublimatoire générale ; elle n’est pas réduite aux sublimations reconnues dans le domaine de l’art et de l’investigation intellectuelle où le concept de « valorisation sociale » prend connotation d’exception, de réalisation quasi idéale, visant les plus hauts objets qui soient pour une société, élus Héraults de sa culture et faisant la fierté d’une civilisation.
Les termes de « santé » et de « maladie » s’articulent à la norme qui sert d’étalon aux déviances, déraisons, perturbations de l’ordre donné, comme a pu le montrer Foucault. Pourtant, la psychanalyse, même si elle a alimenté scientifiquement les distinctions entre santé et maladie, en a remis en cause, fondamentalement leurs oppositions. Ne s’origine-t-elle pas en effet dans l’éclairage de la psyché humaine à partir de ses dysfonctionnements ? En s’intéressant de plus près à l’art qui, à son tour, fait un pas (de côté) vers elle, la psychanalyse s’aventure encore dans une pensée nouvelle de la notion de « santé ».
Rencontres et malentendus de l’art et des sciences psycho médicales
Les sciences psycho-médicales se sont intéressées aux productions de « malades mentaux » dès la fin du XIXe siècle grâce à quelques médecins aliénistes, tandis que, de leur côté, des artistes regardaient les œuvres de « marginaux ». Pourtant, les visées des uns et des autres sont fondamentalement différentes6. Les quiproquos et malentendus entre sciences psycho-thérapeutiques et art (ou théories de l’art proposées par les artistes) pourraient bien néanmoins constituer les prémices d’une rencontre qui revisitent les oppositions entre « santé » et « maladie », en déplacent le débat. La complexité de la définition de l’art brut inauguré par Jean Dubuffet en ce qui concerne ses frontières et son rapport à la « maladie » témoigne de ce débat en travail.
À partir de la fin du XIXe siècle, des médecins aliénistes, psychiatres et psychanalystes, s’intéressent à la production des patients que l’on nomme alors les « fous ». Amboise Auguste Tardieu publie en 1972 un petit ouvrage, Études médico-légales de la folie, qui présente deux cas d’aliénés et leurs dessins. Paul Max Simon distingue parmi les créateurs internés ceux qui créaient avant leur internement de ceux qui s’avèrent de nouveaux créateurs, dans un article « L’imagination dans la folie : étude sur les dessins, plans, descriptions et costumes des aliénés » en 1876. Avec une attention particulière aux qualités formelles des productions, le Dr Paul Meunier, psychiatre, signant sous le nom de « Marcel Réja », publie en 1907 L’art chez les fous : le dessin, la prose, la poésie. À la clinique de Waldau à Berne, le Dr Walter Morgenthaler s’intéresse à Adolf Wölfli, « premier malade mental au monde considéré comme un artiste à part entière » (Danchin, 2006, p. 6) et lui consacre une monographie en 1921 (1992) : Un aliéné artiste. En 1922, Hans Prinzhorn, médecin psychiatre à la clinique Heidelberg à Berlin publie L’activité plastique des malades mentaux. Contribution à la psychologie et à la psychopathologie de l’acte créateur, appuyé sur les cas de dix « maîtres schizophrènes ». Outre les écrits, des collections sont constituées : l’exposition européenne d’art psychotique en 1900 au Bethlem Royal Hospital de Londres ; Le Petit musée de la folie en 1905 à l’asile de Villejuif à Paris ; l’immense collection de Prinzhorn... qui regarde et compare, comme le rappelle Laurent Danchin, l’art des malades et « l’art des enfants, l’art primitif, l’art des médiums et l’art populaire » (Danchin, 2006, p.28)7. Si l’examen des médecins ouvre de plus en plus vers la dimension plastique et la création en jeu chez les « malades mentaux » (Hans Prinzhorn est aussi historien d’art), la motivation de leur curiosité tient beaucoup à la compréhension de la maladie en jeu, du dégagement d’une capacité d’élaboration par le malade, de l’éclairage des « pulsions » créatrices sollicitées.
De leur côté, les artistes puisent leur inspiration dans la spontanéité, la liberté d’expression de certaines productions hors des contraintes académiques : les cubistes se tournent vers les arts primitifs ; l’art naïf (déjà remarqué par le collectionneur Wilhem Uhde qui orchestre en 1937 l’exposition Maîtres populaires de la réalité) est apprécié par Gauguin, Delaunay, Picasso ; Kandinsky publie la peinture du Douanier Rousseau dans l’Almanach du Blaue Reiter. Paul Klee s’intéresse aux dessins d’enfants. Dada relève les arts mineurs face à l’art traditionnel. Le Facteur Cheval est admiré par André Breton et les surréalistes (Arp, Eluard, Ernst) qui regardent les « primitifs » de tous ordres et les exclus de la société : médiums, aliénés, prisonniers, marginaux, notamment au travers de l’ouvrage de Prinzhorn. André Breton (qui est aussi médecin de formation) s’intéresse aux créations de l’enfance, d’autodidactes, de cultures différentes.
C’est dans ce contexte de recherche de l’acte inaugural de la création artistique, pour une peinture originelle en dehors de l’académisme, que Dubuffet se passionne pour les œuvres d’asilaires en Suisse en 1945, puis d’autres créations non psychotiques : art médiumnique, créations de marginaux, des « irréguliers de l’art » Il ouvre en 1946 dans les sous-sols de la galerie Drouais à Paris le Foyer de l’art brut, fonde la Compagnie de l’art brut, puis, après le voyage aux États-Unis (et une brouille avec Breton), la deuxième Compagnie de l’art brut à Vence puis en Suisse, où la Ville de Lausanne prend en charge les collections de l’art brut sous la direction de Michel Thévoz en 1971.
Si l’art brut peut assez bien se définir, par opposition aux arts culturels et à l’académisme et cherche une forme sauvage d’art en dehors des apprentissages académiques de l’« asphyxiante culture », une production spontanée, libre, comme un langage direct, il est assez compliqué d’en cerner les frontières. Dubuffet le distingue de l’art naïf, des dessins d’enfants, de l’art des fous, en ce qu’il cherche chez eux ce qui relève d’une force créatrice. Si « la folie allège son homme et lui donne des ailes, et aide à la voyance », écrit Dubuffet en octobre 1949 dans son Manifeste L’art brut préféré aux arts culturels, qu’il n’y a « pas de raison d’en faire un département spécial », « qu’il n’y a pas plus d’art des fous que d’art des dyspeptiques ou des malades du genou », reste la question du repérage de ces œuvres. Dubuffet va assez loin dans la remise en cause de la séparation entre maladie et santé en ce qui concerne l’artiste puisqu’il considère que toute création d’art puise dans les mécanismes psychologiques pathologiques, à moins de changer notre conception du « normal », d’y recevoir les dits « fous8 ». L’art a cela de spécifique que sa spontanéité irréductible ne saurait s’accommoder d’une prescription, encore moins à but thérapeutiques : l’art brut, selon Dubuffet, n’est pas l’art-thérapie9.
La psychanalyse se heurte aussi à l’énigme de l’art, au noyau dur de l’explication du « génie » ; elle examine toutefois le processus de création. Depuis le destin pulsionnel de la sublimation analysé par Freud, de nombreuses propositions de l’examen du processus de création ont été tentées, portant sur des domaines artistiques divers (littérature, arts plastiques, cinéma), offrant des éclairages partiels ou globaux, articulant les procès psychiques en jeu, retraçant leurs chronologies possibles, dégageant les conditions (Croce, 2015, p. 141-157). Il semble que les psychanalystes s’accordent à relever un moment inaugural de la création qui pourrait être rapproché de l’« inspiration » que Michel De M’Uzan nomme, d’après Frobénius, « le saisissement créateur ». Didier Anzieu en fait la première des cinq phases du processus créateur. Il s’agit du « moment psychotique non pathologique » de la création, avec une régression et une dissociation, partielles et temporaires, tandis que des fonctions du Moi conscient restent actives « et assurent le maintien de l’attention, de la perception et de la notation » (Anzieu, 1981, p. 95). « Il y a tout autant une régression du Moi qu’une régression libidinale aux pulsions partielles prégénitales dont l’activité stimule le processus de sublimation », précise l’auteur (Anzieu, 1981, p. 100). Selon M. de M’Uzan, le processus de création artistique émerge d’un « désordre identitaire », « aux sources de l’inspiration », convoquant ce qui a « trait aux fondements de l’être », à l’« auto-conservatif » (« avant même le pulsionnel érotique, avant le narcissisme inscrit dans le psychosexuel »), « Identital non pulsionnel », fondamental, sorte de faille « qui va contraindre l’individu à se représenter pour survivre » selon un « saisissement autoritaire », « non colmatée et perdurant dans son être » (de M’Uzan, 2008, p. 38-41). Le processus créatif selon M. de M’Uzan se développe au sein de la psychosexualité, selon une régression libidinale et un drame identitaire de nature économique, s’alimentant l’un l’autre : « […] le dérangement identitaire non pulsionnel sexuel aggrave la régression, affectant l’état du narcissisme, cependant que, de son côté, la régression s’accentuant, amour et haine s’identifiant l’un l’autre, le statut identitaire s’altère » (de M’Uzan, 2008, p. 42). Moment de régression et de dissociation, certes partielles et temporaires, proche de l’identital, en négociation avec le psychosexuel, la création touche au domaine de la « folie » entendue ici dans le champ psychotique10.
La psychanalyse montre que le processus de création n’est pas assimilable au pathologique et que la phase inaugurale, sans doute « en deçà de la sublimation » (Gagnebin, 2012)11 laisse place à d’autres phases :
La partie du Moi restée consciente (sinon c’est la folie) rapporte de cet état un matériel inconscient, réprimé ou refoulé, ou même jamais encore mobilisé, sur lequel la pensée préconsciente, jusque-là court-circuitée, reprend ses droits (Anzieu, 1981, p.93).
Puis, le choix d’un code et d’un corps (dans un « corps à corps avec les matériaux ») ainsi que la composition proprement dite aboutiront à l’achèvement de l’œuvre.
Quant aux créations de l’art brut, il apparaît qu’elles ne suivent pas le processus de création en toutes ses phases. M. Gagnebin situe « l’art tératologique » (Nitsch, Dado, Bacon, Lebenstein, Passeron, Velicovic...) dans un retour à l’archaïque signant une proximité avec la pulsion, dans le plaisir primaire du jeu avec la matière, plus effroyable que drôlatique, de l’ordre du fétiche et du dérisoire (plutôt que du mensonge de l’art), beaucoup plus proche du déplacement, voire de la formation réactionnelle ou de la perversion que de la sublimation (Gagnebin, 1992, p. 45 ; Gagnebin, 2004, p. 236-252) ; d’autres auteurs y relèvent une désymbolisation (Dargent, 2008, p. 64-66).
D’un côté, donc, Dubuffet (mais aussi les artistes revenus à ces créations spontanées) reconnaissent l’art de certains « irréguliers » comme un art, l’« art brut » (plus « vrai », plus « pur » que l’ « art culturel12 » ; d’un autre côté, la psychanalyse reconnaît aux origines de l’art un moment psychotique, pris toutefois dans un processus de création qui le dépasse. À y regarder de plus près, il semble que dans les deux cas, nous ne parlons pas d’art mais de création13. Relever cette nuance permet de comprendre combien les œuvres qui remettent en cause fortement tout un pan de la société établie (y compris son art reconnu), avec des performances extrêmes comme avec les productions hors normes relevées par Dubuffet, ont pu flirter avec une représentation de la « maladie » de la société alors même qu’elles permettaient d’en renouveler les repères culturels. Car c’est bien de création, en son procès même, que ces œuvres traitent14.
Dubuffet a ainsi permis non seulement de réhabiliter la création des asilaires mais aussi de l’élargir à nombre d’autres productions. Le malentendu entre sa vision et celle des analystes est qu’il y reconnaît, avec leur force d’expression et leur spontanéité, une valeur d’art, quand la notion reste à définir, une valeur de création quand le processus demeure attaché à l’élaboration artistique. Ce malentendu s’inscrit pourtant sur fond de rencontre. Il aura permis de repenser l’articulation de la santé et de la maladie en la déplaçant sur celle du processus de création.
Élargissement esthétique et déplacement des problématiques de la « santé »
À vouloir faire de l’art brut un art tout en l’opposant aux arts « culturels », Dubuffet a par ailleurs risqué une certaine ostracisation du groupe. Qu’il s’agisse d’une réserve de la part de Dubuffet ou de la récupération par un marché de l’art parallèle, du passage « de la clandestinité à la consécration », il apparaît, comme le pose Carine Fol, que la catégorie, certes « hétérogène » de « créateurs autodidactes » en marge du circuit officiel, ait produit ses propres stigmatisations (Fol, 2015) :
L’art en marge est devenu, malgré lui, une case parmi d’autres avec ses habitudes, ses stéréotypes de présentation. La meilleure chose qui puisse arriver aux œuvres des handicapés les plus doués, quand la situation est possible, est d’être confrontées à l’art du moment. Parfois, la sagesse impose de ne même pas les révéler afin de les préserver d’un douteux contact mondain (Charlier, 2015, p. 9).
Aussi, souligne C. Fol, si « l’invention » de Jean Dubuffet « déstigmatise le lien entre l’art et la folie » :
son approche a projeté ces artistes, souvent sortis d’une forme d’anonymat à leur corps défendant, à l’intérieur d’un ghetto marginal face au monde de l’art officiel. La stigmatisation et l’instrumentalisation se sont en quelque sorte déplacées : l’étau de la folie et de la marginalisation a cédé la place à l’enferment anti-culturel (Fol, 2015, p.13).
Ces limites à la mutation des représentations de la « folie » grâce à l’attention à la création, cédant, au fond, à celles de « marginaux », se heurtent à un second écueil : celui de les vouloir exemptes de toute formation culturelle, de tout apprentissage. Déjà, autour des années 70, dans les pays anglosaxons, des amateurs se passionnent pour des créations en marge de l’art officiel, regroupant des œuvres plus diverses, comprenant l’art populaire. Puis, lorsque, « dans la dernière décennie du XXe siècle, l’art brut rencontre l’Amérique de l’art autodidacte et populaire » (Danchin, 2015, p.97), on assiste à un élargissement de la notion. Art singulier, art outsider, art visionnaire : l’art brut a-t-il jamais été création hors culture ? En y comprenant les œuvres de « primitifs » et en constituant un « ghetto marginal », la catégorie des œuvres héritant de l’art brut pouvait conduire à deux profils sociétaux différents : soit le maintien d’un art élitiste excluant du même coup les productions d’autres cultures, soit un art élargi, qui ferait exploser le ghetto. Le devenir de l’art, subversif et brouillant ses propres frontières, allant de la performance jusqu’à l’art « à l’état gazeux » (Michaud), comme la volonté des pouvoirs public allant en direction de la « diversité », et encore les échanges économiques et culturels, les développements des technologies communicationnelles, ont dessiné le second profil. Avec lui, il semble que s’opèrent, autour de l’accueil dans la sphère de l’art de productions très diverses, des ouvertures esthétiques à d’autres types de créations, d’autres cultures, la possibilité de mixer les domaines artistiques préfigurés par l’émergence de la performance15. L’art s’est ainsi agrandi de ces créations jadis « à ses marges », devenant un « art sans marges16 », tandis que la création demeure irréductible à l’enfermement en catégories17. Il faudrait alors parler de créations indépendamment du profil du créateur, de la culture référente ou des formes de représentations, tout en évitant de confondre cet élargissement avec un art de tous, égalisé en valeur à un « normal » statistique qui renverrait dans ses franges le pathologique de la création (écueil de l’art brut). Si la notion de santé comme celle d’idéal ont été également mises à mal par les trouvailles de l’art et de la psychanalyse attentifs chacun à sa manière au processus de création, nous pouvons interroger ce qui caractérise les nouvelles représentations du « normal ».
L’approche dynamique de la notion de « normal » pourrait être reconnue lorsque se déplace la conception de la norme avec l’assimilation des marges (de l’art), en direction d’un « art sans marges », ou avec la reconnaissance par l’art et la culture des propositions artistiques les plus extrêmes et les plus subversives. Les frontières entre art et « folie » sont traversées quand l’art va toucher au pathologique (dans les performances extrêmes18) et quand, à l’inverse, on va chercher du côté du monde asilaire des créations artistiques, mais leur jeu dépasse la seule assimilation.
La création mise en œuvre et interrogée par les artistes, les théoriciens, les psychanalystes, oblige à renouveler l’art, à orchestrer la défaite de la culture et son immédiate recomposition, différemment, sans se réduire à une simple adaptation aux exigences psychosociales qui ne laisseraient que peu de place aux bouleversement créatifs et à l’irréductible (et terrible) liberté du créateur. Plutôt qu’un point de vue dynamique, ce serait celui de l’économique qu’il faudrait évoquer, faisant écho aux explorations identitaires profondes, aux troubles de l’ordre de l’identital (de M’Uzan).
Lorsque Murielle Gagnebin sollicite quatre causalités psychiques de la création artistique, il s’agit moins de situer des paramètres fixes pour évaluer la création que d’envisager les possibles jeux entre des causes différentes (Gagnebin, 2004). Cette approche permet de rendre compte, dans le processus de création, de la plasticité de la psyché en même temps qu’elle soulève la question, face à la poïétique plastique de l’œuvre, de la poïétique psychique du sujet. Elle laisse aussi une place à l’authenticité. Enfin, la question de la création soulevée par les artistes subversifs comme par les créateurs répertoriés ou héritiers de l’art brut, a permis d’interroger la position du spectateur remis en cause dans sa propre culture, ses références données, ses étalons de « normalité », l’ouvrant possiblement à la création. Celle-ci n’est plus le fait exclusif d’artistes formés, cultivés, en bonne « santé », ni même génies admirés, mais peut-être juste celui des « hommes du commun » (Dubuffet, 1973). Elle peut aussi être le fait de révoltés, d’individus étranges venus faire intrusion dans la sphère jadis protégée du spectateur pour l’inciter à réagir, à se mêler de la création de leur œuvre, et modifier performativement la société établie. Avec l’ouverture, aussi bien théorique, artistique, qu’esthétique du processus de création, la question de la santé (individuelle, du créateur, ou globale, de la société produisant l’art) n’est plus centrale, sinon le travail opéré avec la réception, le travail du public.
Conclusion
La psychanalyse a permis d’affiner les catégories de « maladies mentales ». Selon son approche, l’art ne saurait se définir come santé ou comme maladie, ni au niveau de la société, ni à celui de l’individu. Pourtant, depuis le XXe siècle, l’art a su mettre en avant des pratiques parfois proches de « maladies » psychiques, notamment dans des performances parfois extrêmes. Puis, les artistes se sont fortement intéressés aux productions de « malades mentaux » mais aussi de marginaux. Il ne s’agit pas d’une simple attitude subversive de l’art, mais d’une véritable rencontre entre l’art et les sciences psycho- médicales qui, de leur côté, se tournent vers les mêmes productions.
Cette rencontre et ses malentendus ont inauguré une réflexion sur le processus de création obligeant à repenser les catégories du « normal » et du « pathologique » en les repérant dans un même processus économique. La médiatisation par la pratique artistique travaillée avec les sciences psycho-médicales a permis une nouvelle représentation de la « santé mentale » combinée avec le pathologique en ce qui concerne le processus de création à l’origine de ce qui nourrit notre culture. Elle a élargi nos perceptions esthétiques en direction d’un accueil de l’autre (en soi), dans l’acceptation heureuse des marges.
Notre étude aura soulevé deux garde-fous de cette médiatisation transformative des représentations de la « santé mentale » : d’une part celui qui met en garde du risque de résumer l’approche artistique à un renouvellement coûte que coûte de la culture et une opposition aux « arts culturels » (comme l’a fait Dubuffet) ; d’autre part, celui qui prévient de l’étroitesse d’une considération des productions plastiques uniquement dans un intérêt voire un but thérapeutique. C’est dire aussi que la psychanalyse peut tout à fait contribuer à une compréhension de l’art à condition qu’elle s’ouvre à leurs dimensions esthétiques ; elle participera ainsi de la pensée mutante des représentations mise en branle par l’art. 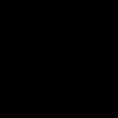
Cécile Croce est maître de conférences (HDR) à l’Université Bordeaux Montaigne, responsable de la filière Arts, Cultures et médiations, directrice adjointe du MICA EA4426.
Notes
1C’est ainsi que Foucault repère l’émergence de la « psychiatrie scientifique » du XIXe siècle : « […] au lieu de faire de l’aveuglement la condition de possibilité de toutes les manifestations de la folie, elle la décrit comme l’effet psychologique d’une faute morale » (Foucault, 1972, p. 315).
2Il s’agit aussi bien entendu d’une mutation des systèmes de pensées, descendant l’Idée, l’Idea, selon Panofsky, du domaine de la métaphysique (Grèce antique), religieux (Moyen âge), idéal (de la Renaissance au Néo-classicisme) (Panofky, 1924) jusque sans doute, selon nous, l’humaine psyché (avec le Symbolisme), jusqu’au monde extérieur (réalisme) et à la société. L’art aurait renoncé à l’Idée.
3Pour la précision de la différence entre les créations autour de la Première guerre mondiale citées et l’actionnisme viennois, voir notre livre (Croce, 2015, p. 97-103).
4Lorsque M. De M’Uzan compare le psychanalyste à l’artiste (écrivain), il écrit : « Pour écrire, pour écrire vraiment, l’analyste devrait-il être malade ? Il se peut, mais assurément à un moindre degré que l’écrivain. Jamais il ne désinvestit le monde autant que ce dernier peut le faire » (De M’Uzan, 2015, p. 32).
5Dont l’examen sera l’objet du deuxième temps de cet article.
6Comme le soulève encore Michel de M’Uzan : l’artiste et le psychanalyste ne visent pas les mêmes buts et ne suivent pas les mêmes procès psychiques (De M’ Uzan, 2015, p.13-33).
7Voir l’historique dans l’ouvrage de Laurent Danchin (Danchin, 2006).
8« Les mécanismes psychologiques dont procède toute création d’art sont tels, à ce qu’il me semble, qu’il faut ou bien les classer tous une fois pour toutes, dans le domaine du pathologique, et considérer l’artiste dans tous les cas comme un psychopathe, ou bien élargir notre conception de ce qui est sain et normal, et en reculer tant la limite que la folie tout entière y peut prendre place », Dubuffet, dans Honneur aux valeurs sauvages, 10 janvier 1951 (Danchin, 2006, p. 135 ; Dubuffet, 1973, p. 93).
9Voir par exemple les Lettre de Dubuffet : au Dr Jean Benoiston le 24 avril 1963, au Dr Mario Berta le 17 septembre 1972 (Danchin, 2006, p. 141).
10Nous pourrions aussi le rapprocher du théâtre de l’impossible selon Mc Dougall, différencié du théâtre de l’interdit, en ce qui concerne les performances extrêmes (Croce, 2012).
11Murielle Gagnebin met l’accent sur ces premiers moments du processus, lorsque doublé d’une entité qui le déborde, entre défaillances identitaires et sublimation, l’artiste est accompagné d’un ego alter qui procède de l’œuvre elle-même. Le créateur est pris dans un processus qui met en jeu des négociations constantes entre lui et sa création. Ces rapports complexes dessinent, pour l’œuvre, différentes trajectoires issues de l’émergence d’un élément tiers, sorte d’« inconscient de l’œuvre ». Cet « en deçà » émane d’un « insu projectif », de quelque « noyau psychotique ».
12Semblable rapprochement entre les arts novateurs et les créations de l’art brut a été fait par la terrible dénomination et stigmatisation dans une même catégorie d’« art dégénéré » (« Entartete "Kunst" » par Hitler, à Munich, en 1937).
13Laurent Danchin remarque que Dubuffet aurait pu, de son propre aveu, utiliser le terme « création » plutôt que le terme d’« art » (Danchin, 2006, p. 141).
14Il nous semble que l’art se destine à une préoccupation croissante de son propre processus de création depuis au moins la modernité (depuis la perte de l’Idea), examinant ses finalités (de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde guerre mondiale) puis les éléments nécessaires et suffisants pouvant le définir (de la Seconde guerre mondiale à la fin du XXe siècle).
15Tel un « DJ », l’art aurait ainsi mixé ses domaines (avec la performance) ; mais aussi ses références culturelles (alignées dans le Kitsch) ; surtout, depuis la fin du XIXe siècle et la modernité dans laquelle s’origine dada, l’art émerge dans le champ du social vivant.
16C. Fol met en avant l’importance du « commissaire-artiste » Harald Szeeman dans cette nouvelle conception de l’art en marge qu’il introduit dans les années 60 dans le circuit de l’art officiel (Fol, 2015).
17« "Brut" ou savant, atypique par essence, le génie fera toujours figure d’exception qui dérange. C’est donc dans les marges de l’art des marges en dehors de toute orthodoxie et de tout conformisme qu’il faut s’attendre à découvrir l’art brut de l’avenir, même s’il ne doit plus porter ce nom » (Danchin, 2006, p. 127).
18La performance en effet semble mettre en scène la violence en son double sens, de fait et de manière d’être : elle s’oppose à la fois à l’ordre et à la mesure, elles se démarquent du simple procès psychique pervers dont elles tirent profit pour se faire au final critiques de la société, et si, en semblant perversion, elles obligent le spectateur à soulever quelques questions esthétiques au frottement de la société. Elle propose une ouverture du processus de création (Croce, 2015).
Références
Abraham, Karl (2000). Karl Abraham, Œuvres complètes. 1907-1914. Paris : Payot. Col Sciences de l’Homme.
Anzieu, Didier (1981). Le corps de l’œuvre. Paris : nrf Gallimard.
Bonaparte, Marie (1933). Edgard Poe. Étude psychanalytique. Paris : Denoël et Steele.
Castoriadis, Cornélius (1975). L’institution imaginaire de la société. Paris : Seuil.
Charlier, Jacques (2015). Quand les attitudes se déforment. De l’art des fous à l’art sans marges. Paris : Skira.
Croce, Cécile (2015). Performance et psychanalyse. Expérimenter et (de)signer nos vies. Paris : L’Harmattan.
Croce, Cécile (2012). Les derniers outrages au théâtre de l’impossible. Une esthétique de l’outrage ? Paris : L’Harmattan.
Danchin, Laurent (2006). Art brut. L’instinct créateur. Paris : Gallimard.
Danchin, Laurent (2001). Jean Dubuffet. Paris : Terrail.
Dargent, Fanny. (2008). Performance corporelle : De l’art à la mort. Body Art et psychopathologie adolescente. Performances corporelles. Champs psychosomatiques, 51, 57-76.
Dubuffet, Jean (1973). L’homme du commun à l’ouvrage. Paris : Gallimard.
Ferrier, Jean-Louis (1997). Les primitifs du XXe siècle. Art brut et malades mentaux. Paris : Terrail.
Fol, Carine (2015). De l’art des fous à l’art sans marges. Paris : Skira.
Foucault, Michel (1972). Histoire de la folie à l’âge classique. Paris : Gallimard.
Freud, Sigmund (1910). Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (original : 1927). Paris : Gallimard.
Freud, Sigmund (1984). Considérations actuelles sur la guerre et la mort. Essais de psychanalyse (original : 1915). Paris : Payot .
Freud, Sigmund (1979). Malaise dans la civilisation (original : 1915). Paris : PUF.
Freud, Sigmund (1971). L’avenir d’une illusion (original :1927). Paris : PUF.
Gagnebin, Murielle (1978). Fascination de la laideur. La main et le temps. Lauzanne : L’Age d’Homme.
Gagnebin, Murielle (1987). Les ensevelis vivants. Des mécanismes psychiques de la création. Seyssel : Champ Vallon.
Gagnebin, Murielle (1992). En esthétique, quelle place pour la psychanalyse ? Pourquoi l’esthétique ? Paris : Jean-Michel Place.
Gagnebin, Murielle (2004). Pour une esthétique psychanalytique. L’artiste, stratège de l’Inconscient. Paris : PUF.
Gagnebin, Murielle (2006). La contemplation artistique : l’acte au travail. Revue française de psychanalyse, 70(1), 45-54.
Gagnebin, Murielle (2012). L’en deçà de la sublimation. L’ego-alter. Paris : PUF.
Gombrich, Ernst (1971). L’art et l’illusion, psychologie de la représentation picturale. Paris : Gallimard.
Korff-Sausse, Simone (2004). Le corps extrême dans l’art contemporain : entre perversion et créativité. Champ psychosomatique, 35, 61-74.
Lanteri-Laura, Georges (1984). La psychopathologie de l’art comme stratégie de la singularité. Art et fantasme. Seyssel : Champ Vallon.
Mac Dougall, Joyce (1982). Théâtres du Je. Paris : Gallimard.
Marcelli, Daniel et Cohen, David (2012). Enfance et psychopathologie. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson.
Mauger, Gérard (dir.), (2006). Droits d’entrée. Paris : Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme.
Michaud, Yves, (2003). L’art à l’état gazeux. Paris : Stock.
Morgenthaler, Walter (1992). Madness and art : the life and works of Adolf Wolfli (original : 1921). Lincoln : University of Nebraska Press.
M’Uzan (de), Michel (2008). L’enfer de la créativité. L’artiste et le psychanalyste. Paris : PUF.
M’Uzan (de), Michel (2005). Aux confins de l’identité. Paris : Gallimard.
M’Uzan (de), Michel (2015). L’inquiétude permanente. Paris : Gallimard.
Panofsky, Erwin (1989). Idea (original : 1924). Paris : Gallimard.
Passeron, René (1989). Pour une philosophie de la création. Paris : Klincksieck.
Prinzhorn, Hans (1996). Expressions de la folie. Paris : Gallimard.
Référence de publication (ISO 690) : CROCE, Cécile. Santé mentale et création : une mutation des représentations esthétiques. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2019, vol. 2, n°3, p. R65-R76.
DOI:10.31188/CaJsm.2(3).2019.R065






