 |
Nouvelle série, n°7 2nd semestre 2021 |
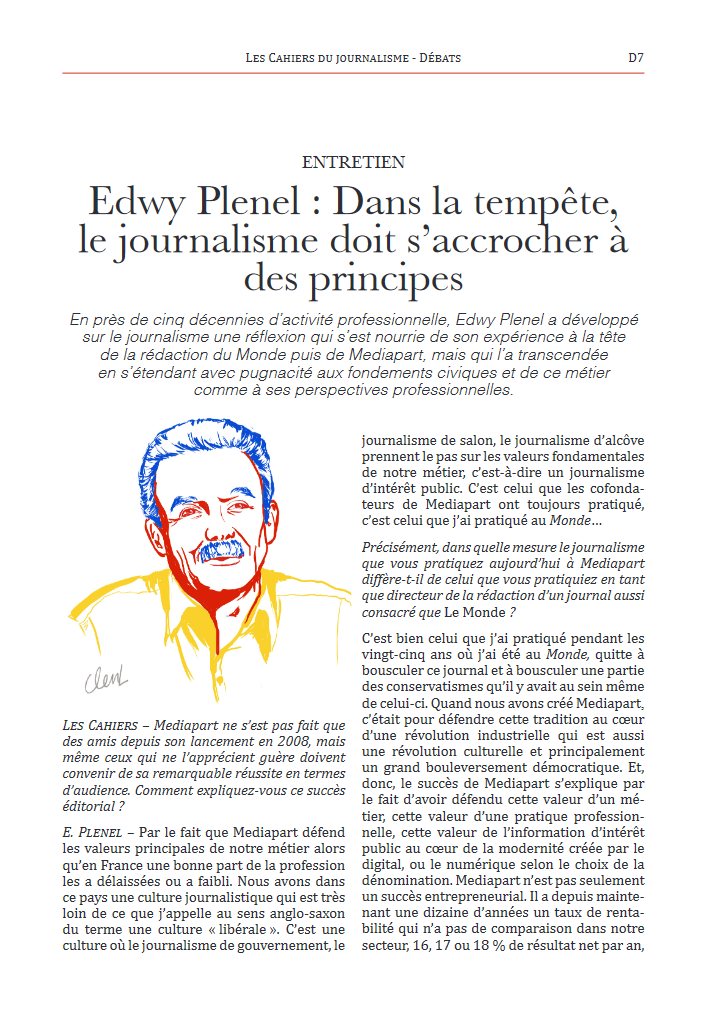 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
ENTRETIEN
Edwy Plenel : dans la tempête, le journalisme doit s’accrocher à des principes
En près de cinq décennies d’activité professionnelle, Edwy Plenel a développé sur le journalisme une réflexion qui s’est nourrie de son expérience à la tête de la rédaction du Monde puis de Mediapart, mais qui l’a transcendée en s’étendant avec pugnacité aux fondements civiques de ce métier comme à ses perspectives professionnelles.

LES CAHIERS – Mediapart ne s’est pas fait que des amis depuis son lancement en 2008, mais même ceux qui ne l’apprécient guère doivent convenir de sa remarquable réussite en termes d’audience. Comment expliquez-vous ce succès éditorial ?
E. PLENEL – Par le fait que Mediapart défend les valeurs principales de notre métier alors qu’en France une bonne part de la profession les a délaissées ou a faibli. Nous avons dans ce pays une culture journalistique qui est très loin de ce que j’appelle au sens anglo-saxon du terme une culture « libérale ». C’est une culture où le journalisme de gouvernement, le journalisme de salon, le journalisme d’alcôve prennent le pas sur les valeurs fondamentales de notre métier, c’est-à-dire un journalisme d’intérêt public. C’est celui que les cofondateurs de Mediapart ont toujours pratiqué, c’est celui que j’ai pratiqué au Monde…
Précisément, dans quelle mesure le journalisme que vous pratiquez aujourd’hui à Mediapart diffère-t-il de celui que vous pratiquiez en tant que directeur de la rédaction d’un journal aussi consacré que Le Monde ?
C’est bien celui que j’ai pratiqué pendant les vingt-cinq ans où j’ai été au Monde, quitte à bousculer ce journal et à bousculer une partie des conservatismes qu’il y avait au sein même de celui-ci. Quand nous avons créé Mediapart, c’était pour défendre cette tradition au cœur d’une révolution industrielle qui est aussi une révolution culturelle et principalement un grand bouleversement démocratique. Et, donc, le succès de Mediapart s’explique par le fait d’avoir défendu cette valeur d’un métier, cette valeur d’une pratique professionnelle, cette valeur de l’information d’intérêt public au cœur de la modernité créée par le digital, ou le numérique selon le choix de la dénomination. Mediapart n’est pas seulement un succès entrepreneurial. Il a depuis maintenant une dizaine d’années un taux de rentabilité qui n’a pas de comparaison dans notre secteur, 16, 17 ou 18 % de résultat net par an, mais ce succès n’est pas seulement un succès économique, c’est un succès journalistique. Et par rapport à ce que vous disiez de certaines réserves à son égard, moi je ne les vois pas ces réserves, car ce que je vois, c’est la popularité de ce journalisme. Mediapart, avec un modèle payant, a en moyenne 5 millions de visiteurs uniques par mois, Mediapart a plus de 200 000 abonnés depuis une année, et donc ce succès dit simplement que ce que nous faisons est au rendez-vous d’une demande sociale, d’une demande d’exigence par rapport à l’information. Les réserves auxquelles vous faisiez allusion sont pour moi celles d’un journalisme de commentaires, de gloses, d’opinion alors qu’il devrait tout simplement saluer la qualité de notre travail, saluer la qualité de nos informations, saluer la rigueur de notre équipe. Voilà comment je ressens les choses.
Il n’en reste pas moins que bien des journaux traitant de longue date de la vie publique dans ce paysage journalistique que vous décrivez comme délaissé conservent des audiences comparables ou supérieures. Face à une offre aussi diverse que celle du Monde, de l’Humanité et des autres quotidiens, mais aussi des hebdomadaires – y compris Le Canard enchaîné qui ne se débrouille pas mal en termes de révélations – quelles sont les spécificités qui lui ont permis de conquérir sa propre niche ?
Je suis en désaccord avec le terme que vous employez : ce n’est pas un journalisme de niche. C’est un journalisme d’intérêt public, dans la tradition de Joseph Pulitzer quand il propose la création de l’école de journalisme de Columbia ou dans la tradition des écrits de Robert Ezra Park. Ce n’est pas un journalisme satirique comme celui du Canard enchaîné, ce n’est pas un journalisme engagé autour d’une force politique comme celui de l’Humanité. Nous nous inscrivons dans cette très longue tradition. Je ne comprends pas que cela puisse faire question. La seule question qui vaille, c’est : est-ce que nos informations sont justes ? Est-ce qu’elles sont d’intérêt public ? Et est-ce qu’elles sont pertinentes ? La seule question est : est-ce que, depuis quinze ans que Mediapart existe, les informations qu’il a publiées ont eu un impact dans la vie publique ? Est-ce qu’elles étaient légitimes ? Et même, pour le dire autrement, y a-t-il d’autres journaux que Mediapart qui depuis quinze ans ont mis sur la table l’envers de la vie publique comme devrait le connaître le public français ? Nous sommes au cœur de cette mission d’intérêt général du journalisme, il n’y a rien d’autre derrière ça sinon ce travail-là. Nous sommes simplement, comme dit Fabrice Arfi, radicalement démocrates : nous sommes au service – comme vous le savez, je l’ai théorisé – d’un droit fondamental qui est le droit de savoir.
Si je me risquais toutefois à ajouter une question qui ne vienne pas de vous, juste pour contribuer à ce portrait, je glisserais peut-être : « Est-ce que ses informations sont équilibrées » ?
Précisez ce que vous entendez par « équilibrées »…
Eh bien… qui, par exemple, présentent les différentes faces d’un sujet sans axiologie sous-jacente opposant a priori des bons et des méchants.
Depuis que je fais ce métier, et c’est autant la caractéristique de ce que j’ai fait en tant que journaliste que ce que fait Mediapart, nous publions des informations qui dérangent l’ensemble du champ politique idéologique, intellectuel, économique de notre pays. Nous n’avons d’autre ligne, comme disait Albert Londres, que la ligne de chemin de fer, c’est-à-dire la ligne du terrain, de l’enquête, de la curiosité. Et quant à l’équilibre, c’est ce qu’on appelle très concrètement le contradictoire : quand nous publions une information, nous recueillons le point de vue, y compris de celles et ceux que ça dérange. Voilà, je ne crois pas que le journalisme, ce soit un balancement entre « d’une main… » et « de l’autre main… ».
Le journalisme c’est ce qui est d’intérêt public : dévoiler des affaires de harcèlement sexuel, révéler l’ampleur de la corruption et l’imbrication des élites politiques et économiques, documenter la réalité sociale de notre pays et aller la voir sans préjugés sur le terrain, lever le lièvre, bien avant les révélations des Panama Papers, de l’ampleur de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale, alimenter de façon très large le débat sur les questions écologiques et les questions qu’elles posent, y compris de conversion et de transition, animer le débat d’idées autour de la remise en cause de principes démocratiques fondamentaux et notamment la question de l’égalité sans distinction d’origine, de croyance, d’apparence. Nous avons un engagement démocratique très clair de ce côté et nous ne revendiquons pas d’autre radicalité que celle-là. Et deuxièmement, nous sommes du côté de la nécessité de contre-pouvoirs : nul hasard si les mêmes forces qui défendent aujourd’hui des hiérarchies d’humanité sont celles, aussi, qui attaquent les contre-pouvoirs. Nous, nous défendons l’indépendance, nous défendons un journalisme indépendant qui n’a de comptes à rendre qu’à ses pairs dans la vie collective d’un journal et qu’à son public. Et c’est pour ça que ça marche, parce que c’est le cœur de notre métier. Nous ne vivons pas d’aides publiques, nous ne vivons pas de mécènes intéressés, nous n’avons pas d’oligarque propriétaire, nous défendons le métier. Il y a une curiosité de notre époque, c’est le fait que ça puisse poser problème à certains. Et si être équilibré, pour reprendre votre question, c’est considérer qu’il est tout autant légitime de défendre les principes des droits de l’homme que d’attaquer le principe d’égalité, en ce sens, oui, nous ne sommes pas équilibrés. Nous sommes du côté de la démocratie, de ses principes, de ses valeurs et de l’universalité de ces principes.
L’un des aspects les plus intéressants du laboratoire journalistique que constitue Mediapart est peut-être sa façon originale de concilier à la fois un positionnement très prononcé – on pourrait parler d’un journalisme engagé, même si c’est envers un idéal démocratique – et une référence extrêmement forte, presque canonique, aux principes journalistiques les plus rigoureux, y compris sa transparence remarquable sur son propre fonctionnement et la dévotion qu’il manifeste envers la recherche prioritaire des faits. Peut-on dire qu’au-delà de son succès commercial, c’est la réunion de ces perspectives journalistiques traditionnellement opposées qui le caractérise ?
Mais il n’y a pas d’autre engagement à Mediapart que celui du Camus de Combat, de Mauriac dans ses éditoriaux de L’Express ou de Beuve-Méry faisant sa conférence en 1956 sur la presse et l’argent. Nous n’avons pas d’autre engagement. Le problème c’est qu’aujourd’hui cela soit ramené par ce regard à une sorte de curiosité. Nous avons tous des opinions, et vous en avez d’ailleurs exprimé vous-même à propos de mon dernier livre avec lesquelles je ne suis pas d’accord1, mais nous n’avons rien à voir avec la presse d’opinion ou partisane. Nous sommes les héritiers de gens qui ont défendu le principe d’une indépendance radicale du journalisme à l’égard des puissances étatiques, idéologiques et financières. Nous ne revendiquons pas d’autre engagement : je vous le redis, notre engagement est, simplement, radicalement démocratique.
Vous disiez un peu plus tôt que vous n’aviez de comptes à rendre qu’au jugement de vos pairs et de votre public. Pourtant, l’équipe de Mediapart a résolument refusé de s’associer au projet d’un conseil de presse, c’est-à-dire d’une structure visant justement à développer une telle reddition de compte. Estimiez-vous que c’était une mauvaise idée en soi ?
Non, ce n’est pas une mauvaise idée en soi, puisque nous connaissons bien les autres exemples qui existent. Le problème c’est le problème de l’écosystème français qui est d’une très faible intensité démocratique : nous sommes le seul pays au monde où l’ensemble des médias privés sont détenus par des industriels extérieurs aux métiers de l’information, qui eux-mêmes sont des puissances économiques qui s’imposent au pouvoir étatique et qui sont imbriqués au pouvoir étatique. Nous sommes le seul pays, la seule vieille démocratie au monde où il y a un système d’aides publiques à la presse totalement perverses, puisqu’aujourd’hui ces aides publiques vont justement à ces milliardaires pour l’essentiel et qu’elles sont délivrées sans aucun critère. Et donc, nous considérons que dans ce contexte les conditions ne sont pas réunies pour un débat déontologique serein. Alors, quand nous disons le jugement de nos pairs et le jugement du public, le jugement de nos pairs c’est d’abord la collectivité d’un journal. Mediapart rend compte de toute sa pratique professionnelle, et le fait dans le cadre d’une collectivité professionnelle qui s’explique, qui a une charte déontologique, qui rend compte dans sa « boîte noire » de ses articles, des questions déontologiques auxquelles elle peut être confrontée, qui donc vit très concrètement l’ensemble de ces débats. Deuxièmement, vis-à-vis de son public, vous l’avez vous-mêmes souligné, Mediapart pratique quelque chose qui, hélas, n’est plus pratiqué, puisqu’un temps ce fut le cas, c’est de publier ses comptes, de s’expliquer sur sa modération dans son club participatif. Et enfin, il y a un troisième juge, qui nous paraît dans notre culture française le juge le plus essentiel, et bien c’est la justice indépendante : nous avons la chance en France d’avoir pour l’instant une jurisprudence sur l’information qui est une jurisprudence qui imbrique le droit à la pratique professionnelle en se fondant sur la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l’enquête, le respect du contradictoire et la modération dans l’expression.
On peut remarquer dans le manifeste de Mediapart, et ailleurs sous votre plume, la très forte influence des penseurs états-uniens, et notamment celle de Kovach et Rosenstiel qui ont fait l’important travail de clarification que l’on connaît sur les principes de journalisme. Est-ce que vous appuyez chacun des « éléments fondamentaux » de ce métier tels qu’ils les explicitent ?
Comme ils ont fait une deuxième édition qui est assez épaisse, je ne sais pas si je pourrais en endosser la totalité, mais il est évident que c’est une démarche qui est tout à fait semblable à la nôtre, qui est encore une fois celle du journalisme d’intérêt public. Et nous voyons bien qu’aujourd’hui, ce qui nous menace nous journalistes et au-delà de nous, c’est la vérité qui est en jeu, la vérité de fait, le rapport à la vérité du débat démocratique, c’est qu’en prenant levier sur les réseaux sociaux et en les utilisant comme caution pour rentrer dans une logique de violence dévastatrice, les grands médias d’information en continu donnent la main au règne des opinions. Et les opinions étouffent l’information. Les opinions, c’est le droit de tout dire, y compris le pire, parce que ça va faire du buzz. C’est ça le danger aujourd’hui : le journalisme est menacé par le règne des opinions.

Edwy Plenel. Photo : Spiralone (fond estompé)
Comment estimez-vous vous-même vous protéger de cette tentation ?
Je ne travaille pas seul, moi, je suis dans un collectif et le métier de journaliste est un métier collectif. Nous gérons notre opinion grâce à notre travail collectif, et c’est pour ça que les aventures individuelles sont souvent des perditions dans notre métier et des égarements. Le journalisme est un travail d’atelier où c’est votre collègue, c’est votre relecteur, c’est l’ensemble de la collectivité qui va veiller à l’honnêteté de votre production. Vous me demandiez quelle était la clef du succès de Mediapart : la clef c’est que beaucoup de gens qui ne partagent peut-être pas nos angles, nos priorités éditoriales, nous font confiance car ils savent que nos informations sont pertinentes, que nos informations sont utiles. Pour moi, le manifeste philosophique de notre métier, c’est l’article « Truth and politics » de Hannah Arendt pour le New Yorker où, justement elle explique la portée radicalement démocratique – radicalement au sens premier du terme : « à la racine » – des truth of facts, les vérités de faits. Donc, le métier, encore une fois , c’est de vérifier, recouper, dénicher, délimiter ces vérités de fait. Et évidemment, les vérités de fait les plus intéressantes sont celles qui ne sont pas en accès libre, sont celles qu’on va chercher, sont celles qu’on va dénicher, sont celles qui vont dessiller, sont celles qui vont faire comprendre des choses. Autrement, il y a des communicants pour ça. Et ça n’a pas d’intérêt : le métier de journaliste, ce qui intéresse, c’est sa plus-value : quelle plus-value va-t-il apporter ? Quelle connaissance va-t-il m’apporter que je n’aie pas ? Ce qui est sidérant, c’est de pouvoir actuellement se dire que le débat sur le journalisme peut mélanger, je le dis brutalement, les torchons et les serviettes, c’est-à-dire des gens qui sont au service des vérités de fait et des gens qui ne sont qu’au service des vérités d’opinion. On peut dire du journalisme ce que François Maspero disait de l’édition : c’est un métier formidable mais c’est une profession pas toujours fréquentable.
De tous les professionnels de l’information que la Terre ait portés, vous êtes sans doute celui qui a écrit le plus de livres sur son métier : une bonne demi-douzaine au bas mot, s’étageant du témoignage réflexif à une théorisation plus ambitieuse du journalisme en général. Quel a été le moteur de ce cheminement ?
Ce qui a changé, c’est peut-être le point de vue d’où je me situe. Jusqu’à la création de Mediapart, moi je suis acteur. Acteur dans une histoire qui n’est pas la mienne, qui est celle d’un journal qui existait, acteur dans ce journal de la défense d’une certaine pratique professionnelle. Donc, je rends plutôt compte de mon travail – comment je fais ça – et les théorisations viennent avec Mediapart. Ce qui a changé c’est peut-être cette théorisation, c’est de mettre des mots sur des concepts, sur une certaine pratique professionnelle.
Est-ce cette réflexion qui a conduit à la création de Mediapart, ou plutôt l’expérience de Mediapart qui a entraîné cet approfondissement ?
C’est l’œuf et la poule. Le fait de penser à Mediapart a été concomitant avec le fait qu’après mon départ du Monde, j’ai enseigné dans deux universités : à Montpellier dans le cadre d’un master « métiers du journalisme » et à Neuchâtel à l’occasion de la création de l’Académie du journalisme et des médias. Dans ces deux universités, j’ai donné des cours, pourrait-on dire, de théorie du journalisme. C’est-à-dire non des cours de pratique du métier mais des cours offrant une vision à la fois historique, philosophique et politique du journalisme, pour lesquels j’ai du travailler et revenir sur certaines notions.
Rien ne vaut décidément la préparation d’un cours pour s’éclaircir les idées…
Voilà. Donc, parallèlement aux « exercices pratiques » de Mediapart, puisque ça s’est chevauché pendant des années, il y a eu ce travail de réflexion. Mon idée est la suivante : je pense qu’on vit des tempêtes, pas seulement des tempêtes journalistiques – elles peuvent être des tempêtes pour la démocratie – et que dans ce moment-là il faut avoir des principes. C’est un peu l’image d’Ulysse attaché par son équipage au mât pour ne pas céder aux sirènes et ne pas se laisser emporter. Ils l’attachent à un principe, c’est le mât, et je pense que dans une période trouble comme celle que nous vivons il faut être au clair sur notre raison d’être et sur les principes qui nous que nous défendons et qui sont les nôtres. Donc c’est comme ça que j’en suis venu à théoriser le droit de savoir, la valeur de l’information, problématiser tout ça avec un laboratoire que j’avais sous les yeux, Mediapart, qui lui-même a grossi et a pris de l’ampleur.
Cette théorisation, informée par votre expérience au Monde puis à Mediapart, vous amène à développer une conception du journalisme à plusieurs facettes : ce métier consiste « tout simplement à apporter aux gens les informations dont ils ont besoin pour être libres et autonomes2 », mais aussi « le journalisme doit choisir son camp3 » : quelle que soit la façon de concilier ces deux propositions, elles paraissent retrancher du journalisme une bonne partie de ce qu’il englobe d’habitude, notamment le journalisme spécialisé. Traiter par exemple des loisirs, ce n’est pas du journalisme ?
Non, non, bien sûr, je n’ai aucun mépris pour ces pratiques. Quand je suis rentré dans ce métier dans les années 1970, j’étais rubricard « éducation » et j’ai même présidé un temps l’APIJ4, association professionnelle qui rassemblait tous les journalistes éducation, du Figaro à l’Humanité. Nous avions des opinions différentes, nous étions dans des journaux qui avaient des orientations différentes, mais nous avions la même culture professionnelle : les règles professionnelles étaient les mêmes et nous avions les mêmes réflexes de défense du métier et de défense de l’indépendance du métier contre les pouvoirs. C’était une chose évidente pour nous. Aujourd’hui, le paysage que nous avons est sidérant. Nous avons, dans ce que j’appelle la gangrène des opinions, un journaliste qui ne vit que des opinions, qui n’a pas de règles professionnelles, qui ne sait pas ce que c’est que vérifier une information, la recouper, la sourcer. Je dis souvent et je l’ai dit contre « mon camp » entre guillemets, c’est-à-dire contre les gens de gauche qui me pensaient des leurs et qui ne comprenaient pas que je publie des informations qui dérangent la gauche, je dis qu’il ne suffit pas de croire que ce que l’on pense est politiquement juste pour informer vrai. C’est même souvent l’inverse ce point de vue.
Votre théorisation de la valeur journalistique est par ailleurs extrêmement critique vis-à-vis de la gratuité : celle-ci est-elle néfaste dans tous les cas ?
Je ne pense pas qu’il puisse y avoir des informations « gratuites ». À partir du moment où vous êtes dans un modèle de la gratuité, qui est celui de la gratuité publicitaire, vous êtes dans un modèle d’audience qui est le modèle de la masse et de la foule. Quelle est la conséquence ? C’est que, évidemment, c’est le modèle du divertissement, des spectacles pour rassembler le plus grand nombre. L’information, ça dérange, ça bouscule, ça divise, ça ne peut pas être spontanément rassembleur et donc c’est pour ça qu’il y a le pluralisme de l’information, qu’il y a des agendas différents. Et donc, si l’on prend le modèle de la gratuité comme le modèle de la chaîne d’information – c’est autre chose sur des médias qui ont des parties d’information rigoureuses tout en ayant comme cœur de métier le divertissement, les films – ce que nous avons sous les yeux avec les chaînes d’information en continu, c’est la destruction de l’information par la gratuité publicitaire. La logique d’audience donne la main à ce règne des opinions. Ça ne coûte pas d’argent de diffuser des talk-shows, du commentaire d’informations qui sont sorties ailleurs, et ça détruit l’information.
Comment votre position s’applique-t-elle à la presse écrite ?
La conception que j’ai concrétisée en créant Mediapart et en étant l’un des premiers à défendre, contre l’idéologie de la gratuité sur le numérique, l’idée que l’information avait une valeur et que ce principe-là ne disparaîtrait pas à cause du digital. Au lancement de Mediapart, la vulgate c’était que l’information serait forcément gratuite sur internet. C’était ce qu’on disait dans les quotidiens, même s’ils ont bien changé d’avis depuis. À l’époque, personne dans la sphère francophone n’avait l’expérience du marketing et de l’abonnement en ligne. Les seules personnes qui avaient cette expérience économique étaient dans le secteur des vidéos pornos ou des sites de rencontres… Et bien aujourd’hui, nous avons eu la confirmation de la valeur de l’information payante par la dégradation du débat public. Nous sommes à un moment où des rédactions ont été brisées : regardez ce qui s’est passé à I-Télé ou à Canal+ quand monsieur Bolloré en a pris le contrôle…
Mais le fait que le modèle payant ait gardé toute sa pertinence n’exclut pas en théorie que de l’information gratuite puisse également être de qualité. Je lis par exemple tous les jours ici un quotidien gratuit de très bonne tenue…
S’agissant de La Presse, vous connaissez mieux que moi sa situation économique : je ne peux pas la commenter.
Eh bien, elle ne se porte pas si mal aujourd’hui, pour ce que j’en sais. Et la gratuité ne l’empêche pas de sortir presque tous les jours des exclusivités d’un grand intérêt public et d’avoir en permanence des dizaines d’enquêtes en cours : ça ne réfute en rien la vertu du modèle payant, mais est-ce que ça n’indique pas qu’il peut y avoir plusieurs voies pour le journalisme ?
En tout cas, dans le cadre de l’expérience française, je vous redis que la gratuité tire vers le bas notre travail et donne la main à ce bruit des opinions par rapport à la nécessité des informations. Peut-être qu’il y a une exception québécoise passionnante à étudier : ce que je retiens moi, en revanche, c’est que le premier point d’entrée de celui qui, aujourd’hui, a une puissance presque oligopolistique sur le monde des médias en France, je parle de monsieur Bolloré, s’est fait par la presse gratuite5 et par une presse qui était une presse purement commerciale. Moi, je suis sur un créneau clair, qui est la presse d’information politique et générale : elle a une valeur, ce qui permet à Mediapart d’être bénéficiaire depuis dix ans, et c’est cette valeur qui nous permet de n’être dépendants de personne d’autre que de nos lecteurs, sans aide publique et sans publicité.
Une autre question qui vous préoccupe beaucoup, notamment dans Le Droit de savoir6, est à juste titre celle de la culture du secret et de l’opacité. Que pensez-vous par exemple de la proposition des députés de La France insoumise d’imposer un devoir légal de répondre aux questions des journalistes lorsque des pratiques d’entreprises sont susceptibles de « porter un préjudice grave pour l’intérêt général » ?
Je ne sais pas, je n’ai pas trop regardé ça parce que je m’occupe d’abord de la vie politique. Peut-être aussi parce que l’expérience me rend moins naïf, je regarde d’abord la pratique démocratique de l’ensemble des forces politiques. Et il est clair qu’en France, celles-ci ont une difficulté à l’égard du contre-pouvoir qui est celui de la presse. Quelles que soient les propositions, et aussi sympathiques soient-elles, c’est au pied du mur qu’on voit le maçon : le respect du pluralisme de la presse, le respect de son droit d’interpellation, le respect de sa curiosité, de son droit d’investigation.
Comment évaluez-vous le retard qu’accuse la France par rapport aux pays nordiques et anglo-saxons en matière d’accès aux informations administratives et gouvernementales ?
Il est totalement documenté. La France n’a pas de Freedom of Information Act. La France a un droit d’accès qui est un droit d’accès contrôlé, contre lequel nous avons déjà régulièrement fait des recours. Le texte de ce droit d’accès nous est souvent opposé et, au lieu d’être direct et simple, il continue à entraver le travail des journalistes.
Nous avons dû aller jusque devant le Conseil d’État pour obtenir des documents auprès de la Commission des comptes de campagne. C’est ce qui nous a permis de révéler des manquements concernant toutes les formations politiques, qu’elles soient de droite ou de gauche. L’obstruction se renforce aujourd’hui avec la loi sur le secret des affaires qui est parfois invoquée dans les refus qui nous sont opposés. Donc ce qu’il faudrait en France c’est la refondation d’une culture démocratique qui passe par notamment l’équivalent d’un Freedom of Information Act.
La profession et le public seraient-ils peu sensibles en France aux enjeux des questions de transparence de la vie publique ?
Moi, vous savez, je n’emploie pas le mot transparence : je préfère parler du droit de savoir comme d’une question dynamique. On a le droit de savoir, donc on doit avoir accès à tout ce qui est d’intérêt public. Le mot transparence est un piège qui nous est tendu dans la mesure où dans les débats actuels, évidemment, ceux qui n’y ont pas intérêt le brandissent comme un excès. Comme si nous voulions tout pénétrer de l’intimité, empêcher que les personnes conservent une part de secrets intimes, alors que nous parlons bien d’un devoir de rendre public ce qui est d’intérêt public, nous parlons d’un droit des citoyens à savoir.
Une autre appellation que vous mettez en question, et qui vous concerne de près, est celle de « journalisme d’investigation ». Parce que c’est une tautologie ?
Là, c’est plus un débat picrocholin en langue française, parce qu’en anglais, investigation journalism veut dire journalisme d’enquête. Et l’idée que l’enquête est au cœur du métier pour moi est une évidence. En français, créer une catégorie « journalisme d’investigation » c’est comme créer une catégorie à part. Alors bien sûr qu’il y a un certain journalisme d’enquête qui affronte des enquêtes plus difficiles que d’autres, plus sensibles que d’autres, plus délicates que d’autres parce qu’il y a du secret à affronter. Mais la culture du journalisme d’enquête, nous avons fait en sorte à Mediapart qu’elle se répande dans tous les secteurs du journal : dans la façon de traiter la politique, dans la façon de traiter l’économie, dans la façon de traiter les questions de société. Voilà, c’est ça que je défends. J’ai toujours été étonné de voir comment un journalisme, j’allais dire de glose, de commentaire, qui se contente d’aller aux conférences de presse et de mettre en scène des déclarations des uns et des autres pouvait nous regarder comme si nous étions une bizarrerie dans le métier. Je pense que nous sommes au cœur de ce métier.
Puisqu’on en est au vocabulaire, diriez-vous aussi que le fact-checking, dont on parle tant depuis une décennie, est également au cœur de ce métier par nature ?
Oui, mais le fact-checking, pour moi vous savez… D’une part, un gros problème est qu’il est financé par les GAFAM. Responsables de la diffusion des fausses nouvelles sans en assumer la responsabilité éditoriale, ils créent par l’argent une drôle d’alliance avec la presse française en finançant ses rubriques de fact-checking. Je trouve déjà ça très discutable et, d’autre part, je vois mon travail autrement. Notre métier, c’est d’abord de produire de l’information : tous ces journalistes qui sont mis à contribution pour fact-checker, je préfèrerais les mettre à contribution pour enquêter. Moi je ne fais pas de fact-checking, je fais un travail fact-checké, c’est-à-dire, vérifié, recoupé, sourcé et je mets mon énergie là-dedans plutôt que dans un rôle de vérification.
Est-ce cette méfiance envers les GAFAM qui vous a fait rejeter la publicité dans l’équation économique de Mediapart ?
Il y a deux raisons qui ont déterminé notre choix initial de l’absence de publicité. Une : la publicité n’a pas trouvé sa place dans l’écosystème de la presse numérique. Dans la presse papier, elle l’a trouvé avec le double filet et le fait que les encarts se distinguent du contenu rédactionnel. Dans la presse numérique, elle est polluante : elle est partout, elle fait des arbres de Noël et elle corrompt la cohérence graphique et éditoriale de ce que nous produisons.
Et tout ça pour bien peu de revenus…
Oui, mais ça vous le dites aujourd’hui. À l’époque, la plupart des projets comme Rue89 comptaient sur elle pour assurer leur gratuité. La seconde raison, c’était que nous, nous allions demander aux gens de nous soutenir et qu’il fallait que le message soit clair. Le message c’était qu’il n’y avait qu’une ressource à Mediapart, c’est vous. Donc, il y a eu une raison de contexte et une raison d’opportunité, mais aujourd’hui il est clair que la publicité ne nous aurait évidemment rien rapporté. Nous sommes encore une fois un laboratoire qui a démontré que la presse pouvait gagner économiquement en ne faisant que du journalisme, en ayant comme seul argument le journalisme. Voici pourquoi on a choisi comme logo un crieur de journaux qui reprend une gravure du XIXe siècle. C’est la recette commerciale du métier. C’est en ce sens que je suis un bon marchand de journaux : partout où je suis passé, j’ai fait augmenter les tirages du titre pour lequel je travaillais. La culture qui fait la réussite de médiateur, c’est celle-là : Demandez la dernière édition ! Lisez la dernière nouvelle ! Dernière édition !

Particulièrement chargé en références historiques, le logo de Mediapart clame sa filiation à la longue tradition de la presse écrite, tout en renvoyant à celui que François Maspero avait choisi pour sa maison d’édition (arrière plan), mais aussi, à travers lui... au soulèvement de la Commune de Paris, dont la gravure d’origine (1871) représentait un moment.
Belle réfutation de la fréquente opposition ingénue entre la dimension civique du journalisme et sa dimension commerciale. Pourtant, Mediapart ne cherche guère à plaire au plus grand nombre : son austérité reflète plutôt votre inspiration péguyste et, si le mot existe, beuvemériste.
Nous sommes du côté de l’austérité de la presse quotidienne, nous ne sommes pas du côté de la presse magazine qui a parfois contaminé celle-ci : les portraits, le style, et cetera, ce qui émousse le côté pertinent, le côté pointu du travail d’information. Avec le numérique, nous pouvons développer des enquêtes très longues – et c’est un autre enseignement important car, à l’époque de notre lancement, la vulgate dominante était qu’il fallait être très court pour ne pas ennuyer – mais on apporte des faits, on va droit au but des faits. Mediapart n’a pas de rubrique sportive, Mediapart n’a pas de rubrique sur le spectacle vivant, Mediapart ne traite pas du divertissement. Mediapart a banni le mot « éditorial » : on y trouve des « Parti pris », mais ce sont des analyses informées, pas des commentaires. Quand vous regardez les enquêtes sur l’impopularité des médias, les gens ne supportent pas ces journalistes qui leur disent ce qu’ils doivent penser, ils ne supportent pas ça. En revanche, qu’ils aiment ou pas la sensibilité supposée de la personne, ils ont plutôt de l’estime pour les journalistes qui leur rapportent des informations.
Mais quand vous apportez de l’information factuelle, ce qui est indiscutable, c’est rarement sans indiquer aussi ce qu’il faut en penser, non ?
Pratiquer le journalisme, c’est marcher sur deux jambes, c’est apporter des informations d’intérêt public et en proposer un sens, en proposer une signification. Ça ne veut pas dire dicter ce qu’il faut en penser, c’est plutôt de faire que le public rencontre une lecture. On lui apporte des faits, mais si on le laisse démuni à l’égard de ces faits, il peut être très perdu, ennuyé, égaré. On lui en propose aussi une interprétation, une analyse, et ensuite elle est en débat.
Votre défiance envers le commentaire par rapport à l’enquête de terrain prend presque un caractère épistémologique puisque, d’une certaine façon, vous l’étendez aux recherches sur le journalisme.
Comment dire… Elles peuvent être pertinentes, cultivées, intelligentes mais elles sont comme un commentaire a posteriori. Vous avez une sociologie critique du journalisme qui commente son résultat, ses contenus : on regarde leur conformisme, leur suivisme, leurs impasses, leurs silences. Une autre sociologie est un commentaire à partir de sources ouvertes : la presse, ses chiffres, ses stratégies et parfois des déclarations de journalistes. L’une comme l’autre peuvent être intéressantes mais ce qui manque, c’est une sociologie vraiment de terrain, de la production journalistique : à la fois comment les entreprises journalistiques la conditionnent et comment les acteurs, les individus, la font. Vous savez que Max Weber avait en 1910 ce grand projet d’une vaste enquête sur la presse. Il est dans une sociologie compréhensive du journalisme, mais ça n’aura pas lieu.
On connaît pourtant pas mal d’études sur le terrain, dont celle de Gans et celle de Lemieux en France pour ne citer qu’elles, et cette dernière relevait clairement de la sociologie compréhensive.
C’est très juste, Mauvaise presse de Cyril Lemieux est une exception remarquable, mais la pratique est tout de même rare en France. Pour prendre l’exemple que je vis, depuis plus de dix ans personne n’a jamais demandé à observer concrètement comment se déroulait l’expérience très nouvelle que constitue Mediapart dans son secteur, ce que l’on pouvait en retirer comme enseignements. Plutôt que de m’interroger, vous auriez d’ailleurs gagné à venir voir ici les gens qui font ce journal.
Sans doute, mais on peut quand même retirer quelques enseignements avec des questions. Par exemple : dans quelle mesure le service journalistique de l’intérêt public peut-il converger avec l’intérêt du public, qui est une réalité assez différente ? Est-ce par la seule vertu de l’intérêt public que l’on pourra informer le peuple, en particulier la population peu diplômée qui, justement, ne s’intéresse pas du tout à la politique ?
Vous partez de l’idée que tout ça s’adresse à des élites et n’atteint pas le grand public, moi je vis l’inverse. Le public des abonnés de Mediapart est beaucoup plus divers socialement, divers géographiquement, divers générationnellement que ce que j’ai pu voir dans la presse que j’appelle traditionnelle. C’est aussi un public particulièrement impliqué dans son journal. Le nom de Mediapart vient de média participatif. Il représente une presse numérique qui est descendue de son piédestal. C’est une presse qui est en dialogue avec son public et c’est une presse qui accepte de ne pas toujours avoir le dernier mot, c’est-à-dire qui encourage ses lecteurs à la critiquer, la disputer, la sermonner, la commenter librement, que ce soit à la suite d’un article ou dans le Club Mediapart où chaque abonné peut créer son blog.
Ce choix est aussi une clef de notre succès, mais il a un coût : la modération se fait a posteriori, en s’appuyant sur une charte de participation très détaillée, elle n’est pas confiée à des prestataires étrangers comme les autres journaux. Nous avons une équipe dédiée aussi bien à la modération du Club qu’à la modération des espaces de Mediapart dans les réseaux sociaux : c’est une dizaine de personnes, mine de rien, qui travaille sur cette dimension communautaire dans le respect de notre culture de débat.
Puisque nous avons tous deux employé la métaphore du laboratoire, votre réussite incontestable dans les essais de phase 2 incite à songer à la phase 3, celle de la généralisation ? En d’autres termes, la recette de Mediapart peut-elle convenir à toute la presse ?
Moi, je suis un artisan, je ne suis pas toute la presse, je suis ce que j’ai fait professionnellement.
Vous êtes trop modeste. L’ambition de vos essais, y compris ce qu’ils prescrivent ou proscrivent, n’a-t-elle donc pas une portée beaucoup plus générale ?
Sa portée générale ne diffère pas de la démonstration concrète qu’apporte le succès de Mediapart : la garantie d’un journalisme de qualité au service de l’intérêt général, au rendez-vous de ses principes et de son utilité sociale, c’est d’être soutenu par ses lecteurs soit par l’abonnement soit par la souscription, et en tout cas d’avoir ce lien, ce pacte avec son public autour de la valeur de son travail et, au-delà, de la valeur démocratique de ce travail. 
Propos recueillis par Bertrand Labasse
1
Recension de La Sauvegarde du peuple (La Découverte, 2020) dans les Cahiers du journalisme – Recherches, 2(5), p. R105-R109.
2Le Droit de savoir, Don Quichotte éditions, 2013, p. 14.
3La Sauvegarde du peuple, La Découverte, 2020, p. 170.
4Association Presse Information Jeunesse.
5Le quotidien gratuit Direct matin, devenu CNews.
6Éditions Points, 2014.
Certains propos ont été synthétisés pour assurer la fluidité de cet entretien.
Les notes sont de la rédaction.
Référence de publication (ISO 690) : PLENEL, Edwy, et LABASSE, Bertrand. Edwy Plenel : dans la tempête, le journalisme doit s'accrocher à des principes. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2021, vol. 2, n°7, p. D7-D18.
DOI:10.31188/CaJsm.2(7).2021.D007






