 |
Nouvelle série, n°8-9 2nd semestre 2022 |
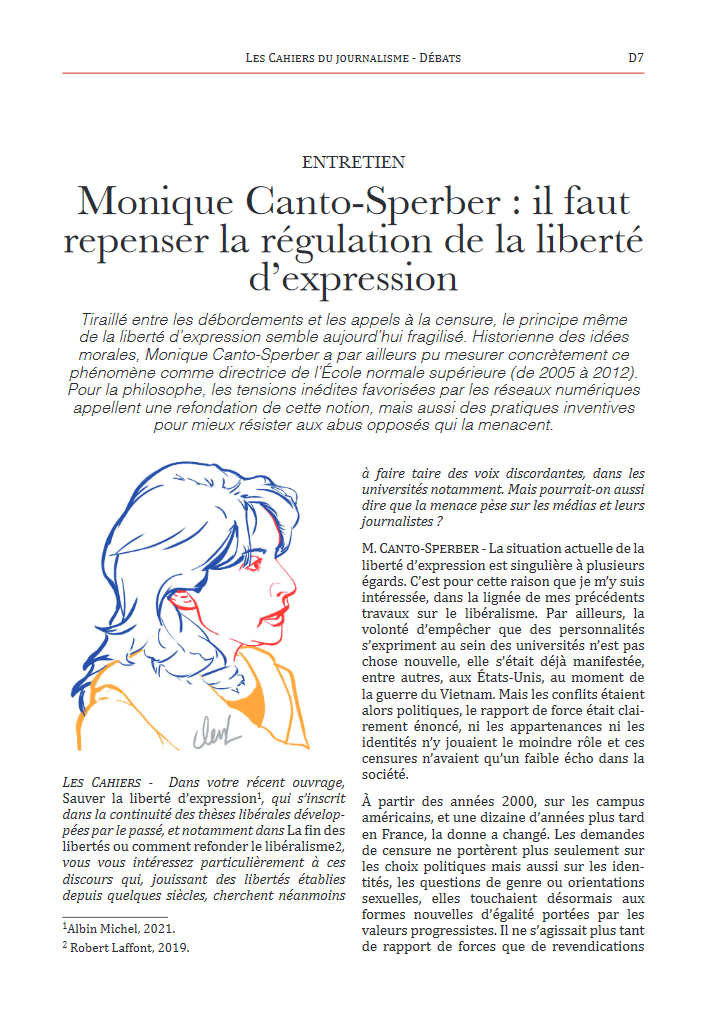 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
ENTRETIEN
Monique Canto-Sperber : il faut repenser la régulation de la liberté d’expression
Tiraillé entre les débordements et les appels à la censure, le principe même de la liberté d’expression semble aujourd’hui fragilisé. Historienne des idées morales, Monique Canto-Sperber a par ailleurs pu mesurer concrètement ce phénomène comme directrice de l’École normale supérieure (de 2005 à 2012). Pour la philosophe, les tensions inédites favorisées par les réseaux numériques appellent une refondation de cette notion, mais aussi des pratiques inventives pour mieux résister aux abus opposés qui la menacent.

LES CAHIERS – Dans votre récent ouvrage, Sauver la liberté d’expression1, qui s’inscrit dans la continuité des thèses libérales développées par le passé, et notamment dans La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme2, vous vous intéressez particulièrement à ces discours qui, jouissant des libertés établies depuis quelques siècles, cherchent néanmoins à faire taire des voix discordantes, dans les universités notamment. Mais pourrait-on aussi dire que la menace pèse sur les médias et leurs journalistes ?
M. CANTO-SPERBER – La situation actuelle de la liberté d’expression est singulière à plusieurs égards. C’est pour cette raison que je m’y suis intéressée, dans la lignée de mes précédents travaux sur le libéralisme. Par ailleurs, la volonté d’empêcher que des personnalités s’expriment au sein des universités n’est pas chose nouvelle, elle s’était déjà manifestée, entre autres, aux États-Unis, au moment de la guerre du Vietnam. Mais les conflits étaient alors politiques, le rapport de force était clairement énoncé, ni les appartenances ni les identités n’y jouaient le moindre rôle et ces censures n’avaient qu’un faible écho dans la société.
À partir des années 2000, sur les campus américains, et une dizaine d’années plus tard en France, la donne a changé. Les demandes de censure ne portèrent plus seulement sur les choix politiques mais aussi sur les identités, les questions de genre ou orientations sexuelles, elles touchaient désormais aux formes nouvelles d’égalité portées par les valeurs progressistes. Il ne s’agissait plus tant de rapport de forces que de revendications pour ainsi dire morales, ceux qui voulaient faire taire leurs contradicteurs semblant sûrs de la justesse de leur position. Ils agissaient au nom d’une forme de bien dont la valeur était, selon eux, supérieure à l’exigence d’un libre débat. Ce ne sont pas ici les valeurs progressistes que je critique, mais plutôt la formulation dogmatique que leur donnent ceux qui les revendiquent, et la façon dont ils voudraient les imposer à tous.
Les journalistes sont constamment confrontés au même problème. Surtout les éditorialistes. Voici un exemple. À la fin du mois de juillet 2020, la journaliste Bari Weiss démissionna de la rubrique « Opinions » du New York Times. Elle voulait par cette décision dénoncer les campagnes d’intimidation dont elle estimait être victime et faire prendre conscience de la suppression progressive de toute liberté de parler : « Si un sujet est susceptible d’entraîner un backlash interne ou sur les réseaux sociaux, le rédacteur fait tout pour ne pas l’aborder. […] La curiosité intellectuelle – sans parler de la prise de risque – y est devenue un handicap. » Ce genre de situation tend à se répandre.
Vous soutenez que la liberté d’expression est prise en otage car elle permet que soient communiqués et cautionnés des « propos abjects » d’une part, tout en étant contestée par des censeurs autoproclamés qui veulent en fixer unilatéralement les limites et les « privatiser » d’autre part. Ce phénomène est-il récent ou bien est-ce surtout que ces censeurs ont aujourd’hui à leur disposition des moyens de communication et des formes de visibilité les rendant plus efficaces ?
La liberté d’expression était autrefois menacée par le pouvoir d’État et les autorités établies, en particulier religieuses. Ce n’est plus le cas dans nos sociétés modernes et leurs gouvernements libéraux. Aujourd’hui, la liberté d’expression est prise en otage par deux mouvements opposés. D’un côté, on assiste, au nom de la liberté, à l’expression la plus extrême de la haine verbale, stimulée par l’extraordinaire diffusion des propos que permettent les outils numériques, ce qui est sans équivalent dans l’Histoire. Les réseaux sociaux constituent un dispositif d’amplification de tous les risques, de tout le mal que la parole peut causer, les tabous y sont pulvérisés.
De l’autre côté, on constate des phénomènes de censure inspirés par des courants sociaux extrêmement forts qui veulent imposer leur conception de ce qu’on peut dire et de ce qu’il faut taire. Les pressions ne viennent plus tant d’autorités constituées identifiables que de groupes ou d’associations qui procèdent par intimidation, souvent de manière préventive, ce qui les rend difficiles à combattre.
Au slogan bien connu « Il est interdit d’interdire » de mai 1968, on semble avoir substitué « Il est interdit de trop dire ». Comment expliquer cela ?
Tout dépend de ce que signifie « trop dire ». Si cela veut dire dépasser les limites, être transgressif sans pour autant violer la loi, on risque d’être victime de ce type de censure. Pourtant la transgression est parfois nécessaire.
À côté de cela, les adeptes d’une parole sans tabou se réclament du noble idéal de la liberté d’expression. Ils veulent pouvoir parler de tout et ne pas se laisser enfermer dans la pensée unique. Mais lorsqu’ils répètent à l’envi « On ne peut plus rien dire », ils ne font souvent qu’asséner leurs certitudes. Revendiquer la liberté d’expression ne leur sert alors qu’à exprimer leur nostalgie de l’époque où leur parole était largement dominante. Elle est ici usurpée pour dédouaner des propos qui sont, souvent, à la limite du racisme et de l’antisémitisme. Toutefois, la réponse judiciaire ne suffit pas : il faudrait plutôt prendre au mot les tenants de la parole libérée, les obliger à détailler leurs arguments, à fournir des preuves de ce qu’ils avancent. C’est encore, je crois, la meilleure façon de priver de portée ce qu’ils disent. Et surtout leur rappeler que se targuer de « dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas » n’est pas, et n’a jamais été, une garantie de vérité, mais souvent une forme d’argument d’autorité.
Vous abordez la théorie des actes de langage de John Austin pour discuter des propos offensants. Selon cette théorie, est-il approprié de soutenir que les individus n’ont pas de raison de qualifier d’offensants des propos qui ne les visent pas personnellement ? Le fait de se dire offensé par des propos qui ne nous mettent pas en cause ne devrait-il pas être considéré comme le problème du récepteur – à sa charge de gérer son ressenti – et non de l’émetteur ?
La parole peut faire mal et réduire l’autre au silence. Dans la tradition libérale, toutes les opinions sont permises sauf celles qui font « un tort objectif à autrui ». Mais ce principe n’est plus suffisant. Le mal que font les injures raciales, par exemple, ne relève pas seulement du tort objectif à autrui, il peut être une atteinte directe aux normes collectives en contribuant à banaliser des préjugés racistes et même à changer le seuil de ce qui est acceptable ou non au sein d’une société.
Il existe aussi des expressions qui, en jouant sur les stéréotypes, les allusions, les références, sont haineuses sans pouvoir être qualifiées d’injures. À l’inverse, des paroles peuvent être transgressives et blesser, mais elles participent néanmoins au débat sans réduire l’autre au silence. Toute la difficulté est de distinguer les « dommages et torts » – par exemple les menaces de mort ou les injures raciales – des « offenses » qui déstabilisent mais n’empêchent pas de répliquer.
Dans ce contexte, la justice est un outil indispensable – surtout avec plus de moyens ! – mais elle ne peut pas suffire. Dans le meilleur des cas, elle dédommage les personnes injuriées, mais elle ne redonne pas la parole à celles qu’on a contraintes à se taire. D’autant que la sanction judiciaire arrive après un long délai alors que les pressions exercées par les réseaux sociaux réduisent au silence immédiatement. Autant d’indices qu’il faut repenser la régulation de la liberté d’expression.
Vous évoquez le cas de régimes libéraux qui pénalisent les fausses nouvelles. Mais n’y a-t-il pas un problème majeur à identifier les fausses nouvelles, c’est-à-dire à distinguer rigoureusement les nouvelles qui contiennent des inexactitudes et erreurs factuelles pour différentes raisons (manque de temps, paresse, sources douteuses, erreurs cléricales, etc.) de celles qui contiennent des erreurs factuelles intentionnelles, dans l’intention manifeste de tromper ? Ne risque-t-on pas d’entraver la liberté de la presse ?
Distinguer en gros une fausse information d’une information exacte n’est pas si difficile, en revanche il est beaucoup plus difficile de justifier cette distinction, et donc de tracer la limite entre la description du fait et l’interprétation qui peut en être faite. Le même problème se pose au sein du langage ordinaire : comment distingue-t-on une injure d’une expression certes offensante mais qui n’est pas à proprement parler une injure ?
Bien des journalistes sont déstabilisés et méfiants devant la violence des réseaux sociaux, alors que vous y voyez une démocratisation radicale de la parole publique. Faut-il espérer un apaisement relatif au fil des années où les citoyens deviendraient moins véhéments, les journalistes moins susceptibles, le dialogue plus civilisé ?
Lorsqu’il est libre, le débat contradictoire peut conduire à une forme d’autorégulation spontanée de la parole. Les contre-vérités, les propos aberrants ou loufoques finissent toujours par être critiqués et neutralisés. Lorsque le philosophe anglais John Stuart Mill définit au milieu du XIXe siècle les règles de la liberté d’expression, peu de personnes avaient accès à la parole publique qui, toutes, qu’elles soient radicales et ou réactionnaires, partageaient les mêmes codes de langage, et le débat était possible.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui dans nos sociétés pluralistes et fragmentées. Le débat public n’est plus vraiment possible, car ce ne sont pas seulement des arguments qui s’affrontent mais aussi des identités. La neutralité du langage comme medium où les opinions opposées peuvent être discutées est remise en cause. Il n’y a pas non plus vraiment de débat sur les réseaux sociaux. Le modèle économique des plateformes est lié à l’usage d’algorithmes qui mettent en avant les messages les plus partagés, souvent émotionnellement très chargés, parfois pleins de colère et de haine. Cela produit une distorsion qui rend impossible le débat, les propos qui rappellent les faits ou font appel à la raison devenant vite inaudibles. La liberté de parler se perd dans la viralité.
En faisant sentir leur présence et peut-être en forçant les journalistes et médias à anticiper les réactions positives ou négatives des publics, les réseaux sociaux sont-ils porteurs d’une autorégulation non étatique ?
À la fin du mois d’avril 2019, le New York Times publia un dessin de presse du dessinateur António Moreira Antunes. Ce dessin proposé par un service de syndication et choisi par la rédaction du journal représentait Benjamin Nétanyahou en chien d’aveugle avec une étoile de David guidant un Trump aux yeux bandés, une kippa sur la tête. Dès sa parution dans les pages « Opinions » de l’édition internationale du journal, les réactions furent si violentes que le journal s’excusa, avant d’annoncer, dans un éditorial paru quelques jours plus tard, sa décision de renoncer définitivement à la tradition de publier un dessin de presse.
Le principal motif avancé à l’appui de cette décision était qu’une telle publication était toujours dangereuse. La vigilance de la direction comme les injonctions de prudence, autrement dit d’autocensure, adressées aux dessinateurs ne suffisaient pas dans la mesure où il pourrait toujours arriver qu’on publiât un dessin qui suscitât des réactions imprévisibles, c’est pourquoi la suppression nette était la seule attitude possible pour éviter pareil risque.
Si le dessin d’Antunes a choqué, ce n’est pas parce que Trump et Nétanyahou y sont présentés comme des personnages grotesques et ridicules prêts à prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient, mais surtout parce qu’il évoque les orientations pro-israéliennes de la politique américaine en mettant une kipa sur la tête de Trump et en dessinant une étoile de David sur la veste de Nétanyahou. Ces signes renvoient à la Shoah, s’inscrivent dans une longue tradition de caricatures antisémites et illustrent la thèse du Protocole des sages de Sion qui fait des Juifs les maîtres du monde.
Toutefois, aussi explicables qu’aient été les réactions à ce dessin, elles ne donnaient en rien une raison de renoncer à la tradition des dessins de presse, qui a contribué à l’identité de l’édition internationale du New York Times vieille de plus d’un siècle. D’abord, parce qu’une publication jugée tendancieuse peut toujours faire l’objet d’explications : un mot de l’auteur, un bref décryptage critique, voire une contrecaricature dénonçant l’usurpation d’innocence qu’il y a à se servir de stéréotypes raciaux tout en prétendant qu’on n’en est pas responsable et qu’on ne fait que les citer.
Le plus inquiétant dans cette histoire est que les responsables éditoriaux reconnaissent ainsi solennellement leur incompétence pour définir ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas pour leurs lecteurs. Ils délèguent cette compétence à un tribunal, le tribunal de l’opinion, qui n’a rien de l’expertise journalistique ou juridique, mais qui est actionné par la pression de l’opinion et surtout de groupes activistes engagés et militants qui, en traquant les propos, veulent imposer leur propre définition de ce qui est acceptable ou non. Pour le dire autrement : ils font de l’autocensure une vertu. Dès lors il n’y a plus de définition partagée, fondée sur des critères précis de ce qui est tolérable, c’est à celui reconnu le plus fort de définir le seuil de l’admissible, le journal ayant admis que sur ce point les réseaux sociaux l’emportent sur sa propre expertise.
Le rôle social et démocratique de certains locuteurs – les journalistes en l’occurrence – peut-il leur accorder des privilèges en matière de liberté d’expression ?
La seule limite légitime est la loi. Maintenant il est certain que les journaux s’imposent à eux-mêmes des limites en fonction de leur politique éditoriale. Le Monde ne publie pas de propos pornographiques, et Libération ne publierait pas sans explication des tribunes d’extrême droite. C’est là une régulation interne. Quant à la sanction de la société, défection des lecteurs ou attaque en règle de la publication sur les réseaux sociaux, ce sont des moyens de pression redoutables sur la liberté des journalistes. Et peu de journaux sont parvenus à rester inflexibles face à cela.
De fait, Charlie Hebdo défend la liberté de blasphémer car sans elle il n’y aurait pas de liberté d’expression. Toutefois, défendre cette liberté ne veut pas dire la promouvoir en toutes circonstances. Charlie Hebdo n’a jamais réclamé sacralisation, unanimité des louanges ou honneur public pour la liberté de blasphémer. Les journalistes de Charlie Hebdo lorsqu’ils se présentèrent à la barre du procès où étaient jugés les complices des meurtriers de leurs amis ne manquèrent pas de le rappeler : ils ne voulaient pas se définir comme des victimes de la liberté d’expression, fût-elle celle de blasphémer, mais comme les cibles d’une croyance mortifère, d’une religion dévoyée3.

Photo : Samuel Kirszenbaum
Quand des communautés cherchent à s’attribuer le droit de décider ce qui sera dit ou non à leur sujet, quels sont les risques pour le journalisme et le droit du public à une information diversifiée et pluraliste ?
Les risques sont réels pour les journalistes, et pour le droit du public à être informé. Mais c’est aux journaux de résister et malheureusement ils résisteront seuls, dans le meilleur des cas avec l’appui de leurs lecteurs, mais ils ne peuvent pas espérer le soutien de l’État.
L’aide publique aux médias menace-t-elle leur liberté, leur autonomie ? Est-ce compatible avec le libéralisme tel que vous le voyez ?
Non pas nécessairement. Tout dépend des contreparties et de la façon de la distribuer. Si elle est donnée pareillement à tous, selon des règles explicites et transparentes, sans clientélisme ni favoritisme de la part de l’État.
La décision de certains pays démocratiques d’interdire la diffusion de la chaine russe RT de leur territoire, décision contestée en France par le Syndicat national des journalistes notamment, est-elle une forme de censure acceptable en régime libéral ?
C’est en tout cas une prérogative de l’État qui s’est donnée comme mission de présenter au public des débats équilibres, même dans les organismes qui ont une ligne politique affichée. CNews est clairement vu comme une chaine de droite mais elle a l’obligation de faire entendre un contre discours. Maintenant je comprends la position du Syndicat national des journalistes et j’aurais préféré une contextualisation de la chaine. Mais il est difficile de la laisser comme telle.
Je cite dans mon livre l’exemple d’un animateur de radio argentin, Baby Etchecopar, responsable d’une émission fort populaire, El Ángel del Mediodía, qui s’est retrouvé devant la justice pour des propos vantant la « discrimination et la violence de genre ». Bien connu pour ses critiques violentes à l’égard des femmes et des féministes, souvent traitées par lui de « féminazis » et de « dégoûtantes », il fut condamné à inviter dans son émission, durant plusieurs mois, des militantes de la cause des femmes et à leur donner la parole pendant une dizaine de minutes au moins, le journaliste n’ayant le droit ni de les critiquer ni de les attaquer, mais seulement l’obligation de parler avec elle.
On pourra sourire de cet antidote, qui substitue à la censure des propos sexistes l’obligation d’une discussion avec des femmes, mais dans le cas cité, il s’est révélé efficace. Doit-on en conclure qu’il faut agir de même envers les racistes et les obliger à parler avec ceux qu’ils stigmatisent ? Peut-être. L’inverse, en revanche, n’est pas vrai : il n’existe aucune obligation de parler à des racistes. Faut-il pour autant les empêcher de parler ? C’est l’une des difficiles questions que pose la liberté d’expression. 
Propos recueillis par Marc-François Bernier4
1
Albin Michel, 2021
2Robert Laffont, 2019
3Cf. Riss, Une minute quarante-neuf secondes, Actes Sud/Charlie Hebdo, 2019.
4Certains échanges ont été synthétisés pour assurer la fluidité de cet entretien.
Référence de publication (ISO 690) : CANTO-SPERBER, Monique, et BERNIER, Marc-François. Monique Canto-Sperber : il faut repenser la régulation de la liberté d’expression. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2022, vol. 2, n°8-9, p. D7-D12.
DOI:10.31188/CaJsm.2(8-9).2022.D007






