 |
Nouvelle série, n°8-9
2nd semestre 2022 |
 |
||
|
RECHERCHES |
||||
|
TÉLÉCHARGER LA SECTION |
SOMMAIRE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
Le journalisme scientifique
à l’épreuve de l’actualité « tout covid » et de la méthode scientifique
Brigitte Sebbah, Université Toulouse 3
Franck Bousquet, Université Toulouse 3
Guillaume Cabanac, Université Toulouse 3
Résumé
Deux ans après l’irruption de l’épidémie de Covid-19 en décembre 2019, quelles représentations des journalistes scientifiques expriment-ils au sujet de leur traitement de la pandémie ? Nous analysons la manière dont ils définissent leurs pratiques et leur identité professionnelle dans un contexte « tout Covid » de l’actualité, marquant la dilatation de leur périmètre habituel d’intervention. Notre étude interroge donc l’exercice de ces pratiques journalistiques face à une temporalité de traitement de l’information accélérée et face à la complexification de l’accès aux sources scientifiques validées et à leurs éventuelles reconfigurations. S’appuyant sur cinq entretiens longs, cette recherche retrace comment le journaliste scientifique a progressivement occupé un rôle central dans le traitement de toutes les informations, tout en posant la question des spécificités de la couverture de la science par rapport aux « manières de faire » du journalisme majoritaire dont l’identité généraliste est de plus en plus affirmée.
Abstract
Two years after the outbreak of the Covid-19 epidemic in December 2019, what representations do science journalists express about their treatment of the pandemic? We analyze the way they define their practices and their professional identity in an "all Covid" context of the news, marking the dilation of their usual perimeter of editorial intervention. Our study thus questions the exercise of these journalistic practices in the face of an accelerated temporality of information processing and the increasing complexity of access to validated scientific sources and their possible reconfigurations. Based on five long interviews, this research traces how the science journalist has progressively occupied a central role in the processing of all information, while raising the question of the specificities of science coverage in relation to the "ways of doing" of mainstream journalism whose generalist identity is increasingly asserted.
DOI : 10.31188/CaJsm.2(8-9).2022.R119
L
e 30 janvier 2020, le Directeur général de l’OMS déclarait une urgence internationale de santé publique vis-à-vis de l’épidémie de Covid-19 en Chine. Le 15 février 2020, il employait le néologisme « infodémie » pour décrire la frénésie médiatique autour de l’épidémie de Covid-19, qui était encore à ce moment-là circonscrite à l’Asie. C’est en effet à une accélération inédite et à un volume d’informations sans précédent et de toutes natures, tout niveau de sources confondues, que les médias ainsi que les citoyens ont été confrontés ensuite pour traiter un « événement monstre » (Nora, 1972) transformé en « fait social total » (Gaille et Terral, 2021). Premier événement de cette ampleur avec une dimension scientifique majeure à se produire à l’heure où les experts en tout genre, bénéficiant de positions institutionnelles reconnues ou autoproclaméees, communiquent tous azimuts et par de multiples canaux, cette crise sanitaire opère comme un révélateur de la place et du statut de la science dans les médias français contemporains. L’exceptionnalité de l’événement a en effet concentré et mis en lumière plusieurs tendances fortes analysées par ailleurs dans la fabrication de l’information : accélération du rythme des publications, poids des sources institutionnelles et de la communication généralisée, personnalisation et spectacularisation de l’information, contraintes économiques liées à la recherche d’audience ou à la ligne éditoriale imposée par les propriétaires de journaux (Tunstall, 1971 ; Schudson, 1978 ; Miège, 1989 ; Charron et De Bonville, 2002). Une catégorie particulière de journaliste fait l’objet du présent article : « le journaliste scientifique » qui se retrouve en première ligne dans la couverture de la pandémie et dont la situation pose la question de ses spécificités et de la place de la science dans les rédactions. Professionnel de l’information travaillant sur des sujets liés à l’actualité scientifique le journaliste scientifique est une catégorie de journaliste spécialisé peu visible dans la presse généraliste. En France, l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI) compte en effet 279 membres en 2021 dont la majorité est pigiste et travaille pour la presse écrite. Nous disposons de peu d’information sur cette catégorie de journaliste tant du point de vue de leur trajectoire professionnelle que de leur formation. En France, en 2022, 12 formations de niveau Master en communication, médiation et journalisme scientifique et parmi eux, un seul parcours est orienté « journalisme scientifique » dans la filière de l’école de journalisme reconnue par la profession, celui de l’ESJ de Lille. Si la spécialité dédiée en journalisme scientifique n’est pas centrale dans le parcours d’un futur journaliste scientifique puisqu’il a souvent un parcours en sciences puis en journalisme, il demeure que sa situation en rédaction tout type de médias confondus, reste peu lisible et souvent diluée du point de vue organisationnel et éditorial dans d’autres tâches et services du média. L’AJSPI souligne que c’est une spécialité mal identifiée dans les médias, voire non reconnue à ses débuts.
Le nombre de journalistes spécialisés (Marchetti, 2002) est par ailleurs en régression dans les rédactions depuis de nombreuses années pour des raisons économiques mais aussi du fait de l’évolution des représentations de cette activité professionnelle au sein même des rédactions. Un journaliste doit pouvoir couvrir toute sorte d’actualité car il est journaliste avant d’être spécialiste de l’économie, du cinéma ou de la science.
Cependant, si, au sein du champ journalistique, certaines spécialisations bénéficient d’une reconnaissance particulière (Neveu, 2019), ce n’est pas le cas des journalistes scientifiques, responsables d’une rubrique annexe, et que l’on ne consulte que rarement quand il s’agit de construire l’agenda du jour. Aujourd’hui ils sont mobilisés sur les questions de changement climatique mais sans avoir pour autant la légitimité au sein des rédactions pour traiter cette question d’un point de vue politique (Comby, 2015). Ainsi dans les conférences de rédaction ce sont les journalistes politiques ou économiques qui détiennent le prestige et les clefs de la ligne éditoriale (Neveu, 2019), même si des cas particuliers existent. C’est le cas du journal Le Monde, dirigé par Jérôme Fenoglio, ancien journaliste scientifique, depuis 2005, dans lequel les questions scientifiques peuvent peser sur la ligne éditoriale.
La formation délivrée par les écoles de journalisme (Chupin, 2018) mais aussi le discours de la corporation (Ruellan, 2011) et les conditions socio-économiques du travail tendent en outre de plus en plus à transformer en profession marquée par une revendication unitaire, une catégorie sociale dont les contours n’ont jamais été vraiment nets et marginalisent par la même la visibilité des spécialisations.
L’un des enjeux soulevés par la situation que traverse le monde depuis mars 2020 du point de vue informationnel est pourtant bien le traitement de l’information scientifique et de ses spécificités ainsi que l’éclairage des multiples questions à dimensions scientifiques qui occupent l’espace public avec une ampleur inédite. Face au déluge de fausses informations, à l’avalanche de preprints1, à l’afflux de controverses dans l’espace public, les modalités de la vérification se sont en effet complexifiées pour le journaliste scientifique (Fraser, Brierly et al., 2021) ainsi que pour les chercheurs (Brainard, 2020). Notre étude interroge donc l’exercice de ces pratiques journalistiques face à une temporalité de traitement de l’information accélérée et face à la complexification de l’accès aux sources scientifiques validées et leurs éventuelles reconfigurations. Nous faisons l’hypothèse que l’exceptionnalité et l’irruption de l’événement a concentré et mis en lumière plusieurs tendances fortes et nous tenterons de l’utiliser comme un révélateur, au sens photographique du terme, du rapport à la science dans la fabrique de l’information mais aussi de l’intégration des journalistes scientifiques aux dynamiques générales de la fabrique de l’information. Notre question de recherche repose ainsi sur deux niveaux : d’abord la place et le rôle des journalistes scientifiques et de la science dans les rédactions et dans la couverture médiatique du surgissement de cet événement ainsi que les éventuels ajustements que l’exceptionnalité de la situation a provoqués ; puis la nature et le traitement des sources mobilisées au nom de la science ou pour rendre compte d’une information au caractère scientifique avéré. C’est par l’intermédiaire de la plongée de ces journalistes scientifiques dans le bain de l’information brûlante que nous ferons apparaître les tensions existantes entre la science et son traitement rédactionnel.
Contexte
Le 12 mars 2020 paraît une tribune des correspondants de médias français en Italie, pour interpeller les médias sur leur retard et les biais de la couverture médiatique ainsi que le gouvernement français pour son manque de réactivité. Entre janvier et mars, en effet, et avant l’allocution d’Emmanuel Macron ce même 12 mars qui a pris les médias de court, les journalistes scientifiques, peu nombreux en rédaction, témoignent d’une difficulté à rendre compte de l’événement en train de se produire. Disposant principalement des données chiffrées quotidiennes du gouvernement, de témoignages non convergents de scientifiques et de centaines de preprints, cet événement semblait résister à leur grille de lecture habituelle. En temps normal, les revues scientifiques évaluées par des pairs composent une partie essentielle du matériau du journaliste scientifique. Cependant, lors de cette séquence ce processus impliquant de multiples allers-retours entre auteurs et évaluateurs sur plusieurs mois n’avait pas encore abouti. Les revues ont tôt rencontré des difficultés pour recruter la pléthore d’évaluateurs experts en coronavirus nécessaire : au moins deux par soumission. En médecine, certaines ont concentré tous leurs efforts sur les articles Covid-19 en mettant en pause (déprogrammant, pour faire le parallèle avec les unités de soin) les soumissions sur d’autres sujets. Ceci a conduit à raccourcir à six jours en médiane le temps entre soumission et acceptation (Palayew, Norgaard et al., 2020). Cette course à la publication d’articles vite évalués par des scientifiques supposés experts (et certainement hypersollicités sur le terrain) a conduit à des taux alarmants et exceptionnellement élevés de rétractions par la suite (Abritis, Marcus et al., 2020).
En parallèle au peu d’études accessibles dans des revues en début de pandémie (parfois derrière une barrière payante), le public et les journalistes scientifiques pouvaient consulter gratuitement une avalanche de brouillons de recherche non validés ou en cours de validation. En 2020, pas moins de 38 000 rapports de recherche non validés et intermédiaires2 ont été produits et rendus accessibles en ligne au sujet du Covid-19. Parmi les 44 serveurs de preprints préexistants couvrant la recherche biomédicale (Kirkham, Penfold et al., 2020), medRxiv et bioRxiv ont concentré la majorité de ces preprints (Fraser, Brierly et al., 2021 ; Oikonomidi, Boutron et al., 2020). Ces preprints offraient une fenêtre sur la science en train de se faire, parfois à l’autre bout du monde car les chercheurs chinois ont réalisé les premiers dépôts en preprint. Chaque internaute-lecteur pouvait alors observer les essais cliniques en cours comme on regarde par-dessus l’épaule des chercheurs auteurs. Certains journalistes ont relayé les conclusions de preprints pour assurer une couverture en temps réel en les présentant comme des « études », terme indifféremment employé pour les articles évalués par les pairs et pour les preprints (non évalués) désormais, un manque de discernement et de précision qui a pu induire le lectorat en erreur.
Méthode et corpus
Nous entendons analyser à la fois les représentations des ressorts du travail de journaliste scientifique par les intéressés eux-mêmes (leurs perceptions des procédures, des formats, de la vérification des sources, de la culture scientifique et de leurs routines), la façon dont cette épidémie a nourri ces pratiques pour diffuser les avancées de la science au grand public et leur vision et définition de la science. Par leurs articles ils participent en effet à construire les représentations de ce qui est une pratique scientifique légitime (Latour et Woolgar, 1979) pour le grand public ainsi que des rapports qu’elle entretient avec la méthode journalistique.
Nous nous appuyons sur cinq entretiens semi-directifs longs avec des journalistes scientifiques en poste en rédaction ou pigistes, issus de médias généralistes (PQN ou PHN) (Le Monde, Libération, Arrêt sur images, Science et Vie, Heidi News) qui ont couvert la pandémie dès le mois de décembre 2019.

Table 1. Les entretiens semi-directifs
L’analyse de ces entretiens a été complétée par d’autres matériaux empiriques tels que des articles de presse, des fouilles de données textuelles pour vérifier les concordances entre les mentions de preprint et les articles de presse et le suivi chronologique de l’émergence de la pandémie. Concernant les fouilles de données textuelles sur la base de documentation d’Europresse, cela nous a permis de repérer des lignes de traitement mais cela ne nous a pas permis d’établir un volume et des modalités d’usages des preprints dans la presse. En effet, la recherche s’effectuant par recherche d’hyperlien ou de mention du titre de l’article preprint, et les journalistes ne mentionnant que rarement le lien hypertexte ou le titre de l’article scientifique, les résultats sont peu significatifs des pratiques que nous avons pu apercevoir manuellement. Un nouveau protocole manuel et statistique basé sur les preprints retoqués par les revues est envisagé sur la base des résultats de cette étude. Notre objectif vise ici par conséquent à enrichir la recherche académique sur la compréhension des dynamiques du travail de médiation scientifique par les journalistes et sur leur rapport à l’épistémologie et à la méthode scientifique, nécessairement historisées (Feuerhahn, 2020), à partir des retours des journalistes sur leurs pratiques lors du moment d’émergence de la pandémie et leur positionnement du point de vue de leur identité professionnelle de « journaliste scientifique » dans un contexte où ils sont soumis durant de longs moins aux contraintes de la construction de l’actualité autour d’un événement monstre.
L’émergence de la pandémie, la couverture médiatique sous pression
L’impossible identification de l’événement
Dans Figaro, Libération, Science et Vie ou Arrêt sur images et dans l’ensemble des rédactions, la couverture du Covid-19 débute de manière irrégulière dès la fin 2019 pour faire suite à l’annonce officielle par les médias chinois d’un premier cluster de cas de pneumonies, à Wuhan, le 31 décembre. Jusqu’à la fin février, cette couverture fait peu montre d’une menace sérieuse pour l’Europe ou pour le reste du monde. Faisant suite à l’OMS déclarant une pandémie mondiale le 11 mars 2020, c’est véritablement à partir du 12 mars et l’allocution télévisuelle du président Macron, alors que « le nombre de cas vient de dépasser les 130 000 dans le monde, avec plus de 4 900 décès » (Viniacourt, 2021), que la couverture erratique du virus va opérer une transformation soudaine pour devenir celle d’une pandémie mondiale. C’est aussi à ce moment que les journalistes enquêtés témoignent d’un premier souvenir douloureux, celui du sentiment d’être passés à côté de cet événement, à « quelques jours près » (I3), dans un « contexte de peur » :
Il y a eu un mélange. L’envie de pas le voir, c’est lié aux autorités qui ne tirent pas vraiment la sonnette d’alarme et qui disent qu’il n’y a pas de soucis « il y a un foyer là, c’est circonscrit ». On est piégés par les autorités qui essaient de calmer les choses. On avait l’exemple de l’Italie. On suivait la même trajectoire (I3).
C’est dans le registre de la croyance, de l’instinct ou de l’intuition que les discours des enquêtés se situent lorsqu’ils évoquent les prémices de la pandémie :
Le 25 février en vacances au Japon, je lis un tweet d’un journaliste scientifique allemand que je respecte beaucoup (une source importante), spécialiste des maladies infectieuses, et il annonce une pandémie mondiale que l’on ne rattrapera plus. J’ai du mal à y croire […] Il n’y avait pas que Raoult qui rassurait. Beaucoup de sources médicales et officielles tenaient un discours rassurant (I5).
Une navigation à vue face à une maladie infectieuse dite « émergente » dont témoigne également une autre de nos enquêtées, pigiste qui a collaboré dans plusieurs rédactions pour couvrir cette pandémie :
Des virus émergents, il y en a souvent, on ne sait pas très bien les évaluer. Je me souviens que pour la grippe H1N1 des experts m’avaient dit que c’était une pandémie qui arrivait et en fait non. Avec le temps, on apprend que c’est difficile de savoir face à quoi on est. On est au tout début d’une situation. Au début je ne sais pas évaluer la situation. Je suis ça comme d’autres choses. Ça commence au fil de janvier, de plus en plus de papiers et on sent que la communication chinoise est un petit peu plus floue et on se dit que ça pourrait être quelque chose (I2).
Un « quelque chose » qui oscille entre le non-événement et l’événement selon le récit des journalistes qui peinent à identifier un point de bascule même rétrospectivement. L’événement contrairement au fait d’actualité, témoigne d’une « rupture dans l’ordre des choses. Rupture qui survient contre toute attente » (Arquembourg, 2003, p. 28). Bousculant un contexte préexistant, il crée donc un vide de sens qui va être comblé par une projection, « son propre horizon » (ibid.), voire une « réduction au fait » lorsque l’observateur ou le journaliste l’inscrivent dans une linéarité causale et reconfigurent un récit. L’événement est fréquemment mis en récit par les journalistes sous l’angle de son horizon lorsqu’il surgit, ou sous l’angle de sa fin lorsqu’il est achevé. Ainsi pour l’affaire DSK par exemple, les journalistes interrogent les causes et les conséquences et l’impact sur la vie politique en cours et l’élection présidentielle (Pignard-Cheynel et Sebbah, 2015) ; de plus, le début du récit est bien identifié dans le temps. Le cycle de l’événement, en un sens, s’inscrit dans une chronologie ouverte vers de multiples fins mais contient une date de départ à partir de laquelle il prend vie. Dans le cadre de notre enquête, ce ne sont pas les causes de l’événement qui font office de grille de lecture rétrospective pour les journalistes ni même seulement la fin de l’événement puisqu’elle est sans cesse repoussée, mais bien plutôt la question de la date de début de l’événement, son jaillissement. L’ensemble des enquêtés témoigne en effet d’une difficulté à le dater tout simplement :
Il y a eu différents moments. Le premier moment où je me dis c’est important, c’est très tôt, c’est quand il y a les cas en Chine et que je demande à une journaliste de faire un papier car je vois que les différents scientifiques disent qu’avec une dizaine de cas, ça peut pas être une origine animale et donc il y a une transmission interhumaine. Je me dis « aïe c’est pas bon ». Mais je suis loin d’imaginer la pandémie et ma consoeur ne me croit pas et m’oppose d’autres sources (I3).
L’un de nos enquêtés indique que le choix est fait de suivre une source d’un correspondant allemand qui annonce cette pandémie, source complétée par celle d’un épidémiologiste qui « fait quelque chose que l’on aurait dû faire nous, journalistes : croiser les courbes italiennes et françaises » (I3). C’est en nombre de jours gagnés que l’enquêté fait alors le décompte rétrospectivement, sans verser non plus dans un satisfecit :
On a tous collectivement un petit temps de retard. Et l’Allemagne bénéficie d’une semaine d’avance. On a eu du mal à prendre la mesure. Ça se joue à quelques jours. On aurait pu 3 jours avant prendre la mesure du truc. Je ne sais pas si ça aurait fait une grosse différence. Je ne m’explique pas le basculement de Macron. Nous on le précède de deux trois jours, pas plus. On dit que c’est quelque chose de grave et que ça va être comme l’Italie (I3).
Précisons ici que, pourtant, l’allocution télévisée du président intervient le 12 mars, le lendemain de la déclaration de pandémie mondiale par l’OMS. La surprise dont témoignent les journalistes fait état plutôt d’un manque de concordance entre les données dont ils disposent, les avis contradictoires des experts mobilisés et du gouvernement, et l’annonce de l’OMS.
Des sources discordantes ou fluctuantes mais aussi le choix éditorial du chef de service qui à ce moment-là s’appuie selon l’enquêté, sur son « instinct de rubricard » (I3) :
Ensuite il y a une deuxième phase où c’est notre chef de service qui a un instinct de rubricard, on est mi-février et il nous dit, vous passez en mode full Covid, vous ne faites plus que ça. On traîne un peu des pieds car je ne veux pas encore voir le truc. On n’y croit pas trop. On se dit que ça va être comme d’habitude. Ça va être comme la grippe H1N1, on tire la sonnette d’alarme mais ça va retomber, c’est ce qu’on se dit (I3).
L’événement « pandémie » a donc bousculé jusqu’au repère temporel de son jaillissement pour les journalistes et aux routines des journalistes pourtant rompus au traitement de l’actualité de type breaking news. C’est une accélération de plus dans un milieu professionnel dont c’est la règle depuis des décennies. La décision de couvrir la pandémie qu’on qualifie encore d’« épidémie » en février, est affaire de flottement et d’hésitation de la part des rédactions de manière générale.
Un sentiment de panique face aux responsabilités : inquiéter ou rassurer
En cause selon les journalistes scientifiques, la dynamique spécifique de cette pandémie et le contexte de peur dans lequel les journalistes ont été précipités, qui a déboussolé le travail journalistique à la fois dans sa mission d’information et à la fois dans son organisation en rédaction. En premier lieu, l’ensemble des enquêtés évoquent l’alternative à laquelle ils se sentent condamnés chaque jour au début de la pandémie, la « sur couverture » ou le « rassurisme ». C’est bien la précision qui est centrale dans leur mission d’information qui fait ici défaut, et ce, dans un contexte d’accélération globale et de demande d’information en temps réel de la part des citoyens. Le risque de la disproportion qui plane sur leur couverture constitue, dans les entretiens, un trait caractéristique commun et central. Nous l’analysons ici du point de vue médiatique non pas seulement selon le volume de couverture mais aussi selon le degré d’intensité dont est chargé le traitement du sujet. D’un côté, les autorités nationales sont plutôt rassurantes, de l’autre, les données sont difficiles à lire au début puisque le décompte est quotidien durant les deux premières semaines de la pandémie. Émerge alors une difficulté, celle de la nécessité de la saisie de la dynamique de la pandémie en temps réel sans verser dans des conjonctures ou des projections insuffisamment étayées :
Je demande à mon rédacteur en chef "est-ce que j’écris que dans 3 semaines, on aura 200 000 morts, si on ne fait rien ? ", ce n’est pas rien d’écrire ça. Aujourd’hui si l’épidémie décroît dans une semaine, on a l’air de quoi si on a dit ça. Je fais ce calcul-là (I3).
Une forme de « radicalisation du temps journalistique » (Hartley, 2013) renforcée par l’imprévu des annonces gouvernementales qui vient perturber un peu plus le travail :
La veille de l’allocution de Macron nous on croit que Macron ne va rien faire et attendre l’immunité de groupe. Il y a un déclic qui se passe, la tonalité de son discours « nous sommes en guerre » c’est ce que me dit un chercheur deux jours avant et la veille. Je suis à des lieues de m’imaginer quand il me dit ça, que le président va dire cela le lendemain. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé (I3).
L’effet de panique semble alors résulter à la fois des difficultés de lecture et d’interprétation des données, de leur rareté, et des revirements du discours gouvernemental, et n’est pas relié au manque de culture épidémiologique ni au savoir-faire des journalistes scientifiques selon leurs propres dires :
Le mouvement de panique dans une crise sanitaire c’est jamais arrivé donc c’est incompréhensible […] Ce que j’analyse aujourd’hui c’est s’il n’y pas eu une sorte de krach politique […] Il y a eu une panique politique (I3).
Plus qu’un tiraillement, une hésitation, c’est bien un dilemme moral qui apparaît dans les récits des journalistes qui font le récit d’un emballement au niveau de leurs pratiques et de leurs médias. Un récit marqué de manière longitudinale par le champ lexical du reportage de guerre : « On a du sang sur les mains » (I5), « on a eu deux ou trois jours de retard » (I1, I5, I3), « c’est criminel » (I4). Ils rejoignent par là le registre de l’émotion que Denis Ruellan et Florence Le Cam décrivent bien dans leur ouvrage (2018). Autant de propos pour évoquer aussi leur frilosité dans la couverture globale et en détail, sur la question des masques notamment :
[O]n se disait bien que porter le masque ne pouvait être qu’une bonne chose, mais on ne l’a pas écrit lorsque le gouvernement au départ n’a pas encouragé le port du masque et faisait face à une pénurie (I3).
Ce retour sur ce qu’ils taxent d’écueils professionnels, laisse voir, dans le même temps, une sorte d’échelle de valeurs dans la représentation de leur métier. De manière transversale aux entretiens, c’est le rôle social du journaliste qui semble mis ici en échec : « [C]’est pourtant à nous de donner l’alerte en avance. » (I5) nous confie l’un des enquêtés. Au-delà de l’identité du journaliste scientifique qu’ils présentent comme une distinction forte par rapport aux pratiques de couverture des confrères généralistes pour la question de la pandémie, les enquêtés rappellent : « [O]n est avant tout des journalistes. » (I1, I2, I3) Deux acceptions de ce qu’est un journaliste prédominent : le lanceur d’alerte et l’humanitaire de terrain, « celui qui peut sauver des vies » (I3). Lorsque les enquêtés évoquent ces missions, ils ne les attribuent pourtant pas à leur spécialité et précisent systématiquement que c’est la définition des missions de tout journaliste, scientifique ou pas : une mission d’alerte et de protection des concitoyens.
Centralité du journaliste scientifique dans le dispositif de couverture des rédactions ?
Avant la pandémie, le journalisme scientifique était un truc qui n’avait aucune importance ; encore en dessous des journalistes culturels… Des journalistes scientifiques enfin assis à côté du rédacteur en chef et pas à côté de la porte des toilettes ce n’était jamais arrivé… (I5).
Pour les journalistes scientifiques que nous avons interrogés, le constat sur leur place est amer. Selon eux, les médias sont imperméables à la science et celle-ci est accessoire dans les choix éditoriaux de la plupart des rédacteurs en chef. En outre, l’un des journalistes déclare même que « la logique de l’événement, de la vitesse et de la personnalisation ne sont pas compatibles avec la recherche scientifique » (I4). Si l’on rapporte la place et le nombre de journalistes scientifiques dans les rédactions françaises, le constat est en effet sans appel. Si l’on excepte les journaux spécialisés tels que La Recherche ou Science et Vie (avant son rachat en juillet 2019 par Mondadori et le départ de la moitié de sa rédaction, partie fonder Epsiloon en 2021), les médias généralistes comptent très peu de journalistes spécialisés en Sciences. En ce qui concerne les médias audiovisuels, la tendance est même à la disparition de cette catégorie, le journaliste étant davantage représenté comme un candide se mettant à la place du consommateur d’information que comme un spécialiste capable d’interroger en profondeur son interlocuteur et d’apporter des éclairages grâce à sa connaissance du sujet. Ainsi Le Figaro et Le Monde, avec des services « Sciences » composés d’une dizaine de personnes font figure d’exception. Le Monde étant encore plus particulier du fait de la présence d’un rédacteur en chef ayant été lui-même journaliste scientifique, ce qui, pour nos renseignants, est le signe d’une attention particulière à la science qui se traduit par la capacité du journal à mettre en haut de l’agenda une information scientifique en dehors des grands événements (telles les COP) qui entraînent tous les médias à développer des sujets scientifiques et à interroger des chercheurs. En revanche, si Le Figaro est plutôt bien doté puisqu’il possède un service sciences et médecine, la ligne éditoriale reste dominée par des considérations politiques, toujours déterminantes lorsqu’il s’agit de rendre des arbitrages éditoriaux. Ce constat est résumé et simplifié par l’un des journalistes interrogés : « [P]lus le média est de masse, moins il y a de science. » (I4) Si les autres rédactions embauchent des journalistes scientifiques, ils sont souvent dédiés aux rubriques de vérification de l’information et aux sujets santé ou sciences mais sans véritable synergie avec d’autres journalistes autour de la question de la science ou de la santé. Cependant, plutôt qu’une réorganisation des rédactions, c’est un brouillage organisationnel qui va se jouer aux débuts de la couverture de la pandémie. Le traitement de la pandémie opère alors comme un révélateur de la place, du rôle et de la représentation du journaliste scientifique dans les rédactions de presse écrite. Les enquêtés nous expliquent qu’il n’y a pas eu de détachement significatif de journalistes d’autres services vers les services sciences ou santé, ni même particulièrement d’embauches alors que le besoin était criant d’avoir davantage de journalistes scientifiques (I3, I1, I4). Ainsi, face à la défiance du public et aux informations trop peu scientifiquement traitées des chaînes d’information en continu notamment, « [i]l aurait fallu mobiliser 4 jours un journaliste pour démonter Raoult, on manquait de temps » (I3), l’ensemble des enquêtés regrettant le temps médiatique consacré à Didier Raoult par exemple : « [O]n savait depuis longtemps qu’il n’était pas une source fiable. » (I5, I3, I2) Et son importance est le reflet du rôle annexe des journalistes scientifiques dans le choix de la ligne éditoriale. Pour ceux que nous avons rencontrés, et cela est attesté par leurs papiers, ils n’ont pas traité Raoult.
La dimension épisodique du traitement journalistique à travers des portraits, des récits de vie, des anecdotes et qui est propre à certains genres journalistiques, tels que les reportages, va entrer ici en conflit avec les enjeux du traitement équilibré et scientifique de la pandémie. C’est même un dilemme habituel du journalisme scientifique selon l’un des enquêtés : « Les journaux ont besoin de personnages. Il faut des héros et des bons clients. La science est un processus collectif mais pour en rendre compte il faut l’individualiser, lui donner un visage. » (I3) Une personnalisation qui explique selon l’un des enquêtés la tribune massive consacrée à Didier Raoult dans les médias : « Raoult a su jouer de ça ; il est devenu le premier visage des médecins prenant parti dans la scénographie autour de l’épidémie. » (I4)
Cet impératif latent du travail journalistique peut révéler la présence de positionnements éditoriaux multiples voire contradictoires au sein d’un même groupe média, tel que Le Figaro par exemple. En effet, si les pages du Figaro Magazine faisaient la part belle au portrait ou aux tribunes de Didier Raoult, si l’édito du quotidien publiait également des analyses sur ce scientifique, le service sciences et santé qui « comptait ne pas en parler ou simplement démonter ses propos » se trouvait donc en porte-à-faux et démenti par les autres publications de son propre média. La difficulté éclate alors pour maintenir dans leurs pages une ligne claire pour le lecteur et pour l’ensemble du média. Cette divergence de lignes est racontée par nos enquêtés à la fois comme le signe de la rémanence de la place annexe des journalistes scientifiques au sein des rédactions et à la fois comme un moteur pour la défiance des lecteurs et le brouillage général informationnel au sujet de la pandémie. En un sens, c’est l’autonomie journalistique elle-même qui est ici en jeu dans cet événement et qui fonctionne comme un révélateur de la compartimentation structurelle et éditoriale des spécialités au sein des rédactions, telles que le journalisme scientifique, même en période de « l’information tout Covid ».
Avec la pandémie, c’est pourtant toute l’information d’actualité qui se teinte ou se réclame de la science du point de vue des angles de traitement et des cadrages. Le périmètre de couverture des journalistes scientifiques va donc s’élargir jusqu’à devenir généraliste : « Le problème c’est que toute information devenait scientifique. » (I3) Les journalistes nous expliquent qu’auparavant ils participaient peu à la ligne éditoriale du journal, ou même aux conférences de rédaction et d’un coup, ils se retrouvent au « centre du village, alors qu’on était en banlieue » (I5, I3) et sont consultés (sans être forcément suivis) ou potentiellement consultables pour tout sujet d’actualité. Toutefois, si l’information nécessitait quasi systématiquement d’avoir un regard sur les sources et de qualifier son degré de validité, « il n’y a pas réellement de discussion au sein du média et entre nous sur la science et la ligne globale ni nos méthodes » (I1). En cause, l’absence de service « on est éparpillés, on ne se parle pas » (I1), ou la place prépondérante de la hiérarchie et du rédacteur en chef qui ne font pas nécessairement de « l’intérêt scientifique, la priorité » (I1, I3). Les journalistes enquêtés réaffirment ici leur statut de journaliste scientifique tout en le différenciant de celui de journaliste généraliste auquel ils sont assimilés durant cette période, du point de vue de la chaîne de traitement de l’information.
Enfin, la place du web en rédaction, et surtout en période de couverture en temps réel, constitue un dernier point d’achoppement dans le récit de nos enquêtés : l’absence de finitude des articles sur le web ajouté à la logique d’audience pousse les journalistes à publier vite, quitte à modifier ou compléter plus tard : « [P]ublier un papier incomplet, tout le monde l’a fait et je l’ai fait, j’aurais dû attendre. » (I4) Cette possibilité de publier en continu qu’offre le web et l’urgence de la couverture propulsent en un sens les journalistes scientifiques, à traiter dans un temps court l’information. Une information en nombre démultiplié au niveau des sujets à traiter, rapprochant leur travail du journalisme de deskeur généraliste. Le temps long et les moyens humains que requiert une telle entreprise ont manqué et représentaient une impossibilité structurelle et journalistique selon l’ensemble des enquêtés. L’un d’entre eux y voit même un révélateur d’une des difficultés du traitement de l’information chaude en général taxant rétrospectivement cette couverture de « mise en échec du journalisme pour traiter de cette info chaude » (I4). Une mise en échec liée à la pression du clic et de la logique d’audience également selon l’un des enquêtés : « [U]n événement tel que celui-ci révèle des fonctionnements au clic qui posent problème » (I4). Publier vite, mais aussi informer en premier avant que d’informer, ce qui constitue une des lois de toute couverture d’actualité chaude comme le souligne l’un des enquêtés : « La loi du publish or perish a fonctionné aussi dans nos rédactions, pas que dans les revues scientifiques à ce moment-là » (I5). De manière transversale, c’est la place du journaliste scientifique et sa mission qui semblent ici empêchées voire invisibilisées et contraintes d’évoluer et de s’adapter dans l’urgence : « [O]n devient tout à coup journaliste Covid plutôt que journaliste scientifique » (I1).
Méthode scientifique versus méthode journalistique
La reconfiguration du travail du journaliste scientifique ? L’information scientifique qui devient généraliste
La déferlante des preprints, durant la période a servi de révélateur à la reconfiguration du rapport aux sources qui était en germe depuis plusieurs années. En effet, le monde scientifique n’est pas à l’abri des contingences sociales. Il a subi, dans son fonctionnement comme dans l’organisation de sa communication de nombreuses évolutions. Tout d’abord les principales revues scientifiques se sont dotées de service de communication qui fournissent aux journalistes identifiés des sujets, des angles et les préparent à la sortie de papiers qu’elles jugent importants. Mais ce sont aussi les instituts de recherche et les laboratoires qui mettent en œuvre de véritables politiques de communication pour mettre en avant leurs études et leurs chercheurs, rentrant de plain-pied dans ce que Bernard Miège appelait la communication généralisée.
Enfin, désormais les scientifiques et les chercheurs, à l’instar de toutes les autres catégories sociales, organisent leur propre communication sur les réseaux socionumériques et en particulier sur Twitter (Ke, Anh et Sugimoto, 2017). Comme les journalistes, les responsables associatifs ou les politiques, ils sont devenus des « entrepreneurs d’eux-mêmes » (Laval, 2014) communiquant sur leur recherche et celles de leurs collègues, distribuant de bons et de mauvais points et participant à la grande conversation de ceux qui estiment avoir quelque chose à dire. Comme indiqué plus haut, le changement majeur de la période a cependant concerné les preprints, répondant à l’urgence de la situation et au besoin d’informations. Comme l’indique l’un des renseignants, les difficultés pour se saisir de ce nouveau moyen de communication scientifique se sont rapidement imposées :
Je me suis pris les pieds dans les preprints. Il y a eu une course à l’échalote sur les preprints. On m’a demandé de traiter les preprints. C’était une mauvaise idée. C’est intéressant pour la discussion entre scientifiques mais je pense que pour que ça rentre dans mon champ il faut que ce soit publié ou quasiment prêt à l’être. Il y a eu une espèce de course à l’échalote entre mars et mai 2020. À y réfléchir a posteriori c’était une mauvaise idée. Ça ne permet pas d’informer le public […] Avant j’utilisais des plateformes de preprints pour chercher des articles mais je suis plutôt vieille école à considérer que ce qui n’est pas publié n’existe pas. Là j’en ai utilisé, je n’aurais pas dû (I2).
Avant la pandémie, prévenu de l’imminence et de l’importance d’une publication par les services communication des grandes revues comme Nature ou par ceux des laboratoires produisant la recherche, le travail des journalistes scientifiques consiste à contacter quelques scientifiques spécialistes du domaine pour voir ce qu’ils pensaient de la publication (évaluée par les pairs scientifiques, au préalable). Un travail de journaliste somme toute classique pour recouper une information et vérifier la validité d’une étude en recueillant l’avis des membres de la communauté élargie dans laquelle elle a été produite. Mais, durant les premières semaines du Covid-19, cette routine est brisée. Une avalanche de preprints déferle et les journalistes étant, comme les autres, enfermés chez eux, ils suivent encore davantage l’un de leurs médias favoris, Twitter. « Les preprints dont on parlait beaucoup sur Twitter on était obligé de s’y intéresser. Ensuite on enquêtait comme avant, on demandait leur avis à quelques personnes fiables », nous déclare l’un des journalistes (I1). Dans ce contexte, les réflexes habituels s’appliquent aux preprints qui connaissent un beau succès sur Twitter, d’après ce qu’il ressort des entretiens :
Tous les canaux d’information étaient bouchés, il y avait un besoin vital de débat et dans l’urgence. Twitter a été idéal pour ça. La conversation entre médecins, journalistes et scientifiques de manière générale s’est vite engagée (I4).
Les journalistes prennent en compte la hiérarchie supposée et estimée des laboratoires, des équipes de recherche et des revues dans lesquels ils ont l’habitude de publier. Mais ils regardent également ce que la communauté en pense sur Twitter (I3, 1, I5) et sur PubPeer, plateforme ouverte d’évaluation post-publication (I5, I3, I2). La force de recommandation du réseau social et de ses utilisateurs est ainsi majeure pour fabriquer l’agenda mais aussi pour vérifier la solidité d’une étude.
Ainsi, bien que les routines demeurent, le réseau d’informateurs est renouvelé, élargi par les réseaux socionumériques qui déterminent aussi de ce dont on doit parler.
L’autre difficulté soulignée était la nouveauté du sujet et la méconnaissance de l’écosystème des bons informateurs. D’après nos entretiens, de nouveaux informateurs se sont imposés avec le temps mais par une sélection médiatisée : « [O]n les a repérés sur les réseaux socionumériques ou dans les autres médias. » (I1, I5) De nouveaux visages sont apparus et sont devenus incontournables pour les journalistes scientifiques. Cette période d’incertitudes est très intéressante car révélatrice de la fabrique de l’information. On a vu se reconfigurer le système de construction et de sélection de l’information sur un sujet. Les journalistes enquêtés s’appelaient aussi entre eux : « [E]st-ce que tu connais un bon spécialiste de la structure des coronas ? » (I1) Ils se demandaient des conseils : « [Q]u’est-ce que tu penses de ce truc sur la nicotine qui protégerait du virus ? … » (I4), donnant corps davantage que d’habitude selon les enquêtés à ce qu’on pourrait nommer une métarédaction composée d’échanges quasi permanents entre journalistes de plusieurs médias. Finalement c’est tout un processus qui qualifie une information de scientifique mais dans ce processus, tous ne sont pas égaux. Tout le monde regarde ce que font les autres. Le grégarisme et la circulation circulaire de l’information, maintes fois dénoncés, sont bien présents. L’agenda est une fabrication collective, intégrant des pressions multiples, mais dans ce cas comme dans bien d’autres concernant le journalisme français, les sources officielles ont joué un rôle majeur.
Le poids des sources institutionnelles et scientifiques au détriment de l’enquête sur la science
Le premier élément apparu dans les entretiens et que l’on peut rapprocher de la prédominance des sources officielles - d’ailleurs très peu citées dans les entretiens, mais évoquées de manière groupée sous le terme de « sources officielles » (OMS, ministère de la Santé et des Solidarités, Conseil scientifique Covid-19, Agences régionales de santé) concerne le caractère très national de l’information en France. Il apparaît en effet que le vivier des sources de nos journalistes semble en grande partie enfermé dans les frontières du pays. En France, ce n’est pas une découverte de notre étude, mais c’est une confirmation concernant l’actualité scientifique, l’information se construit essentiellement avec des sources nationales, qu’elles soient officielles ou scientifiques. Ainsi, selon l’un des renseignants, il existe un « prisme national » (I3) qui jusqu’au dernier moment a empêché de voir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Il nous donne son sentiment sur le début de la pandémie : « Le Covid c’est un truc qui ne nous concerne que de loin, c’est d’abord un virus en Chine puis ça pose problème aux Italiens parce que leur système de santé n’est pas solide. » (I3) La mondialisation des échanges/transports ne semble pas vraiment ancrée dans les représentations des rédactions, pas plus que la vision européenne. Sur ce point les journalistes rencontrés n’ont pas renversé la table et ils en expriment le regret. Ils sont restés dans une grille de lecture française, très révélatrice des imaginaires médiatiques et des représentations que les rédacteurs en chef se font des consommateurs d’informations et que les journalistes épousent de gré ou de force. Il a été très difficile de concevoir une pandémie car la grille de lecture imposée aux rédactions est l’hexagone. Mais ce cadrage national est avant tout un cadrage institutionnel. En effet, le second trait qui émerge de nos entretiens regarde précisément la force des sources gouvernementales et institutionnelles de manière générale aux débuts de la pandémie, dans la couverture journalistique. Les journalistes témoignent de ce poids qui, s’il est couramment relevé dans les recherches sur le journalisme depuis des années, exerce cette fois une pression supplémentaire puisque l’état et les institutions sont à la fois productrices d’un discours mais aussi détentrices des données qu’ils délivrent au compte-goutte et sans méthodologie au départ :
L’épidémiologie sur le plan journalistique c’est quelque chose qu’on n’a jamais fait à ce niveau-là. […] Dans ces moments-là le poids des autorités est très fort, c’est eux qui disent qu’il y a un cluster à tel endroit, qui ont en main les données des tests, on découvre bien plus tard qu’il y a des bisbilles entre les différents CNR [Centres Nationaux de Référence] et les résultats tardent à venir. Ils pilotent ça dans le brouillard. Pour masquer cela, le discours d’accompagnement est très dur à lire, soit ils veulent rassurer pour éviter la panique, soit ils passent à côté du truc (I3).
La production de l’information suit en effet les rouages d’un cadrage qui est double (Esquenazi, 2002) au sens où il est à la fois opéré par les sources mobilisées et par le journaliste. Le cadrage est ici entendu comme des étapes dans la construction de l’information mais aussi comme le fruit d’une mise en récit par le journaliste dans son article et qui ainsi en oriente le sens (Gamson et Modigliani, 1989). Dans le cas de la pandémie, nous retrouvons les signes d’une interaction séquentielle (Entman, 1993) entre plusieurs cadres et agendas (le gouvernement, les experts scientifiques, les citoyens, les agences internationales) et les interprétations liées ou non. Comme le rappelle Manuel Castells, « il est possible que les médias acceptent le cadrage gouvernemental d’un problème mais pas l’interprétation des événements qui s’ensuivent » (2009, p. 159). La qualité de l’information produite est associée par les enquêtés de manière générale à la notion non pas d’équilibre des sources, dont ils rendraient compte pour préserver une certaine neutralité, mais à une recherche de la source la plus crédible et solide qui soit, donc à une certaine objectivité la plus grande qui soit. Cette objectivité relève pour les journalistes avant tout de la mise en œuvre d’une méthode scientifique qui prend finalement, ici, le pas sur la méthode journalistique qui consisterait davantage à rechercher un équilibre en présentant des sources divergentes. Une méthode entravée selon les enquêtés par la rareté des données tout d’abord :
Au début l’autorité qui centralise les cas c’est la DGS [Direction Générale de la Santé], c’est elle qui a les chiffres. Pendant un long moment, fallait attendre le point presse de Salomon [le professeur Jérôme Salomon était alors directeur général de la Santé] pour les chiffres. C’est tout ce qu’on avait. C’est eux qui tenaient le thermomètre. Il n’y avait pas de sources indépendantes. Aujourd’hui on a l’impression qu’il y a des sources indépendantes mais c’est des chiffres mis en open source par le gouvernement donc grosso modo des chiffres de la DGS (I3).
En second lieu, une méthode entravée par la présentation de ces données :
Au début il n’y pas cet effort qui est fait d’expliquer qu’on est sur une exponentielle, on donne vraiment les chiffres au jour le jour en pointant l’augmentation par rapport à la veille, ce qui n’a pas de sens. À l’époque on sait déjà qu’on ne compte pas de la même manière les choses un samedi, dimanche, un jour en semaine. Comparer le samedi où les cas baissent avec un jour de semaine, c’est biaisé. L’AFP comptait les pourcentages quotidiens de hausse, repris dans tous les médias. Mais nous on savait qu’il fallait des moyennes glissantes sur 7 jours, mais dans les 2 premières semaines de l’épidémie, on ne les a pas assez vite, et puis personne ne les crée, et on n’avait pas les tableaux, et on n’est pas très familier de ce traitement-là (I3).
Le « manque d’habitude », « le temps court », autant de freins évoqués par les enquêtés qui se situent dans un travail journalistique réduit à croiser des sources sans pouvoir enquêter dessus tout en pressentant selon leurs dires, qu’il aurait fallu enquêter :
Et puis il y a le temps journalistique, très rapide. Et une exponentielle de ce type-là, un doublement des cas tous les 3 jours, ce n’est pas très compatible avec le temps journalistique. On s’alarme tous les jours de la hausse par rapport à la veille et on perd très vite de vue l’idée qu’on double tous les trois jours, ça paraît très lointain. On ne se projette pas assez. Ce travail d’exponentiel est dur à appréhender pour l’esprit humain. Les autorités qui rassurent, les exponentielles qui nous alarment, on est un peu perdus (I1).
S’en tenir aux sources officielles comme la plupart des journalistes généralistes d’actualité chaude ainsi que l’affaire Dupont de Ligonnès l’a montré (certains médias ont expliqué avoir effectué leur travail en croisant des sources institutionnelles des deux pays mais uniquement de la police3), semble ici un pis-aller inconfortable pour ces journalistes scientifiques. L’affaire du LancetGate (également nommée Surgisphere, voir Piller, 2020) qui symbolise le travail journalistique d’enquête sur la science et donc sur des sources institutionnelles considérées comme solides, représente chez l’ensemble de nos enquêtés, un symbole de ce qu’ils identifient comme un échec dans leur traitement au départ. C’est d’un équilibre gagné dans leurs pratiques dont les enquêtés nous parlent, mis à mal par l’urgence et la dimension rhizomatique du sujet en rédaction. Nous pouvons ici distinguer deux types de pratiques au travers de ces récits, l’une qui est un principe de base du travail journalistique (le fait de trouver et croiser des sources scientifiques) et l’autre qui consiste à enquêter sur ces sources. L’enquête sur la science ne se réduisant donc pas à la recherche de sources solides et à leur croisement. Une enquête qui requiert du temps comme celui qu’ont pris les journalistes de Science Magazine et du Guardian Australie pour contacter les hôpitaux à travers le monde pour vérifier les conclusions d’un article scientifique pourtant peer-reviewed et paru dans une revue prestigieuse, celle du Lancet. Loin d’établir explicitement cette distinction, les enquêtés la formulent pourtant précisément au travers des exemples livrés notamment sur la question de la dynamique de la pandémie : « [O]n n’avait pas l’avalanche de données, on a du mal à voir la dynamique, c’est un décompte quotidien, plus par rapport à la veille mais ce n’est pas opératoire en sciences on le sait. Il faut qu’il y ait un chercheur qui fasse ces courbes logarithmiques et qui m’alerte en fait. » (I5) Qualifier le degré de validité des informations scientifiques selon les enquêtés implique dans leurs pratiques d’« avoir un regard sur les sources » qui finalement semble se distinguer de celui d’une approche journalistique stricte : « [A]ujourd’hui on fait des ateliers pour savoir comment on va traiter la science à Libé aujourd’hui : on se pose la question aujourd’hui en fait. » (I1) Un autre enquêté (I3) confie « on n’a jamais vraiment parlé ensemble du traitement de la science » en évoquant sa rédaction.
Conclusion
La rareté des données scientifiques sur les chiffres et la dynamique de la pandémie, dès son apparition dans l’agenda médiatique et politique, marquée par la multiplication des opinions souvent contradictoires des experts éditorialistes ou scientifiques, semble être pour les journalistes scientifiques, l’occasion d’un constat à la fois d’une certaine marginalité au sein des rédactions mais aussi de la réaffirmation du statut de journaliste en général dans ce qui est implicitement décrit comme le bon fonctionnement de l’espace public. Présentée comme une préoccupation d’une intensité inédite dans leurs pratiques, ils placent d’abord cette pandémie sur le terrain de la maîtrise et de la connaissance du fonctionnement des processus de production et validation des connaissances en sciences. Une maîtrise qui implique de distinguer entre la controverse nécessaire aux avancées de la science et la querelle d’opinions qui a brouillé, masqué et endommagé l’exercice nécessaire de la première. Davantage qu’à une couverture des faits, c’est à une véritable explication didactique des conditions d’avancée de la science que les journalistes ont dû se livrer à la fois auprès de leurs rédactions et du public. Toutefois, compte tenu de la rapidité fulgurante de la pandémie et de l’urgence de publier vite, de la rareté des données, toutes détenues et produites par le gouvernement et les agences nationales au début de la pandémie (et agrégées au niveau mondial par l’OMS), de la place annexe en rédaction des journalistes scientifiques, les discours des journalistes témoignent d’une multiplicité d’entraves ressenties à un bon exercice de leur travail, en mode « reporter de guerre », dominé par l’émotion (Ruellan et Le Cam, 2018), à partir de l’annonce « on est en guerre » du président Macron. À rebours, émerge dans les entretiens une ligne de démarcation entre le travail d’identification, de récolte et de croisement des sources, le travail de journaliste classique, et l’enquête plus approfondie sur la fabrication du fait scientifique, et donc sur le travail scientifique et la constitution des preuves, qui implicitement dans leurs discours apparaît comme la spécificité même du journaliste scientifique.
C’est un véritable conflit de légitimité qui semble prédominer dans les entretiens, ce dont témoigne le registre de la faute professionnelle et morale dont ils usent beaucoup « on a du sang sur les mains » (I3, I5, I1) et qui acte en un sens l’abandon provisoire des référentiels classiques du travail journalistique, des routines en matière de sources, d’un idéal positiviste dans le traitement du fait d’actualité. Il nous paraît ainsi qu’à travers ces discours c’est l’identité d’un journaliste spécialiste de la science, conscient de ses travers (voire de ses lacunes en sciences : biologie, mathématiques [l’exponentielle]) et capable d’évaluer ses procédures qui apparaît). Derrière les affirmations : « Nous sommes avant tout des journalistes », mantra de tous nos renseignants, apparaît par conséquent une autre réalité, implicite celle-là, « nous sommes légitimes car nous connaissons bien la science et que nous sommes en mesure de l’évaluer ».
Ce registre est particulièrement prégnant lorsqu’ils évoquent la temporalité de la pandémie et doit être articulé à plusieurs points aveugles dans les discours des journalistes. En effet, les sources officielles sont évoquées de manière très groupée sans distinguo particulier, la mission d’alerte pour les populations de l’OMS est peu ou pas mentionnée, pour être plutôt présentée comme l’apanage et la fonction première du journaliste qui devient ici un lanceur d’alerte qui aurait failli à cette mission. Derrière cette affirmation, c’est donc aussi la diversité des situations en rédaction, avec des lignes éditoriales prédominantes et parfois contraires au traitement souhaité par le journaliste scientifique, la course à la publication de l’information sur le web et les insuffisances qu’elle autorise via le prétexte des modifications en guise de rattrapage, qui sont en grande partie éclipsées dans les discours des enquêtés. Le discours de la méthode scientifique apparaît finalement comme le référentiel de base de toute une profession pour remplir sa mission d’alerte et d’enquête, au-delà du croisement des sources. Mission que les conditions contemporaines de l’exercice de la profession les empêcheraient de remplir correctement. Ainsi la pandémie ne serait bien qu’un accélérateur ou même qu’un révélateur, comme nous le signalions en introduction, d’une tendance lourde dans la fabrique de l’information, en cours depuis plusieurs décennies. Et ce, sans être forcément identifiée comme la spécialité du journaliste scientifique, qui n’apparaît peut-être que comme le dépositaire et le garant de ce questionnement en rédaction et vis-à-vis du public. 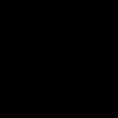
Brigitte Sebbah est maîtresse de conferences à l’Université Toulouse 3.
Franck Bousquet est professeur des universités à l’Université Toulouse 3.
Guillaume Cabanac est maître de conférences à l’université Toulouse 3.
Notes
1Preprint : article de recherche en cours de soumission pour une évaluation par des pairs dans une revue scientifique ou non encore soumis.
2Donnée issue du dépôt logiciel COVID-19 – Preprints de Nicholas Fraser et Bianca Kramer.
3Le Parisien revient sur cet emballement médiatique et produit un article pour expliquer qu’ils ont pourtant croisé cinq sources « de niveau hiérarchique différents » qui semblaient concorder.
Références
Abritis, Alison, Adam Marcus et Ivan Oransky (2020). An "alarming" and "exceptionally high" rate of COVID-19 retractions? Accountability in Research, 28(1), 58-59.
Arquembourg, Jocelyne (2003). Le temps des événements médiatiques. De Boeck Supérieur.
Brainard, Jeffrey (2020). New tools aim to tame pandemic paper tsunami. Science, 368(6494), 924-925.
Castells, Manuel (2009). Communication power. Oxford University Press.
Charron, Jean et Jean De Bonville (2002). Le journalisme dans le « système » médiatique : concepts fondamentaux pour l’analyse d’une pratique discursive. Les Études de communication publique, 16.
Chupin, Ivan (2018). Les écoles de journalisme : les enjeux de la scolarisation d’une profession. Presses Universitaires de Rennes.
Comby, Jean-Baptiste (2015). La question climatique : genèse et dépolitisation d’un problème public. Raisons d’agir.
Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.
Esquenazi, Jean-Pierre (2002). L’ériture de l’actualité : pour une sociologie du discours médiatique, Presses Universitaires de Grenoble.
Feuerhahn, Wolf (2020). Le chercheur et le discours de ses objets. Questions de communication, 37.
Fraser, Nicholas, Liam Brierley et al. (2021). The evolving role of preprints in the dissemination of COVID-19 research and their impact on the science communication landscape. PLOS Biology, 19(4).
Gaille, Marie et Philippe Terral (dirs) (2021). Pandémie : un fait social total. CNRS.
Gamson, William A. et Andre Modigliani (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. American Journal of Sociology, 95, 1-37.
Hartley, Jannie Moller (2013). The online journalist between ideals and audiences: Towards a (more) audience-driven and source-detached journalism? Journalism Practice, 7(5), 572-587.
Affejee, Manuella, Delphine Allaire, Salvatore Aloïse, Olivier Bonnel et al. (2020). Journalistes français en Italie : « Pour que la France prenne enfin la mesure du danger ». Libération [en ligne] liberation.fr, 12.03.2020.
Ke, Qing, Yong-Yeol Ahn et Cassidy R. Sugimoto (2017). A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. Plos One, 12(4), 1-30.
Kirkham, Jamie J., Naomi C. Penfold et al. (2020). Systematic examination of preprint platforms for use in the medical and biomedical sciences setting. BMJ Open, 10(12).
Latour, Bruno et Steve Woolgar (1979). The social construction of scientific facts. Sage.
Laval, Christian (2014). L’entreprise comme nouvelle forme de gouvernement : usages et mésusages de Michel Foucault dans Usages de Foucault. Presses Universitaires de France.
Marchetti, Dominique (2002). Les sous-champs spécialisés du journalisme. Réseaux, 111, 22-55.
Miège, Bernard (1989). La société conquise par la communication. Presses Universitaires de Grenoble.
Neveu, Erik (2019). Sociologie du journalisme. La Découverte.
Nora, Pierre (1972). L’événement monstre. Communications, 18, 162-172.
Oikonomidi, Theodora, Isabelle Boutron et al. (2020). Changes in evidence for studies assessing interventions for COVID-19 reported in preprints: Meta-research study. BMC Medicine, 18(1).
Palayew, Adam, Ole Norgaard et al. (2020). Pandemic publishing poses a new COVID-19 challenge. Nature Human Behaviour, 4(7), 666-669.
Pignard-Cheynel, Nathalie et Brigitte Sebbah (2015). Le live-blogging : les figures co-construites de l’information et du public participant. La couverture de l’affaire DSK par lemonde.fr. Sur le journalisme, 4(2), 134-153.
Piller, Charles (2020). Who’s to blame? These three scientists are at the heart of the Surgisphere COVID-19 scandal. Science [en ligne], science.org, 08.06.2020.
Ruellan, Denis (2011). Nous, journalistes : déontologie et identité. Presses Universitaires de Grenoble.
Ruellan, Denis et Florence Le Cam (2018). Émotions de journalistes. Presses Universitaires de Grenoble.
Schudson, Michael (1995). The power of news. Harvard University Press.
World Health Organization (WHO). Statement on the tenth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. World Health Organization [en ligne], who.int, 19.01.2022.
Tunstall, Jeremy (1971). Journalists at work. Constable.
Viniacourt, Elise (2021). Covid-19 : toutes ces fois où Macron s’est adressé aux Français. Libération [en ligne] liberation.fr, 31.03.2021.
Référence de publication (ISO 690) : SEBBAH, Brigitte, BOUSQUET, Franck, et CABANAC, Guillaume. Le journalisme scientifique à l’épreuve de l’actualité « tout covid » et de la méthode scientifique. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2022, vol. 2, n°8-9, p. R119-R135.
DOI:10.31188/CaJsm.2(8-9).2022.R119






