 |
Nouvelle série, n°1
1er trimestre 2018 |
 |
|
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
ENTRETIEN
Serge July : il n’y a pas d’avenirpour un journalisme moyen
Ce n’est pas un essai, ni vraiment un testament professionnel. Pourtant, le Dictionnaire amoureux du journalisme1 synthétise plus de trois décennies d’observations et de réflexions sur la presse d’un responsable éditorial qui a marqué son histoire.

LES CAHIERS – Vous développez votre regard sur le journalisme au fil d’une mosaïque bigarrée de portraits, de scènes et de remarques. Cette variété, qui s’étend à nombre d’écrivains et d’intellectuels, vise-t-elle à traduire une certaine porosité de ce métier ?
S. JULY – Il s’agit d’un dictionnaire amoureux, donc très personnel. Ce sont des choix subjectifs : ceux d’un autre seraient probablement très différents, surtout s’il n’est pas français. Mais il y a plusieurs façons de concerner le journalisme. Prenez Simenon. J’aime beaucoup Simenon, mais pas pour son travail journalistique qui était banal et parfois indigent. En revanche, je l’ai beaucoup utilisé dans ce que l’on pourrait appeler la formation des journalistes de Libération. Je défendais l’idée – d’ailleurs, ça leur cassait les pieds – de lire une page de Simenon tous les jours : c’est un écrivain sans adjectifs, ou très peu. Très peu de relatives, également.
Va pour le style mais, puisque le mot ne figure pas à la lettre J, on reste tenté de vous demander où vous situez les frontières du journalisme.
Mettre le journalisme en définition, ça ne va vraiment pas de soi. Je le définirais par rapport aux qualités qu’il requiert, et d’abord par la curiosité. C’est en ça que Tintin, qui ne publie jamais, est quand même un journaliste. Par la curiosité et par un rapport – problématique d’ailleurs – à la vérité, qui est toujours en question : quand elle n’est pas en question, ce n’est plus que de la propagande.
Un rapport problématique, en effet : en parcourant votre galerie des grandes figures du reportage, que vous inspire le fait que toutes, sauf peut-être Ernie Pyle, sont également fameuses pour les libertés qu’elles prenaient avec les contingences factuelles ?
Et encore… je n’ai pas tellement parlé de Bodard (rire). Mais n’oubliez pas John Hersey : son reportage auprès des survivants d’Hiroshima n’est pas seulement extraordinaire, il est rigoureusement factuel. Cela dit, il est vrai que la littérature, parfois, emporte le morceau sur l’information alors que c’est l’information qui doit toujours primer. L’idéal, bien sûr, c’est d’arriver à concilier les deux, mais on le trouve peu. C’est pour ça que j’ai de l’admiration pour Hersey. Dans l’autre sens, le journalisme peut rejaillir sur la fiction : ce n’est pas par hasard si tous les réalisateurs qui ont fait de grands films sur le Vietnam, Coppola, Kubrick, se sont inspirés des reportages de Michael Herr.
À propos de bidonnage, vous insistez plusieurs fois sur la tolérance du journalisme français par rapport à celui d’autres pays, notamment anglophones.
Oui, c’est insupportable. Il est vital que les cas de bidonnage ou de plagiat amènent de vraies sanctions. En ce qui me concerne, quand la chose s’est produite à Libération, j’ai veillé à ce que l’intéressé soit viré. Mais je fais plutôt figure d’exception dans ce domaine.
Cela s’est-il passé au grand jour, comme on l’a vu par exemple en Allemagne, au Canada, au Japon et, bien sûr aux États-Unis ? Sinon, pensez-vous que la discrétion pourrait, comme l’absence de sanction, contribuer à préserver la culture que vous dénoncez ?
Ça s’est passé en coulisses, effectivement, et nous n’avons pas non plus eu tellement tendance à dénoncer les problèmes que nous avons pu repérer dans les articles des autres journaux. Mais c’est aussi à chacun de balayer devant sa porte. À Libération, nous avions des règles strictes et très détaillées, et je crois que les chartes comme ça sont très importantes, du moins tant qu’on a les moyens de les appliquer sérieusement.
À quoi attribueriez-vous cette relative désinvolture du journalisme français, ou peut-être latin ?
Pour moi, elle vient des différences profondes entre la culture catholique et la culture protestante. Dans la culture catholique, on se trouve plus dans une logique d’accommodement avec la règle, alors que l’esprit protestant est plus austère. Il faudrait se reporter à ce qu’a écrit Weber. Et puis la culture anglo-saxonne est quand même celle du fait.
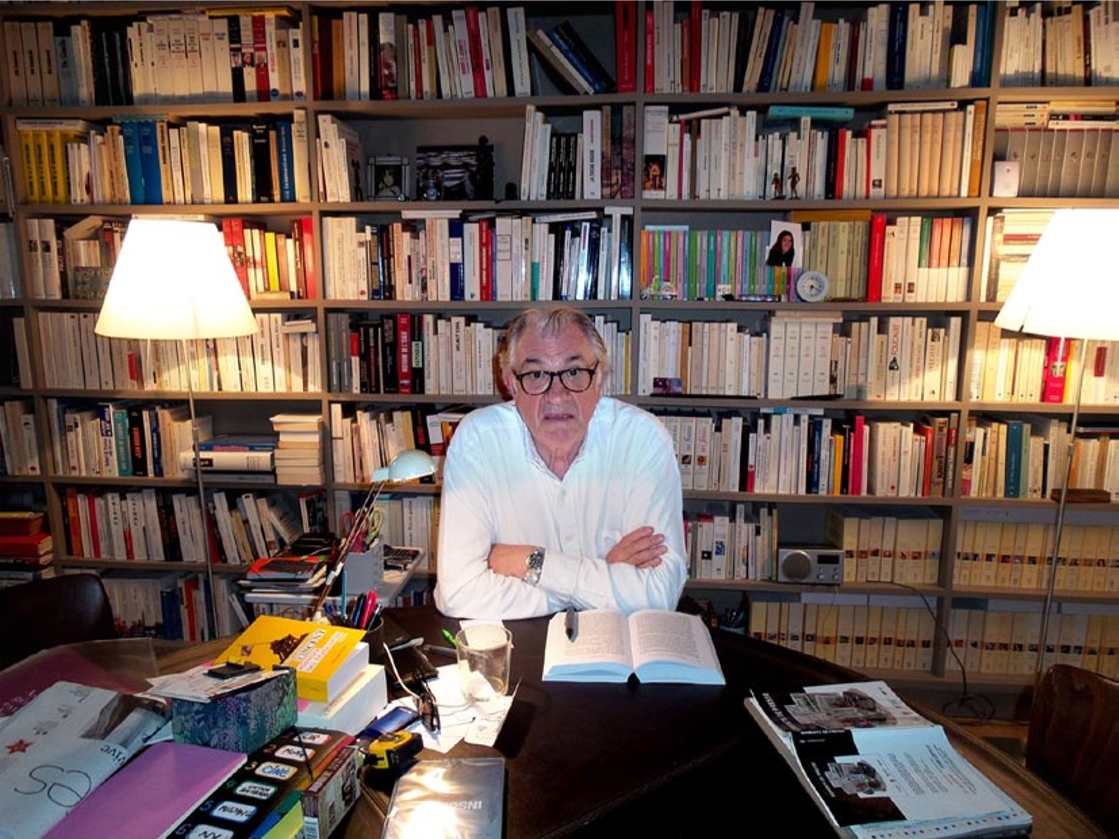
Serge July. Photo : B.L.
Votre regard sur le journalisme s’alimente non seulement de trente années de réflexion éditoriale, mais aussi d’une grande quantité de lectures sur les médias. Cependant, tous ces travaux n’ont pas la même valeur à vos yeux, ainsi Bourdieu…
Mes rapports avec Bourdieu sont compliqués. C’était mon maître de thèse : je ne l’ai pas terminée mais je m’entendais très bien avec lui et j’ai suivi ses séminaires avec passion, comme ceux de Baudrillard et d’autres. L’homme était compliqué, il ne manquait pas de charme, mais à partir de 1995, il s’est radicalisé comme s’il avait à prendre la succession de Sartre en tant qu’intellectuel partie prenante dans le débat social, y compris sur le terrain.
Mais en ce qui concerne la télévision et le journalisme, quelles que soient les objections que ses essais peuvent soulever sur le plan scientifique, peut-on réduire son approche positionnelle des médias au seul fruit d’une blessure d’amour-propre ? N’y trouve-t-on, pour vous citer, que « l’analyse de ses déceptions et de ses échecs dans un petit livre rouge de moins de cent pages » ?
Sur cet aspect, je suis en accord avec ce qu’a écrit Daniel Schneidermann. Mais je ne rejette pas tout dans le fait d’étudier le milieu journalistique, qui peut avoir un corporatisme assez fort, et de voir comment fonctionne cette population. Le cœur de l’argumentaire de Bourdieu, c’est l’opposition entre un petit nombre de journalistes vedettes qui concentrent énormément de choses et un prolétariat journalistique dominé. Comme je faisais évidemment partie de cette aristocratie, j’ai peut-être une réaction un peu… personnelle (rire). Mais c’est devenu un mode d’explication unique pour beaucoup de gens, y compris les jeunes journalistes de la fin des années 2000. Quand j’allais donner une conférence dans une école de journalisme, il y avait toujours un petit groupe très actif qui me chahutait en étant sûr d’avoir tout compris.
À l’inverse, vous érigez Marshall McLuhan en « Einstein » de l’analyse des médias. N’est-ce pas beaucoup dire ?
C’est un visionnaire extraordinaire. Il n’a pas connu internet, il vivait pendant la préhistoire de l’électronique et à partir de cette préhistoire, il a fait une projection qui s’est révélée en partie exacte. Pour quelqu’un qui réfléchissait en fonction de l’électronique de son époque, cette projection est stupéfiante.
Il vous a même conduit à conclure – à propos de la bataille de Marathon – que « tous ces coureurs ont démontré […] que le message, c’était bien le médium ». Pouvez-vous m’aider à comprendre ce point ?
Ah oui… (silence) Bon… Disons qu’ils couraient ! (rire). Mais si vous regardez aujourd’hui l’importance qu’a prise l’expérience vécue dans l’utilisation d’un média par rapport au fond de celui-ci, vous percevez à quel point cette formule et beaucoup d’autres de ses observations sont fécondes. Cela dit, j’évoque aussi son déterminisme technologique et ses reconstructions historiques a posteriori.
Ces transformations des rapports aux médias, le directeur de Libération était aux premières loges pour y assister : comment, sur cette base, voyez-vous l’avenir du marché des nouvelles ?
Il faut d’abord se rappeler que le modèle du journalisme, qui est apparu avec le développement du média presse, est historiquement récent. Les humains ont vécu très longtemps sans journalisme : ça n’a pas toujours existé et, donc, ça pourrait mourir aussi. Mais si ça arrivait un jour, nous serions en piteux état.
Ne pensez-vous pas que, quels que soient les mutations des médias et l’enchevêtrement des concurrences, il y aura toujours un marché solvable pour le journalisme ?
Un marché pour le journalisme, oui. Ce besoin est si réel qu’il s’est manifesté dès qu’il y a eu un peu de démocratie. La question est ce qu’on entend par solvable, et c’est bien là le point essentiel, puisque c’est un produit qui a un coût certain.
D’où l’importance de justifier ce coût vis-à-vis du public, mais celui-ci, à en croire les sondages n’accorde pas une très grande valeur à ce que disent les journalistes.
On a là quelque chose de paradoxal. En France, l’image du journalisme était très valorisée entre les deux guerres, donc à un moment où son éthique était particulièrement douteuse, et elle s’est effondrée à la fin du siècle dernier, alors que sa fiabilité était bien plus élevée. Il y a plusieurs raisons à ça, mais je crois qu’un point important est la montée du niveau éducatif, qui se traduit par une plus forte capacité à critiquer, à vérifier. Chacun a envie de témoigner de sa propre expérience et se sent capable de le faire puisqu’il en a maintenant la possibilité avec les réseaux sociaux.
C’est là un autre paradoxe, puisque, en général, le niveau d’éducation est fortement corrélé à la tendance à apprécier les journaux. Quant aux réseaux sociaux, ils sont largement postérieurs au déclin des courbes de lecture…
Un autre facteur crucial est la forte indexation de la presse avec le statut de la politique, avec la valeur que les individus accordent à la politique et à d’autres structures de médiation comme les syndicats. Les médias sont pris dans un mouvement commun qui frappe toutes les formes de représentation. Et puis les critiques qu’ils ont méritées à certaines occasions, par exemple au moment de la guerre du Golfe même si ça a surtout visé les journaux américains, jouent évidemment un rôle. Sans compter que les gens ne font pas la différence entre les journalistes et tous ceux qu’ils voient s’exprimer sur les plateaux de télévision ou ailleurs. Tout ça, pour eux, c’est « les médias ».
Comment les entreprises de presse pourront-elles selon vous surmonter cette désaffection, surtout conjuguée à la prédation que subissent leurs ressources publicitaires ?
La question de la fiabilité, du fact checking est centrale. Sauf que les gestionnaires et les cabinets comptables engagés par les actionnaires ne voient pas ça. Ces contributions-là, celles qui ne se signent pas, ce sont les premières dont ils coupent les budgets parce qu’ils estiment que ça ne se voit pas.
Pourtant, les recherches montrent non seulement que les taux d’erreurs sont déjà dangereusement élevés, mais aussi qu’ils ont un effet direct sur les ventes.
Oui, mais les actionnaires sont généralement rétifs à ce genre de corrélations. Les difficultés financières conduisent invariablement à des sacrifices, et les sacrifices visent aussi ce qui a trait à la crédibilité.
Alors, comment voyez-vous la suite ? Vous avez eu trente années pour y penser, sans oublier les trois ans consacrés à la rédaction de votre livre.
Oui, mais je n’ai pas la réponse à toutes les questions, pas même à celles que je pose. On est dans un maelström technologique et culturel qui va à une vitesse prodigieuse et ne laisse pas le temps de consolider quoi que ce soit. Il n’y a rien qui se solidifie.
Il se pourrait bien que, face à une production d’information en temps réel devenue robotisée, les journaux deviennent des produits de luxe, comme la haute couture, avec une main-d’œuvre journalistique très qualifiée. Ou comme les bons restaurants, qui survivent très bien face aux chaînes de restauration rapide standardisée.
On perçoit les enjeux civiques d’une évolution où le bon journalisme serait hors de portée de la masse des citoyens, mais quelles seraient les clefs de sa valeur ajoutée ?
En fait, c’est déjà ce qui est en train de se passer : en France, il n’y a plus de presse populaire. La valeur ajoutée, elle peut se trouver dans l’imagination, l’investigation, les angles nouveaux… Je crois beaucoup à la valeur des idées, la multiplication des façons de voir, et aussi à celle de l’écriture, du style. Sans oublier le contrôle des faits et des affirmations. C’est une question d’investissement journalistique, mais ce qu’on voit – et c’est rassurant – c’est que des journaux comme le Washington Post et le New York Times ne dépérissent pas, au contraire.
Ce sont des modèles pour vous ?
Ils confirment avant tout un point essentiel : les très très bons journaux sont rentables. Si on ne veut pas sortir par le bas, on peut sortir par le haut, mais l’entre-deux est condamné : il n’y a pas d’avenir pour la presse routinière. Au Post, Jeff Bezos dit qu’il veut investir beaucoup pour produire le meilleur journalisme possible. Il est le premier à reprendre ce problème par le bon bout. Et le New York Times est certainement le meilleur quotidien de la planète. J’aurais bien aimé le faire.
C’est un peu inattendu si l’on considère que Libération brillait effectivement par le style et par la créativité mais n’adhérait pas de façon très manifeste à l’impartialité que revendiquent ses homologues anglo-saxons.
Ça, ça ne m’aurait pas gêné. D’ailleurs, à partir des années 1980, je l’ai défendu dans le journal. J’en ai même fait un principe de base. Y compris favoriser le fait qu’il y ait en son sein des visions différentes qui s’expriment.
Vous voulez dire différents parfums de gauche ou aussi des approches franchement conservatrices ?
On ne va pas aller jusque-là, mais on publiait souvent côte à côte des opinions opposées – par exemple, sur la guerre du Golfe, celle de Marc Kravetz et la mienne – et on aurait dû le faire systématiquement.
J’ai aussi essayé de faire la chasse aux orientations dans les articles d’information, sinon pourquoi avoir un espace consacré aux commentaires, mais ce n’était pas toujours facile à faire comprendre, surtout auprès des jeunes journalistes.
Que pensez-vous à ce propos de la position de Marcella Iacub, qui attribue, je cite, la « débandade de la presse de gauche » à sa propension à sermonner un « public qui en a marre des prêtres, des instituteurs et des colons déguisés en journalistes » ?
C’est vrai que le prêchi-prêcha, ça ne manque pas : les bons et les méchants, eux et nous… mais si vous écoutez la radio, vous vous dites que les journaux en font beaucoup moins. Et la presse écrite se porte mal, quelle que soit son orientation.
Vous insistez en revanche sur le travail de terrain comme élément crucial de la valeur distinctive du journalisme. Vous êtes même, à l’occasion, plutôt sévère vis-à-vis du journalisme de commentaire, quoiqu’il s’agisse d’un genre que vous maîtrisez plutôt bien.
Oui, je crois absolument que le rapport au terrain, le reportage, l’enquête, c’est central quand on parle de journalisme. Mais ça suppose de mettre de l’argent : les correspondants, ce n’est pas gratuit.
Ce qui pose à nouveau la question de l’investissement, et donc celle de l’actionnariat. Hubert Beuve-Méry a longtemps milité pour une forme juridique destinée à protéger les entreprises de presse. Pensez-vous que quelqu’un s’intéresse encore à ce genre d’idée ?
Personne. Moi, je défends ça, mais c’est passé de mode : il n’y a pas le moindre écho dans la société.
En revanche, l’idée que le coût de l’information commune, à l’instar de ceux de l’éducation ou de la santé, ne puisse plus être assumé par les seules ressources du marché semble faire doucement son chemin. Êtes-vous favorable à une implication plus résolue de la collectivité publique dans son financement ?
Il est sûr que ce n’est pas avec la publicité tirée d’internet que l’on pourra envoyer des journalistes partout où il le faudrait. En France, les rédactions purement web sont d’ailleurs terriblement pauvres elles doivent jongler avec les abonnements, le mécénat, mais c’est très fragile. Ceci étant, je ne crois pas que financer l’information du public comme on finance son éducation ou sa santé soit une bonne solution. Ce serait mettre l’État en situation de contrôler ce que vous lisez.
Mais entre le purement marchand – même quand il est soutenu par des aides minimales – et le purement étatique, n’y a-t-il pas de place pour des conceptions intermédiaires ? Par ailleurs, de nombreux pays, notamment francophones, ont des télévisions et des radios totalement publiques qui sont très loin d’être les porte-parole de leurs gouvernements.
C’est beaucoup plus vrai maintenant que dans les années 1960 où la tutelle était totale, mais l’État garde quand même la main sur les nominations à leur tête, sur leurs budgets et sur leurs possibilités de développement. Bien sûr, il faudrait plus de financement pour le service qu’assurent les journaux, mais il faut aussi qu’ils gardent leur autonomie.
Propos recueillis par Bertrand Labasse
1
Serge July (2015). Dictionnaire amoureux du journalisme. Paris : Plon.
Certains propos ont été synthétisés pour assurer la fluidité de cet entretien.
Référence de publication (ISO 690) : JULY, Serge et LABASSE, Bertrand. Serge July : Il n'y a pas d'avenir pour un journalisme moyen. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2018, vol. 2, no 1, p. D7-D12.
DOI:10.31188/CaJsm.2(1).2018.D007






