 |
Nouvelle série, n°3
1e semestre 2019 |
 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
BONNES FEUILLES
Les radios poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures
Au cours de l’automne 2015, Dominique Payette publie une étude des médias portant sur un phénomène propre à la ville de Québec : les radios d’opinion. Ce rapport critique intitulé L’information à Québec, un enjeu capital, fait la quasi-unanimité contre lui dans la classe politique et les médias. Au printemps 2019, elle persiste et signe avec un essai corrosif1 mais documenté pour mieux expliquer les ressorts de son indignation. Où s’arrête la liberté d’expression ? Morceaux choisis.
Par Dominique Payette
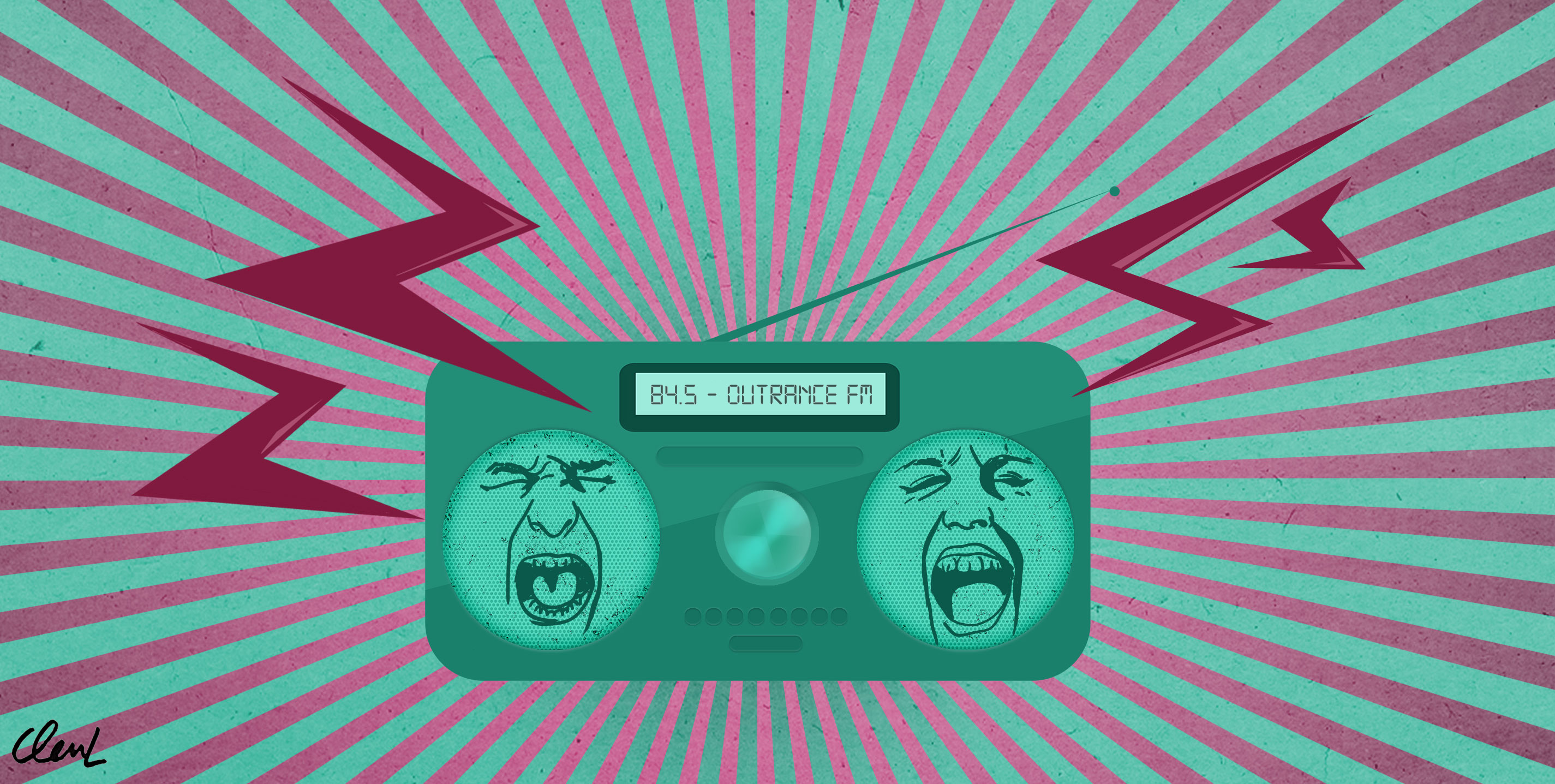
C
ertains animateurs de ces radios n’ont pas apprécié que je fasse état de la peur qu’éprouvaient de nombreuses personnes ciblées sur leurs ondes, soit à titre personnel, soit comme membres de groupes sociaux. Paradoxalement, afin de réfuter ce constat, ces mêmes animateurs se sont moqués de mon apparence physique (certains y allant d’allusions sexuelles), ils ont raillé ma personne, ils ont revendiqué mon congédiement de l’université. Peut-être cherchait-on ainsi à me démontrer qu’il n’y a rien d’intimidant à se faire insulter, dénigrer ou traîner publiquement dans la boue ? Ces insultes, rarement élégantes, ont rapidement débordé les ondes. Elles m’ont aussi été adressées lors de rencontres dans des lieux publics et, bien entendu, par courriel. Par un curieux renversement de perspective, j’étais devenue l’objet de mon objet de recherche. Ça ne manquait pas d’ironie.
« On vous a à l’œil »
L’un des courriels que j’ai reçus m’a particulièrement donné à réfléchir. Ce message, qui a surgi inopinément sur mon écran en fin de soirée, faisait office d’avertissement : « On vous a à l’œil. On va vous écraser comme une punaise. » Je ne suis sans doute pas la première ni la dernière personnalité publique à recevoir des menaces de mort et, en l’occurrence, les policiers n’y ont vu aucune raison de s’inquiéter. « Il n’y a pas de danger réel », m’ont-ils expliqué après avoir retracé mon sinistre messager. L’individu « n’a pas d’arme, aucun antécédent judiciaire, et ne fait pas partie d’un groupe organisé ». Ce retraité de 72 ans avait envoyé sa menace depuis son ordinateur personnel. Autrement dit, il n’avait même pas essayé d’effacer ses traces. Lorsque les policiers lui ont demandé pourquoi il avait posé ce geste d’intimidation, il leur a répondu qu’il l’ignorait, qu’il avait agi sous le coup d’une impulsion. Avec le recul, peut-être trouvait-il même son geste étrange. Je n’étais donc pas en danger, mais je n’étais pas rassurée pour autant.
Un détail dans le courriel m’a paru remarquable. Son expéditeur n’a pas écrit : « Je vous ai à l’œil, je vais vous écraser comme une punaise », mais bien « On vous a à l’œil, on va vous écraser ». Il ne se sentait donc pas investi à titre personnel de la tâche d’en finir avec l’importune que je suis. Il a dû juger que sa colère ne lui appartenait pas en propre, qu’elle participait d’un élan collectif, d’un « nous » quelconque. Bien entendu, cet homme n’est membre d’aucune organisation. Ce « nous » dont il s’est réclamé n’existe pas comme force visible, active, qui aurait pignon sur rue. Son existence est intangible et indéfinissable. Ce « nous », c’est l’image que cet homme s’est faite de la communauté des auditeurs des radios que je mettais en cause dans mon rapport. Une communauté d’esprits échauffés, dont la présence est aussi forte qu’impalpable. Voilà ce « on » qui m’avait à l’œil : une opinion publique colérique, courroucée, mais insaisissable.
De nombreuses personnes se sont étonnées que je me penche à nouveau sur ce sujet. « Tu t’es pourtant bien fait lyncher la dernière fois. À quoi bon ? » La réponse courte à cette question, c’est Michel Juneau-Katsuya, ancien agent du renseignement, qui me l’a fournie : parce que « le silence fait partie du problème ». Il est très difficile de délier les langues au sujet des violences verbales des animateurs de radio, les gens préférant ne pas s’attirer leurs foudres. Les journalistes, qui plus est, ne sont pas enclins à exiger qu’on enquête sur leur milieu, ou qu’on réglemente les entreprises qui les embauchent. Les politiciens, eux, marchent sur des œufs. Tout le monde a ses raisons de se censurer et d’estimer raisonnable de tolérer ce genre d’excès. La dégradation du discours public et la prolifération des informations douteuses sont le fait de ceux qui en sont à l’origine, mais aussi de ceux, très nombreux, qui s’en lavent les mains. Combien faudra-t-il de jugements du Conseil de presse du Québec condamnant les propos haineux, de pétitions, de cris d’alarme, combien faudra-t-il de menaces et d’appels à la violence pour que les gens sensés sortent un jour de leur torpeur ? Ce texte n’apporte pas de réponse à cette question. Il n’offre aucune solution miracle aux problèmes qu’il met en lumière, mais il espère montrer ce qu’il nous en coûte à tous de les ignorer. Nous devrions avoir ce « on » à l’œil !
L’attentat de la mosquée
Le 29 janvier 2017, un jeune homme faisait irruption dans la grande Mosquée de Québec et ouvrait le feu sur une quarantaine de fidèles en prière. Cette soirée d’hiver, qui s’annonçait paisible et propice au recueillement, a tourné au cauchemar : six personnes sont tombées sous les balles, huit autres ont été blessées, dont six gravement. La ville de Québec était abasourdie. Assurée de sa sérénité et de sa quiétude, elle s’estimait à l’abri de telles atrocités. Était-on trop candide ? La communauté musulmane, bien que tout aussi frappée de stupeur, tombait sans doute un peu moins des nues. La tuerie jetait un éclairage lugubre sur un sentiment d’inconfort qui lui était devenu familier. Celui-ci s’était subrepticement installé parmi ses membres depuis qu’une série de gestes agressifs et haineux avait été posée à leur égard. Des actes dont la portée anxiogène se trouvait étendue et amplifiée par de durs propos tenus à répétition sur les ondes radiophoniques de la capitale.
Les statistiques révèlent l’existence d’une hausse marquée des crimes haineux au Québec en 2016, et tout particulièrement dans la région de Québec. Les 57 cas qui y ont été recensés au cours de cette année-là représentaient le double de l’année précédente. Une tendance qui s’est maintenue puisque 71 cas ont été signalés en 2017, une année record pour la région. La capitale québécoise avait en 2016 un taux de 7,1 cas de crimes haineux par 100 000 habitants. C’est bien davantage que Montréal, où l’on a enregistré 4,7 cas par 100 000 habitants pour la même période. Il n’existe sûrement pas une seule et unique explication à cette différence entre les deux villes, mais quoi qu’il en soit, il est difficile de ne pas tenir compte des contenus hargneux diffusés par les radios de Québec, surtout qu’ils n’ont pas leur équivalent à Montréal.
Québec aime néanmoins se présenter comme une ville tranquille, sans risque, où il fait bon vivre. En 2008, lors d’un voyage en Europe, le maire Labeaume rappelait qu’aucun meurtre n’avait eu lieu dans sa ville l’année précédente. Une situation évidemment enviable en Amérique du Nord, où le nombre de morts par homicide est effarant. Aussi, l’attentat du 29 janvier 2017 a d’abord suscité de la surprise. « Stupéfaction à Québec », lançait l’animateur de la Première chaine de Radio-Canada, Claude Bernatchez. « Ce n’est pas Québec », pouvait-on entendre et lire sur des affiches lors de la manifestation de solidarité qui s’est rapidement constituée devant la mosquée après l’attentat. Puis, on s’est questionné. N’y avait-il pas un contraste étonnant entre la tranquillité présumée de la ville et son appétit pour les propos aussi véhéments que tonitruants de ses radios privées ? Comment une telle sérénité pouvait-elle engendrer tant de passion pour la parole emportée de ces animateurs de radio ?
Il existe à Québec « un climat délétère », a écrit dans la foulée de l’attentat le journaliste Marc Cassivi, qui a pris soin de préciser que ce climat est alimenté par des « discours d’intolérance désinhibée », relayés en outre par des « figures médiatiques ». Les mots, souligne le philosophe Victor Klemperer, « peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir ». Sans qu’on y prenne garde, leur effet corrosif mine l’esprit public. Or, de tels mots toxiques, on en avait proférés beaucoup à Québec au sujet des musulmans, et de longue date.
Si ces radios se sont retrouvées sur le banc des accusés dans les jours qui ont suivi cette tuerie, on ne peut pas dire qu’elles ont été sérieusement mises en cause. Ces jours-là, on avait l’étrange impression qu’il n’eût fallu que d’une intervention ferme et décidée, ne serait-ce que d’une seule personne en position d’autorité, pour qu’une vague de critiques déferle et qu’on exige enfin de ces animateurs qu’ils rendent des comptes. Ce déclic n’est jamais survenu. Pourquoi donc ? L’hypothèse la plus vraisemblable est que tous les élus savent ce qu’il en coûterait – en vexation, raillerie, attaques en tous genres – s’ils s’en prenaient de front à ces individus. Il est parfois plus facile de laisser les loups hurler. Mais n’est-ce pas oublier que celui qui ne dit mot consent ? Une autre hypothèse, plus troublante, serait que bien des élus de la région de Québec, habitués de ces émissions, ne trouvent rien à redire aux discours qu’on y tient.
Le débat politique reste à faire sur cette question, et il commence à être temps qu’on trouve le courage de l’engager. Tout au long du XXe siècle, on a continué à croire que les contenus des médias généralistes étaient tempérés par d’autres sources d’influence. Mais aujourd’hui, partout en Amérique, les médias ont changé, et notre manière de les fréquenter aussi. Les radios dont on parle ici sont des médias orientés politiquement, qui misent essentiellement sur la mobilisation émotive de leurs auditeurs. On les écoute parce qu’on s’y retrouve idéologiquement. On doit les juger comme des vecteurs non pas d’information, mais de propagande, destinés à persuader et à mobiliser leurs auditeurs.
Des radios partisanes
À l’époque, la radio privée de Québec avait déjà des opinions politiques tranchées, mais elle n’était pas encore fortement marquée par son engagement idéologique. Elle se contentait d’être bête et méchante. Se pose alors la question suivante : comment le populisme de droite en est-il venu à dominer le contenu de ces ondes radiophoniques ? Comment le militantisme politique est-il devenu leur marque de commerce ?
Ces radios ne sont devenues que progressivement des fers de lance du populisme de droite. La première expression de cette nouvelle orientation a été la grande manifestation de l’été 2004. Il s’est ensuite développé une sorte de symbiose entre Radio X – menacée de fermeture par le CRTC – et l’Action démocratique du Québec (ADQ), le parti de Mario Dumont, qui se trouvait à l’époque en position de faiblesse. Mario Dumont n’avait fait élire que quatre députés en 2003 et son parti stagnait dans les sondages. L’ADQ a alors choisi de miser sur la colère d’une partie de la population contre le CRTC, et d’appuyer la station de radio. En retour, Radio X a soutenu le candidat adéquiste Sylvain Légaré lors de l’élection partielle de septembre 2004, dans la circonscription de Vanier. Le candidat libéral s’est rallié à son tour à Radio X dans les derniers jours de sa campagne électorale, mais trop tard, et l’ADQ a remporté une victoire décisive le soir des élections.
Il est souvent de bon ton – et pratique pour les élus – de minimiser l’importance des contenus des radios de Québec, de considérer leurs propos comme de simples clowneries ou des enfantillages. Pourtant, leur capacité à déterminer les programmes politiques de la nation, leur influence idéologique et leur engagement dans les campagnes électorales n’ont rien d’anodin. Et l’enthousiasme que ces radios d’opinion se découvrent pour le populisme de la droite libertarienne (voire pour l’extrême droite), leur fascination pour Trump, tout cela n’a rien de drôle ni de puéril.
Souvent, on examine le phénomène des radios de confrontation d’un point de vue étroitement juridique, en se demandant, par exemple, si les propos qu’on y tient sont des atteintes à la réputation qui transgressent les bornes de la liberté de presse ou d’expression. Dans le cas du militantisme politique, toutefois, on peut aussi se demander si les radios n’enfreignent pas l’esprit, voire la lettre, des lois électorales ainsi que certaines règles élémentaires du journalisme, dont le but est de rendre viable la conversation démocratique. Ce type d’engagement massif, indiscutable, militant, constitue-t-il un manquement aux lois électorales, ou même aux lois qui régissent les communications ?
Cette politisation des ondes soulève une autre interrogation, plus controversée encore. Ce nouveau rôle que s’attribuent les radios de Québec n’appartient-il pas essentiellement au registre de la « propagande » ? À la lumière de ses observations pendant la Seconde Guerre mondiale, Leonard W. Doob a forgé une définition canonique de la propagande : « La tentative d’atteindre et de toucher directement la personnalité des individus dans l’intention de les faire se comporter selon des buts précis. » Or, les contenus radiophoniques dont il est question ici ne sont destinés qu’à une seule chose : convaincre et conditionner les auditeurs par le truchement des émotions et de l’identification personnelle. En ce sens, nous sommes en présence d’un schéma de propagande radiophonique. Autrement dit, les animateurs mettent de l’avant leurs désirs politiques, ou ceux de leurs employeurs, comme d’autres vendent des savonnettes. Et ce commerce n’est pas sans conséquence.
Les cibles
Quiconque écoute attentivement les radios poubelles, en prêtant foi aux discours qu’y tiennent les animateurs, court le risque de développer une aversion pour certains groupes sociaux, en particulier les féministes, les environnementalistes, les Autochtones et les pauvres. Ce sont là les cibles préférées des animateurs vedettes qui règnent sur les ondes à Québec. Avec les immigrants, ils ne ratent jamais une occasion de dépeindre ces cibles de façon négative, et avec beaucoup d’emphase.
Qu’ont en commun ces groupes qui leur vaut d’être ainsi pris à partie ? La réponse est d’une simplicité désarmante : chacun à sa manière rappelle par ses revendications, ou sa simple existence, l’importance vitale du lien social. C’est l’idée même que la solidarité puisse être le ferment des sociétés qui provoque la colère des animateurs. Les radios de Québec dont on parle ici préfèrent les manifestations d’individualisme, ou du chacun pour soi, dont ils vantent les mérites tous les jours. Et leurs techniques de persuasion ont peu à voir avec les principes élémentaires du journalisme ou de la libre discussion, pourtant indispensables à la production d’une représentation saine et raisonnée de ce qui constitue notre identité.

Photo Thorsten Frenzel/Pixabay
Du côté de Québec, la résistance citoyenne se poursuit. En plus de la coalition Sortons les poubelles, très active dans le monitoring de la radio locale depuis plusieurs années, La Déclaration pour des ondes radiophoniques saines signée en 2015 continue à faire du chemin. On y dénonce entre autres la dégradation du climat et de la violence que peuvent engendrer certains propos tolérés : « Outre le tort causé aux individus par les préjugés colportés, nous constatons que les discours de certains animateurs et certaines animatrices, amplifiés par une audience de masse, sont susceptibles de provoquer une dégradation du climat social, voire de susciter des comportements violents ou antisociaux. »
Malgré les fortes cotes d’écoute des émissions dénoncées, malgré l’apathie des institutions publiques, malgré l’impuissance du Conseil de Presse, malgré les vents contraires, ces citoyens ne se résignent pas au laisser-faire et persistent à rappeler qu’en démocratie, la liberté d’expression est bien plus qu’un droit privé : c’est une institution. Même si elle est concertée, toutefois, leur action restera limitée tant que les pouvoirs publics québécois ne se porteront pas eux aussi à la défense des principes et des lois qui protègent l’espace public démocratique.
Un modèle d’affaires
Les médias d’information connaissent, partout en Occident, de graves problèmes économiques. La publicité, aussi bien dire l’essentiel de leurs revenus, s’est déplacée vers l’économie numérique, où l’on peut cibler sa clientèle à moindres frais et avec une précision chirurgicale. Nous savons tous d’expérience qu’il suffit d’un achat en ligne ou de quelques visites sur un site commercial pour que surgissent aussitôt sous nos yeux des publicités qu’on présume à l’image de nos intérêts. La captation de la quasi-totalité de ces revenus par une poignée de géants du web a ainsi poussé les plus grandes entreprises de presse sur le bord du précipice. Dans ce contexte difficile, les radios privées ont su développer un modèle d’affaires qui a permis à plusieurs d’entre elles de tirer leur épingle du jeu. Celui-ci, en gros, repose sur deux grands axes : la diminution des coûts de production du contenu et l’offre aux commanditaires d’un auditoire précis, ciblé avec soin.
Ce sont d’abord ces mobiles économiques qui se trouvent à l’origine des choix éditoriaux spectaculaires des radios de confrontation. En effet, il est beaucoup moins onéreux pour des entreprises de presse de confier à quelques animateurs de longues périodes d’antenne chaque jour que d’avoir à engager des journalistes qui travailleront pour quelques minutes de bulletins de nouvelles. Il coûte aussi beaucoup moins cher de produire de l’opinion que de l’information rigoureuse. Il suffit pour cela d’avoir des humeurs, de glaner les informations du jour, produites par d’autres, et d’avoir un peu de bagout. Prendre le micro en enchaînant les « Moi, je pense que… » exige moins de dépenses qu’un reportage qui tente de faire le tour d’une question. Certes, les salaires des animateurs vedettes sont astronomiques (on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars par année), mais cela demeure une aubaine en comparaison de l’embauche d’une équipe de journalistes ou de recherchistes. En réduisant les coûts de production, on s’assure de présenter des rendements élevés sur les investissements. Et on donne en même temps à l’information un tour divertissant, pour ceux qu’amusent de telles frasques.
Le produit, désormais, c’est l’animateur qui, avec désinvolture, fait aussi la promotion de ses commanditaires au fil de ses commentaires. L’information, le commerce, le spectacle, tout se mêle ici dans une formule qui repose finalement sur l’identification forte de l’auditeur à la personnalité qui s’agite derrière son micro.
Pendant plusieurs années, les stations de radio se démarquaient principalement par leur son musical. Par exemple, un son nostalgique visait à constituer un auditoire plus âgé, un son rock ou de la musique contemporaine devait attirer les plus jeunes, et ainsi de suite. L’information demeurait cependant protégée, à l’écart de ces choix commerciaux. Elle n’était pas choisie directement en fonction d’un auditoire précis, mais gardait un caractère généraliste défini par le professionnalisme et l’indépendance des journalistes. Mais cette époque est révolue. Aujourd’hui, nous sommes sortis de l’époque du broadcasting et entrés dans l’ère du narrowcasting.
Le broadcasting se démarquait par le production d’une information généraliste, la plus impartiale possible, traitant de l’ensemble des positions possibles dans un débat social, et par la recherche d’un contenu dans lequel virtuellement tous les auditeurs pourraient se retrouver.
Le narrowcasting, à l’inverse, développe un son et un contenu susceptibles d’attirer une clientèle bien précise, un groupe d’auditeurs relativement homogène, en misant sur une approche intensive, ciblée, pour récolter de bonnes cotes d’écoute. C’est cette clientèle que l’on vend aux commanditaires. Les radios d’opinion de Québec visent ainsi les hommes de 20 à 45 ans, résidant en banlieue, un segment de la population fort intéressant compte tenu de son pouvoir d’achat. Dans ce modèle du narrowcasting, l’information sert à attirer l’auditoire visé en se faisant le reflet de ses préjugés et des intérêts politiques qu’on lui attribue.

Crise avérée des institutions
Le phénomène des radios d’opinion existe aujourd’hui dans notre société au milieu d’une crise avérée des institutions politiques et sociales, laquelle est loin d’être unique au Québec. Crise politique : dénigrement des élus et des élites scientifiques, désintérêt pour le vote, revendications individualistes, attaques contre les services publics, etc. Crise sociale : affrontements et ruptures entre « le vrai monde » et « les autres », clivages de plus en plus prononcés, violence verbale sur les réseaux sociaux, racisme décomplexé, anti-intellectualisme primaire… Les radios d’opinion de Québec rament sur ce courant, tout en l’alimentant.
On a longtemps considéré ce phénomène, surtout vu de Montréal, comme marginal, confiné à une seule région, et plutôt clownesque. Ceux qui s’estiment raisonnables sont en effet prompts à juger la bêtise inoffensive, même si l’histoire plaide le contraire. Bien sûr, il est toujours très difficile de trancher entre la poule et l’œuf : écoute-t-on ces radios parce qu’on partage leurs opinions, ou partage-t-on ces opinions parce qu’on écoute ces radios ? Il reste qu’on ne peut plus désormais éluder certaines questions. Les incitations à la haine peuvent-elles conduire des personnes instables à des actes criminels ? La souffrance de personnes ciblées peut-elle vraiment se justifier par la liberté d’expression d’animateurs et de propriétaires de stations de radio ? Est-il équitable que ces derniers, en raison des moyens dont ils disposent, bénéficient d’un droit de parole et d’influence démesuré par rapport à l’ensemble des citoyens ? Un discours qui entrave la poursuite d’un débat démocratique peut-il s’inscrire de plein droit dans la liberté de presse ?
Il n’y a pas de réponse formelle et absolue à ces questions. L’histoire nous invite toutefois à la vigilance, et l’expérience de dérégulation chez nos voisins du sud devrait nous inciter à faire preuve de prudence. Face à des phénomènes dont on mesure encore mal l’ampleur et l’incidence sur notre démocratie, n’est-ce pas le rôle de nos élus de prendre les précautions nécessaires pour éviter le pire ? 
Dominique Payette est professeure
au département d’information et de communication de l’Université Laval.
1
Les Brutes et la punaise: Les radios poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures. Montréal, éditions Lux Éditeur, 2019.
Référence de publication (ISO 690) :PAYETTE, Dominique. Les radios poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2019, vol. 2, n°3, p. D23-D30.
DOI:10.31188/CaJsm.2(3).2019.D023






