 |
Nouvelle série, n°3
1er semestre 2019 |
 |
||
|
RECHERCHES |
||||
|
TÉLÉCHARGER LA SECTION |
SOMMAIRE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
NOTE DE LECTURE
Olivier Goujon : Ces cons de journalistes
Magali Prodhomme
I
l est des cons qu’il vaut mieux ignorer. Il en est d’autres, aussi difficiles à définir qu’à éviter, que l’on pardonnerait volontiers : les cons qui s’ignorent. Les cons qui subissent. Les cons qui s’oublient. Ceux qu’un langage populaire désignerait presque affectueusement. Dans cet essai d’Olivier Goujon, les cons sont ciblés : ce sont les journalistes, « ces cons de journalistes » que l’auteur interpelle sur 187 pages. La profession n’en est certes plus à une invective près, elle dont l’histoire est émaillée de critiques et d’hostilité conjuguées.
Et sur ce registre de la critique qui n’a jamais faibli, il faut noter une constance dans l’agressivité à désigner ceux qui ont choisi le métier d’informer : « cette lie du genre humain » sous la plume acerbe d’un Voltaire qui plaçait, précise Robert Darnton, « la malheureuse espèce qui écrit pour vivre à un niveau social au-dessous de celui des prostituées1 » a cédé la place à des formulations d’une même élégance, le talent de Voltaire en moins : tantôt les journalopes, tantôt les presstituées. Olivier Goujon n’est pas de ceux à porter l’estocade gratuite sur une profession déjà « détestée » et à s’assurer que ces attrape-tout de réseaux sociaux agissent. Non. Olivier Goujon dresse un constat critique, parfois sévère et désenchanté, sur cette « malheureuse espèce qui écrit pour vivre », à ces « bohèmes de la République des Lettres », à « ce prolétariat littéraire » qui, depuis le 29 mars 1935, a gagné un statut légal à défaut de respect.
Ce constat critique résonne de l’intérieur car son auteur fait partie de ces cons de journalistes. Photoreporter, auteur et journaliste avec plus de 500 reportages à son actif dans près de 160 pays dont la Somalie, l’Irak, la Syrie ou encore le Mali, le Malouin2 d’origine examine avec l’acuité des grands reporter, et non sans désolation, les transformations des conditions d’exercice du journalisme. Dès l’avant-propos, il saisit le lecteur pour mieux asseoir ce titre volontairement subversif : « Mon métier meurt. Et je veux bien mourir avec. Mais pas comme un con » (p. 8).
« S’interroger sur les cons, c’est s’interroger sur soi-même », souligne Maxime Rovère, philosophe spinoziste et auteur d’un récent ouvrage intitulé Que faire des cons ? Pour ne pas en rester un soi-même3. Il y a possiblement dans les intentions d’Olivier Goujon une volonté de revenir sur ce qui a jalonné son parcours du combattant dans la profession. Un combattant du journalisme devenu bien malgré lui résistant. Parce qu’il y a aussi de la nostalgie dans cet essai. La nostalgie des « fouineurs à l’ancienne » (p. 85), celle des reportages financés, celle enfin d’un journalisme avec des journalistes.
Son combat se déploie sur 20 chapitres aux titres cogneurs : « Mourir pour une pige », « Le bagne du reportage », « Anatomie d’une saloperie » ou encore « Crise, caste et casse »... La colère comme la déception y sont à peine voilées. Le désenchantement aussi. Si les titres annoncent le ton, les mots choisis font leur métier de mots : ils révèlent un lexique radical à l’image de la précarisation extrême de cette profession que dénonce Olivier Goujon. Ainsi, au détour des pages, les « crevards », le « métier crevé », « l’oasis de précaires », « la piétaille de crevards », les « mendigots de la photo », « la chiourme », « les miséreux » cotoîent « le cynisme du système », « les monarques du secteur », « la déshérence », « l’humiliation », « la misère », « le déclassement » ou encore « la déconsidération intellectuelle ».
Page par page, l’auteur s’emploie avec rigueur et beaucoup d’humanité à démontrer les effets aussi progressifs que dévastateurs de la précarisation et de la flexibilisation du travail sur les pratiques journalistiques d’une part, celles du reportage, de l’investigation, de la pige, du photo-reportage, et sur les vocations, d’autre part, largement alimentées selon lui par l’imaginaire du journalisme et ce qu’il appelle la « caste des journalistes » (p. 31). La caste, ce sont « les têtes de gondoles journalistiques » (p. 32) qui opèrent comme des angles morts sur le reste de la profession voué au mieux à l’inaudible et l’invisibilité, au pire « à risquer leur vie pour une poignée d’euros et le sentiment d’exister » (p. 16).
Olivier Goujon a instruit son réquisitoire à la fois contre « la pénétration des idées libérales dans la presse », dont il est partout question, mais aussi contre « le mythe de la grande famille de la presse » (p. 32). Cette grande famille de la presse dont le silence assourdissant face « à cet oasis de précaires reconnus » et la pratique du pigisme de misère, tue selon lui progressivement le journalisme. Et ce n’est pas tant le déni des journalistes que dénonce l’auteur, même s’il cède parfois à cette analyse, que « la psychologisation culpabilisatrice » (p. 41) à l’œuvre dans la corporation qui consiste à « convaincre les survivants que la précarisation des autres était le seul moyen de sauver les emplois », « de les faire bosser un peu quand même » et, au final, de dresser une partie des journalistes, les salariés en CDI4, contre une autre, les pigistes (p. 41). Et l’auteur d’ajouter : « Cette technique est à l’œuvre dans toutes les rédactions ou presque » (p. 40). Les techniques furtives, Olivier Goujon en révèle une pléthore comme celle du glissement sémantique qui sévit au début des années 2000 pour commander non plus un « reportage » mais une « prestation » avec comme interlocuteur privilégié pour les pigistes, « le service comptabilité fournisseurs » (p. 41). L’externalisation et son vocabulaire dédié pénètre insidieusement la profession réduite à se taire ou à crever.
Il n’épargne donc pas le cynisme de certains patrons de presse, et avec eux leurs « sicaires », qui contournent avec une ingéniosité sans cesse renouvelée le droit du travail et réduisent l’interface « toujours plus soumise » (p. 136) des rédacteurs en chef dont certains brillent par leur complaisance à un modèle économique et managérial qui « sclérose le journalisme et empêche sa réinvention » (p. 165).
Ce « livre gesticulé » comme il le désigne en référence à la « conférence gesticulée » (p. 125) pratiquée au Québec, à mi-chemin entre le stand-up et la conférence, n’a rien d’anecdotique. D’abord parce que son auteur, passé par une licence d’Histoire, un master de Science politique et l’IPJ (Paris), a rassemblé suffisamment d’expérience et de témoignages pour en tirer une légitimité. En tant que journaliste-photoreporter, il appartient certes à son objet de réflexion, mais Olivier Goujon ne prétend pas à une analyse sociologique. Il n’a recours ni à ses méthodes, même s’il pratique l’entretien restitué sous forme de nombreux témoignages, ni à ses paradigmes. Ces cons de journalistes hybride récits, quelques éléments autobiographiques, témoignages et réflexions autour du métier et des parcours accidentés de collègues, confrères et consœurs photoreporters, que des données chiffrées et sourcées viennent enrichir. Il ne méconnaît pas ce qui se réinvente, le slow journalism (Usbek & Rika, Le 1, Le Quatre-heures), la création de « collectifs de journalistes » aux compétences variées et à « l’intelligence collective » (Presse Extra Muros) (p. 167).
Pour l’auteur, la question de la monétisation de la production d’informations est la clé du système (p. 90) et certains exemples en France comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne lui donnent raison. Il faut également, selon lui, « tout miser » sur l’information originale et de qualité (vs infotainement) comme l’a fait Mediapart (p. 90). Il faut enfin et surtout « embaucher des journalistes » (p. 92). Faire du journalisme avec des journalistes, ceux-là même dont il dit « qu’ils ont abandonné leurs valeurs, la curiosité, l’indépendance, l’amour des mots » (p. 26).
L’apostrophe frondeuse d’Olivier Goujon qui clôture chaque chapitre « Il faut être con, non ! », comme le titre de son essai, ne sont pas l’expression d’un mépris du journalisme. Au contraire. C’est bien plus un appel à rallier la résistance, à changer de modèle de journalisme, à le réinventer. L’auteur pointe les défaites mais aussi les combats à mener. Et le le plus difficile d’entre eux, c’est probablement au sein même de la profession qu’il doit se livrer pour gagner en indépendance et renouer la confiance avec le public. Car enfin, comme l’écrivait Frédéric Dard, « si tous les cons volaient, il ferait nuit ». Mais, et c’est le vœu en creux de l’auteur, pas avec « Ces cons de journalistes ». 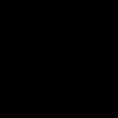
Olivier Goujon (2019). Ces cons de journalistes.
Paris : Éditions Max Milo, 190 p.
Magali Prodhomme, maître de conférences
à l'Université Catholique de l'Ouest, est membre des équipes
de recherches Mutanum (UCO)et Arènes (UMR 6501).
Notes
1Magali Prodhomme (2010). Généalogie croisée : de la critique à l’éthique du journalisme. Revue Mouvements. Critiquer les médias ? n°61, janvier-mars, p. 76.
2Olivier Goujon est né à Saint-Malo.
3Que faire des cons ? Pour ne pas en rester un soi-même de Maxime Rovère, Flammarion, 208 pages, janvier 2019.
4Contrat de travail à durée indéterminé (vs CDD : Contrat de travail à durée déterminée)
Référence de publication (ISO 690) : PRODHOMME, Magali. Olivier Goujon : Ces cons de journalistes. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2019, vol. 2, n°3, p. R183-R185. DOI: 10.31188/CaJsm.2(3).2019.R183






