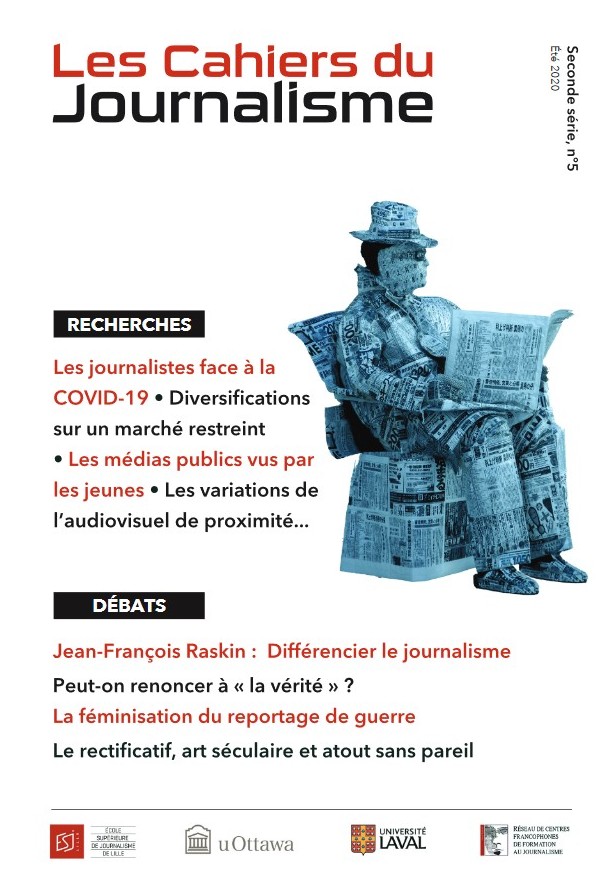 |
Nouvelle série, n°5 Été 2020 |
 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
ENTRETIEN
Jean-François Raskin : dans
un monde en mutation, la recherche
appliquée est indispensable
Sans être issu du journalisme, Jean-François Raskin, président sortant 1 de la Radio télévision publique belge francophone (RTBF) et administrateur général du plus gros programme de formation au journalisme de ce pays, a développé à la tête de ces deux institutions une passion profonde pour l’information, mais attentive à ses limites et aux dangers qui la menacent.

LES CAHIERS – Une curieuse particularité de la RTBF est que ses administrateurs sont directement choisis par les différents partis politiques. Dans quelle mesure ceci peut-il affecter son indépendance ?
J.-F. RASKIN – En effet, les membres de son conseil d’administration et son président sont désignés par les partis siégeant au parlement de la Communauté française au prorata de leur poids respectif. Mais ces administrateurs ne sont pas pour autant des politiques : conformément à la Charte de l’administrateur public, ils ont le devoir de travailler dans le seul intérêt de l’entreprise dans laquelle ils siègent.
Le devoir est une chose, mais la tentation peut en être une autre : la RTBF est-elle vraiment étanche aux influences politiques ?
Paradoxalement, je pense que ce système la protège très bien. Au cours de quinze années passées à sa vice-présidence ou sa présidence, je n’ai jamais ressenti – en tout cas pour 99 % des dossiers – de biais liés aux préférences politiques de ses membres. D’ailleurs, la plupart des décisions du conseil d’administration ont été prises à l’unanimité. Quand des divergences se faisaient sentir, elles étaient liées à diverses conceptions de sa mission de service public, pas à des positions partisanes.
Cependant, le conseil nomme le directeur de la rédaction, fonction stratégique s’il en est.
Oui, mais c’est un cabinet de recrutement qui prépare cette sélection. De façon générale, nous n’avons rien, vraiment strictement rien, à dire sur la ligne éditoriale. Et si nous avions eu la mauvaise idée d’essayer, j’aurais trouvé sur mon bureau un préavis de grève des journalistes en moins de 24 heures.
Ce qui veut dire que, lorsqu’est survenue une crise comme la fameuse mystification sur la partition de la Belgique2, vous n’aviez rien à dire ?
Je n’étais même pas au courant.
Vous ne regardez pas la télévision ?
Je veux dire que je n’étais pas au courant avant cette émission. Après, bien sûr, le monde politique a exigé que des têtes tombent. Le conseil s’est réuni d’urgence et a finalement décidé à l’unanimité moins deux voix qu’aucune tête ne tomberait, mais que certaines procédures seraient réformées afin qu’une telle chose ne puisse se reproduire. On a donc bien résisté à la pression politique.
Si vous ne vous occupiez pas de la ligne éditoriale de la RTBF, vous étiez directement responsable de sa stratégie, à un moment où les audiences se dissolvent et les frontières se brouillent. Quelle vision en avez-vous retirée ?
Il y a deux ans, nous avons entamé un grand processus de transformation pour mettre fin à la logique de silos médiatiques et les remplacer par ce que nous avons appelé des managers 360…
Ça sonne un peu comme le jargon des consultants en organisation : quand il y a des chiffres dans les intitulés, il n’y a souvent que des chiffres dans les esprits. C’était le cas à la RTBF ?
L’important, c’était d’évoluer au mieux en fonction des mutations que connaît l’information aujourd’hui. Toutes les informations, celles de nos journalistes, celles des agences, arrivent maintenant dans une centrale de l’information composée de ces managers 360 – je suis désolé mais c’est comme ça qu’on appelle le rôle des anciens rédacteurs en chef – qui les dispatchent en fonction des nombreux supports qui sont à leur disposition.
Comment ces anciens rédacteurs en chef ont-ils accueilli leurs nouvelles cartes de visite ?
Ça a été bien accueilli. Enfin… disons que ça a été… Certains n’aimaient pas ça, mais d’autres ont trouvé que, finalement, ce qu’ils faisaient était bien un job de management. Aujourd’hui, nous avons une multitude de supports différents : les traditionnelles radio et télévision, mais aussi le web, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram… Nous y faisons de l’info aussi, et en fonction de la nature, de l’importance, de la pertinence, de la temporalité de chaque information, c’est eux qui ont la charge de la manager.
En fonction de critères strictement journalistiques ou de critères managériaux ?
Des critères journalistiques, bien évidemment, mais aussi des critères de public : à quel public cette info s’adresse-t-elle ? À quel public vais-je l’envoyer en premier lieu ? C’est bien pour ça que nous avons eu une réflexion vraiment globale sur l’information et son traitement journalistique, mais aussi sur les publics auxquels on s’adresse et sur les supports que suivent ces publics-là.
Pourtant, de nombreuses recherches ont établi que les rédactions comprennent étonnamment mal les publics auxquels elles s’adressent. Est-ce que la RTBF s’est attaquée méthodiquement à ce problème ?
Oui, nous avons fait beaucoup d’études. Il y a un service qui ne fait que ça, donc des gens qui travaillent uniquement à la connaissance des publics ; de celui que nous avons déjà mais aussi de ceux que nous voulons aller chercher.

Combien, dans ce service, ont-ils consacré leur doctorat à des questions multifactorielles aussi complexes ?
À mon avis, aucun. Mais la RTBF travaille aussi avec l’université. Elle travaille beaucoup avec l’Université catholique de Louvain. Par exemple, des chercheurs ont développé un algorithme qui permet de suivre en direct les opinions du public pendant les débats qu’on diffuse et ils interviennent régulièrement durant ces émissions.
La nouvelle orientation stratégique de la RTBF correspond-elle au moment où elle a remplacé son nom par celui de son site internet, rtbf.be ?
Non, ça c’était un peu avant, mais effectivement ça a accompagné son plan de transformation autour de l’idée de « web first ». On sait aujourd’hui qu’au moment du journal télévisé – car nous avons encore la grand-messe du JT – la plupart des informations présentées ont déjà été ingérées et digérées par la plupart des téléspectateurs, notamment grâce au web.
L’avenir de la RTBF est donc avant tout sur internet ?
Sur internet, mais pas uniquement : la télévision reste le média le plus important aujourd’hui. Il est très très très suivi, notamment pour les grands sujets en direct et les épreuves sportives. En ce qui concerne le journal télévisé, on voit que les audiences s’érodent petit à petit, doucement. Ce n’est pas une chute vertigineuse, mais l’âge moyen de ceux qui regardent le JT approche de 60 ans et chaque année il monte d’un an.
L’indicateur qu’est l’âge moyen pourrait-il, comme la métaphore de l’érosion, laisser croire à une désertion générationnelle pure et simple ? Dans la presse écrite, des résultats plus détaillés témoignent plutôt d’habitudes de consommation persistantes mais moins routinières…
Non, l’âge moyen ne veut pas dire que les jeunes ne regardent plus jamais les émissions, mais ils picorent. C’est pourquoi la grand-messe du soir est sans doute un format qui, à un moment donné, devra être remis en question.
Ne reste-t-elle pas une référence identitaire fondamentale, comme l’édition imprimée pour les quotidiens ?
On s’est tout de même posé la question : doit-on la garder ? La réponse est oui, parce que nous avons encore près de 500 000 téléspectateurs, mais on a cherché à améliorer les choses, à avoir peut-être plus de sujets longs que de sujets courts et déjà connus. Le format long est quelque chose qui permet d’aller chercher la valeur ajoutée journalistique.
Chercher la valeur ajoutée revient-il notamment à abandonner le micro-trottoir ?
La RTBF n’est pas très friande de micros-trottoirs. Quelqu’un qui veut faire un micro-trottoir provoquera inévitablement un débat au sein de la rédaction, parce que beaucoup estiment que ce n’est pas du journalisme. Et je ne suis même pas sûr que ça soit une économie. Descendre toute une équipe tourner dans la rue, puis choisir les 35 secondes dont elle a besoin, ça ne prend pas tellement moins de temps que d’aller poser les bonnes questions à un expert. C’est moins une question de temps que de cervelle.
On ne contestera pas forcément ce dernier point, mais questionner des passants ne réclame pas forcément une équipe complète : la RTBF ne recourt donc jamais à des vidéojournalistes autonomes ?
Si, mais ça dépend pour quoi. S’il s’agit d’une petite information factuelle pour le web, quelques vaches qui se sont égarées sur la route, un journaliste reporter d’image le fera très bien : ils sont bien formés et peuvent monter le sujet aussi vite qu’un monteur. Ce qui permet, à une époque de pénurie financière, de confier des sujets longs à d’autres équipes.
Dans une logique de rédaction globale, sans silos, le même journaliste peut-il aussi bien se voir confier un sujet court pour le web qu’un sujet approfondi pour le JT ?
Oui, en principe un journaliste qui a un bon sujet pourra à un moment donné être dispensé du travail au quotidien pour être mis pour une durée plus ou moins grande sur un reportage long. Il y a de moins en moins de distinctions pour les formats. En tout cas, les jeunes journalistes qui entrent n’ont pas de formats attitrés.
Comment la prépondérance qu’une télévision publique accorde désormais au web est-elle ressentie par les journaux qui se développent sur ce même support ?
À partir du moment où il existe un média public qui capte une partie de l’audience, rien ne peut faire plaisir à des entreprises privées : c’est l’existence même des médias de service public qui leur pose problème.
Mais la concurrence était moins directe tant que l’audiovisuel et l’écrit ne chassaient pas sur les mêmes terres…
C’est vrai dans les deux sens : aujourd’hui, il y a beaucoup de son et de vidéo sur les sites des médias imprimés. La convergence médiatique est une réalité et on ne peut plus délimiter des sphères de compétences exclusives. Ils ont bien sûr le droit de faire de la vidéo et, à l’inverse, la directive européenne dit clairement que les médias publics ont le devoir d’aller sur tous les supports où ils peuvent remplir leur mission. Par ailleurs, la RTBF a développé des partenariats avec la presse écrite, en mettant par exemple à sa disposition des espaces de promotion et en lui fournissant un certain nombre de sujets audiovisuels que les journaux peuvent reprendre.
Quels sont les grands défis qui se dressent aujourd’hui devant les télévisions de service public ?
C’est d’abord le fait que les modèles économiques sont de plus en plus fragiles. Ceci provoque des tensions avec certains médias privés mais aussi des remises en cause dans les pays où le populisme est important. La charge budgétaire est mise en avant, mais il y a aussi la résistance des médias publics à certaines évolutions qui peut conduire à vouloir les mettre au pas. En Suisse, le référendum pour la suppression de la redevance, et donc du service public audiovisuel, a d’abord obtenu un soutien majoritaire, mais tous ceux qui tenaient à ce service ont mené une campagne très forte. Au bout du compte, les citoyens ont voté à 70 % pour son maintien.
Est-ce forcément un débat malsain ? Demander aux citoyens de se prononcer, c’est aussi les amener à s’interroger, voire refonder un pacte.
Oui, ça a vraiment été un débat d’une ampleur incroyable. Il y a eu une vraie réflexion sur l’utilité d’un service public à une époque où les diverses sources d’information deviennent pratiquement incontrôlables, sur le besoin de garder une référence en matière de respect de la déontologie…
Pour en revenir à la Belgique, mais sans quitter le sujet de la déontologie, ce pays possède comme le Luxembourg un conseil de presse fondé sur un texte légal plutôt que spontanément auto-organisé : comment en est-on arrivé là ?
Il y avait longtemps que la profession, mais aussi les pouvoirs publics, cherchaient un moyen de permettre à la presse de s’autoréguler. Il y avait en outre un débat sur la correctionnalisation des délits de presse : en Belgique, ils relevaient de la cour d’assises comme les crimes les plus graves, mais puisque c’était un bien trop gros bâton, personne ne s’en servait. C’est à l’occasion de ces discussions que le projet de conseil a fini par aboutir. Mais il est bien auto-organisé : le décret qui le fonde ne visait qu’à fournir une base légale à cette instance et à son financement partiel. Les pouvoirs publics n’interviennent pas dans son fonctionnement et ils n’y nomment personne.
Ce conseil a maintenant dix ans d’existence : quel bilan peut-on en tirer ?
Dans le monde professionnel, je crois que l’on considère qu’il fonctionne bien. Ses sanctions sont purement symboliques : on ne retire pas de carte de presse. Un problème est qu’il n’est pas assez connu de la population. Ses décisions sont publiées sur son site mais elles ont peu d’échos et le grand public n’est pratiquement jamais au courant.
Cependant, leur impact peut largement dépasser leur vocation symbolique : malgré les protestations du conseil lui-même, le gouvernement a suspendu le versement des aides à la presse à des journaux multirécidivistes…
Je ne crois pas que les aides aient été supprimées : cela impliquerait une décision politique majeure. À mon avis, il s’agissait plutôt d’un mouvement d’exaspération temporaire face à des abus répétés.
Mais une telle utilisation de jugements déontologiques vous semblerait-elle légitime ?
Je n’aime pas ça mais… Quand vous regardez les décisions du conseil et que vous voyez que c’est toujours le même journal qui est condamné… Je pense que… Je n’aime pas que le politique se mêle de ça, mais face à des organes de presse qui dérapent vraiment de manière systématique et volontaire, il faudrait tout de même un arsenal de sanctions qui soit plus élargi que de dire simplement « bouh, le vilain ! »

Jean-François Raskin -Photo : B.L. / CdJ
Ce qui pose le problème de la liberté d’expression…
Ce n’est pas le droit de dire n’importe quoi n’importe comment sur n’importe qui et de recevoir des aides publiques pour ça. Ici, on parle d’infractions déontologiques et éthiques systématiques, qui sont condamnées systématiquement par le conseil. Et ces sanctions, ils n’en ont rien à faire parce que ça ne leur pose pas préjudice une seule seconde. Il y a quand même un problème d’efficacité…
À l’inverse, un autre problème pourrait venir des sensibilités contemporaines : face à des scènes dures, irait-on vers un divorce entre des « représentants du public », qui s’alarment de ce qu’elles choquent leurs enfants, et les professionnels, pour qui cela s’appelle de l’information ?
En Belgique, les représentants du public sont des gens qui connaissent le sujet, qui ont du recul, par exemple des universitaires. Il y a des plaintes, parfois, sur les images montrées à la TV ou dans d’autres médias, mais je n’ai jamais vu de condamnation par le conseil à ce propos. Ça pourrait arriver puisque ça cause souvent des débats, mais les pressions sur les journalistes existent depuis que la presse existe. C’est aux professionnels de résister. Le dialogue, c’est très important aussi. La pédagogie est aujourd’hui indispensable : les journalistes doivent expliquer ce qu’ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Il y a beaucoup d’occasions de débat et d’émissions à ce sujet, et je trouve que cette réflexion est intéressante.
Comment se vit l’identité du journalisme belge francophone par rapport à son grand voisin du Sud ? Se perçoit-il comme différent ?
Je ne pense pas qu’il y ait un sentiment de rivalité. Mais il n’y a pas ici le type de nomenklatura, de vedettarisation de certains journalistes que nous remarquons en France avec parfois un peu d’amusement. Il y a moins de transferts retentissants : les journalistes ont assez peu tendance à passer d’une rédaction à une autre. Pour le reste, je ne crois pas qu’il y ait de très grandes différences : on est tout de même très proches culturellement. Si ce n’est que l’on respecte peut-être mieux le off : un journaliste qui dévoilerait des confidences se grillerait. Les journalistes et les politiques plaisantent souvent ensemble, parce que dans un si petit pays, tout le monde se connaît, mais c’est fait sans hypocrisie : il n’y a pas de double jeu.
Et avec le monde universitaire, la communauté journalistique belge a-t-elle des relations plus étroites que dans un pays comme la France ?
Je crois que oui, là aussi parce qu’on est un pays qui est relativement petit. Il y a un contact entre le monde universitaire et les journalistes qui est permanent, naturel, beaucoup plus que dans les grands pays où il y a plus de distance. C’est peut-être une question de culture, mais la culture est liée à la taille aussi, elle se construit par rapport à l’espace. Et puis, il y a moins de méfiance, parce que la Belgique a été un peu épargnée par la vague des recherches critiques sur ce métier, qui pouvaient être perçues comme des dénonciations radicales. Les travaux sont plus historiques ou prospectifs. Dans l’autre sens, je crois que les journalistes participent plus chez nous à l’enseignement universitaire. À l’IHECS, j’ai beaucoup de journalistes qui travaillent à la formation.
Pour les cours de pratique journalistique, n’est-il pas assez courant de recourir à des praticiens, a fortiori dans le cas des écoles autonomes ?
En fait, l’IHECS a exactement le même statut que la plupart des universités belges, par exemple l’Université catholique de Louvain, dont beaucoup ont des racines confessionnelles comme lui. L’Institut est financé par l’État, ses enseignants sont nommés et payés par l’État. Ceci étant, nous avons tout de même plus de liberté qu’une université classique, ce qui nous permet d’avoir bien plus de professionnels-enseignants : nous en avons près de cinquante !
Ce qui présente des avantages, mais pourrait aussi comporter des inconvénients. Dans quelle mesure contribue-t-il à la recherche sur le journalisme et est-il irrigué par elle ?
C’est une préoccupation importante pour nous. Nous sommes une école professionnelle et avons donc moins de potentiel de recherche qu’une institution dont les profs sont essentiellement des chercheurs. Nous avons un laboratoire qui s’intéresse à la communication politique et nous avons des accords de collaboration et de coopération pour contribuer à certains travaux menés dans des universités, mais nous n’avons pas accès aux mêmes fonds de recherche qu’elles et tout ceci reste en dessous de nos besoins.
Quels besoins avez-vous identifiés ?
Les structures universitaires font surtout de la recherche théorique, et elles le font très bien. En revanche, la dimension recherche appliquée reste très peu présente dans les universités aujourd’hui. Or, nous pensons – nous en sommes même convaincus – que pour nos enseignements, pour nos enseignants et pour les profils que nous formons dans un monde en mutation profonde, avoir de la recherche appliquée est indispensable.
Était-ce l’une des motivations pour envisager de fusionner avec l’Université libre de Bruxelles ?
C’était l’un des motifs importants. Le fait aussi que nous devons aujourd’hui avoir recours à toute une série de profils d’enseignants qui sont différents de ceux dont nous avons l’habitude. Je pense par exemple aux approches interdisciplinaires autour des données et des algorithmes : nous avons besoin d’enrichir notre corps professoral avec des ingénieurs, des mathématiciens, des informaticiens… Sur ce point, l’IHECS est un peu seule même si elle est la plus grosse école de Belgique avec ses 2 000 étudiants en journalisme ou en communication. Avec l’Université Libre de Bruxelles, il aurait été possible de créer une grande faculté entièrement consacrée au journalisme et à la communication, ce qui n’existe pas en Belgique où il n’y a que des départements universitaires.
Le défi d’harmoniser les normes d’un institut professionnel et d’une université s’est au bout du compte révélé insurmontable3. Faut-il y voir un cas d’espèce, ou même un symbole, des différences culturelles entre le journalisme et l’université ?
Dans notre cas, les discussions ont été très positives sur de nombreux points, notamment la recherche, mais la singularité de notre mode de fonctionnement s’est avérée incompatible en pratique avec la rigidité du cadre administratif d’une université belge, à moins de perdre ce qui faisait notre spécificité. Malgré sa taille, l’IHECS est une structure très réactive, très souple, qui entretient des relations étroites avec le monde professionnel, y compris en termes de recrutement et de gestion des infrastructures. La perte de souplesse et d’autonomie aurait été bien grande que ce qui s’est passé en France quand l’Institut pratique de journalisme a rejoint l’Université Paris Dauphine, non seulement parce que le contexte administratif n’est pas le même mais aussi parce que nous englobons nous-mêmes plusieurs programmes, en journalisme mais aussi en communication : c’est une tout autre échelle d’intégration.
À ce propos, comment se vit dans une même structure la bipolarité entre journalisme et communication, qui est usuelle dans le monde universitaire mais suscite parfois une méfiance compréhensible dans la sphère professionnelle ?
D’après mon expérience, elle ne pose aucun problème réel, que ce soit dans un département universitaire ou non, tant que les programmes sont clairement distincts et attachés à leurs propres normes professionnelles. C’est le cas chez nous – comme ça l’est souvent ailleurs – avec des masters professionnels dont les comités de programme et les enseignements sont totalement séparés. Il peut, à l’occasion, s’établir des passerelles sur un thème particulier, mais pas de mélange des rôles.
Après l’échec de la fusion avec l’ULB, comment l’IHECS compte-t-il affronter les défis scientifiques et pédagogiques que vous évoquiez ?
D’abord, l’incompatibilité du fonctionnement au quotidien ne nous empêche pas de continuer à travailler avec des universités belges sur toutes les possibilités de rapprochement qu’il est possible d’envisager à l’avenir, par exemple des doubles diplômes et d’autres formes de coopération. Mais nous allons aussi renforcer notre propre potentiel de recherche interne, en essayant de tirer pleinement parti des formes de financement qui peuvent s’offrir à nous.
Plus généralement, comment voyez-vous l’avenir de l’enseignement du journalisme à moyen et long terme ?
Je l’imagine beaucoup moins cloisonné qu’aujourd’hui, beaucoup plus perméable à des profils, des personnalités plus variées. Je pense que le corps principal du métier de demain devra rester dans les principes déontologiques et éthiques et dans la manière de produire de l’information, mais qu’on va voir des profils totalement différents arriver sur le marché dans les années qui viennent. Si les écoles n’arrivent pas à s’adapter à ces nouveaux profils, elles risquent de perdre la partie et d’entrainer le secteur de la presse dans un échec gigantesque. Ce que Lille a fait avec le Bondy blog ou ce que le Guardian a fait pour aider des jeunes d’horizons différents, c’est remarquable.
À l’époque actuelle, les écoles de journalisme ont parfois du mal à placer tous leurs diplômés : accroître leur effectif ne risque-t-il pas d’accroître cette difficulté sur un marché de l’emploi déprimé ?
Il s’agit moins d’accroître l’effectif que de le diversifier. Et sans doute de repenser les façons de faire, avec des formations à la carte, en alternance ou continues… On devra même repenser ce qu’est le journalisme, parce que de plus en plus de gens estiment qu’ils font du journalisme et qu’il est difficile de savoir ce que signifie « être journaliste » aujourd’hui. Ce n’est pas le simple fait d’avoir une carte de presse ou pas.
Un problème capital, en effet, mais les professionnels ont-ils les moyens et la volonté de l’aborder de front ?
La question de la labellisation du journalisme est un bon exemple. Les journalistes répètent « on ne veut pas de label, on ne veut pas de label » mais avec la multiplication des sources d’information et des gens qui informent ou qui communiquent, à un moment donné on va dire aux journalistes que ce qu’ils font a la même valeur que les autres sources. Donc, si l’on veut différencier quelque chose qui proposerait une qualité particulière en matière d’information et de respect de certaines règles pour la production de cette information, il faudra bien finir par en venir à ça. Je ne sais pas comment ni par qui ça devrait être fait, mais il faudra distinguer ce qui est du journalisme et ça ne se fera pas spontanément. Le risque serait que ça ne se fasse plus du tout. 
Propos recueillis par Bertrand Labasse*.
* Certains propos ont été synthétisés pour assurer la fluidité de cet entretien.
1
Président de la RTBF au moment de cet entretien, il a depuis achevé son troisième mandat à la vice-présidence ou la présidence de l’entreprise publique, qui comprend trois chaînes de télévision généralistes ainsi que plusieurs radios et des chaînes thématiques.
2Un soir de décembre 2006, la première chaîne a interrompu son programme pour diffuser un bulletin spécial annonçant la brusque sécession de la Flandre. Ce simulacre d’information, annoncé par le présentateur du journal télévisé et crédibilisé par des reportages « à chaud » (sic) qui alternaient des attroupements de figurants et des images d’archives décontextualisées, visait à sensibiliser les téléspectateurs à l’importance du débat sur l’unité de la Belgique.
3La fusion projetée ayant finalement achoppé quelque temps après cet entretien, les questions la concernant ont été mises à jour au cours d’un entretien complémentaire.
Référence de publication (ISO 690) :LABASSE, Bertrand. Jean-François Raskin : dans un monde en mutation, la recherche appliquée est indispensable. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2020, vol. 2, n°5, p. D7-D14.
DOI:10.31188/CaJsm.2(5).2020.D007






