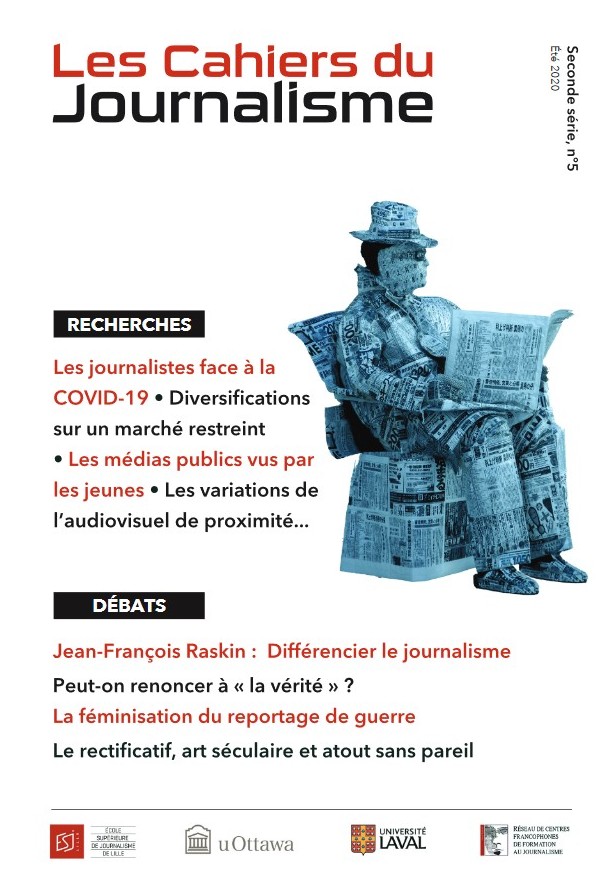 |
Nouvelle série, n°5 Été 2020 |
 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
POINT DE VUE
Faut-il encore former (ne pensez
pas formater) les journalistes ?
Quand tous les repères économiques, identitaires, techniques et sociétaux du journalisme se brouillent, les écoles professionnelles sont au premier chef confrontées à ces incertitudes. Le panorama qu’en dressent deux responsables pédagogiques témoigne de la variété des défis à affronter, mais aussi de la ferme volonté d’y faire face.
Par Charlotte Menegaux et Corinne Vanmerris

Un cours de journalisme à l’Université de l’Iowa vers 1920. Photo : F. W. Kent
L
a réponse était spontanée : « Ma famille et mes amis se moquent : ah, tu veux faire une école de journalisme pour apprendre à mentir ? » Stupeur dans le jury d’admission. À l’oral de motivation du concours d’entrée1 de l’École supérieure de journalisme de Lille, le jury interroge parfois les candidats sur les réactions de leur entourage quant à cette drôle d’idée de vouloir devenir journaliste. La manière dont les candidats répondent en dit souvent plus long sur leur motivation que tous les argumentaires du monde soigneusement préparés pour l’occasion. En ce mois de juin 2019, la candidate nous dit surtout beaucoup de son époque.
Pas si surprenante cette réflexion car, même si cela n’entame guère la volonté de belles cohortes de jeunes prétendants (entre 1 500 et 2 000 candidats chaque année aux concours des 14 écoles françaises reconnues), la défiance du public à l’égard des médias est là, persistante, tenace, argumentée.
Chaque année, on en prend le pouls dans le baromètre Kantar/La Croix2. En 2019, la perception de l’indépendance des journalistes et la crédibilité accordée aux différents médias sont au plus bas. Seul un quart des sondés (24 %) estime que les journalistes sont indépendants.
Au cœur de la crise des gilets jaunes en France, ces coups de boutoir portés à la confiance envers les médias ont pris des formes parfois violentes : insultes, violences physiques, rejet des reporters sur le terrain. La question même de la légitimité des journalistes à couvrir l’événement était posée et certains manifestants ont choisi de tomber le gilet pour attraper leur smartphone, filmer, rendre compte et par là même se déclarer journalistes sans autre forme de procès, comme a voulu le démontrer Gabin Formont, créateur de Vécu, le média du gilet jaune. Leur légitimité naissant non de leur professionnalisme mais de leur audience, qui était certaine au plus fort de la crise sociale.
En cela, gageons qu’ils étaient sur la même ligne qu’une partie de l’opinion, à savoir que n’importe quel citoyen muni d’un équipement technique ferait au moins aussi bien qu’un journaliste d’une chaîne d’info continue.
La couverture médiatique du mouvement des gilets jaunes n’est pas sans reproches mais ce n’est pas notre sujet. Elle ouvre en revanche sur deux questions : d’une part la définition même de la profession de journaliste (sur quelles bases en produire une suffisamment juste), d’autre part un consensus sur les pratiques fondamentales de l’exercice journalistique. Si l’on s’accorde sur des pratiques journalistiques reconnues et validées (à la fois techniques et de réflexion) – une forme donc de professionnalisme – cela suppose que ces pratiques s’apprennent, donc qu’elles s’enseignent et qu’il n’y a rien d’indigne à cela, en tous cas pas plus pour le journalisme que pour un autre métier. Le prétendre, bien sûr, n’exonère en rien la critique, à la fois sur la manière dont les journalistes exercent leur métier et dont ils sont formés.
Qui est journaliste ?
Le journaliste n’est pas toujours celui (ou celle, les femmes représentant environ la moitié de la profession) qu’on croit. En témoigne le récent débat autour de la carte de presse soulevé par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, à propos de Gaspard Glantz, fondateur de l’agence photo et vidéo Taranis News (plus de 50 000 abonnés sur YouTube). En avril 2019, Gaspard Glantz est interpellé pour un doigt d’honneur adressé à un policier, en marge d’une manifestation de gilets jaunes. Christophe Castaner met immédiatement en doute son statut professionnel en affirmant sur France Info3 : « Être journaliste, c’est aussi avoir une carte de presse ». Affirmation fausse. Le ministre aurait pu poser une autre question : « Est-ce que, dans le cadre d’un débat démocratique de bonne tenue, un journaliste peut faire un doigt d’honneur à un policier ? » ou tout autre commentaire de ce genre. Mais pas contester à Gaspard Glantz son statut.
Car qui est journaliste ? En droit, ce statut est défini en France par le Code du travail et l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse : « Est considérée comme journaliste […] toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse […], y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public. » La loi ne fait donc pas état de la nécessité d’être pourvu d’une carte de presse pour être reconnu comme journaliste. Ce que la Cour de cassation4 a d’ailleurs confirmé en 2016 en reconnaissant le statut de journaliste professionnel à une personne sans carte de presse, « cet élément étant inopérant pour la détermination de cette qualité ».
On comptait en 2018, 35 297 titulaires de la carte de presse française. Il s’agit d’une carte d’identité professionnelle non obligatoire, qui permet à ceux qui la détiennent de prouver leur activité et d’accéder plus facilement à certains lieux ou à certaines informations. Pour l’obtenir et surtout la conserver au fil des années d’exercice du métier, il est nécessaire que 50 % au moins de ses revenus proviennent d’activités de journaliste, avec un plancher établi autour de 700 euros brut.
Il est à noter également que le mot « journaliste » recouvre des réalités différentes. Entre le reporter qui tourne des images sur le terrain, le secrétaire de rédaction, l’infographiste, l’éditorialiste, le fait-diversier ou le community manager, peu de ressemblances. Et pourtant, une ambition de respecter des règles morales communes, de faire preuve d’honnêteté et de s’adresser au public dans le sens le plus large du terme.
Et justement, ce qui rassemble les journalistes, ou est supposé les rassembler, c’est un ensemble de règles de déontologie qu’ils s’engagent à respecter et qui est le socle de leur pratique professionnelle au quotidien.
Cette déontologie est définie par deux textes de référence5 mais à aucun moment les outrepasser ne contraindrait en France un journaliste à rendre, symboliquement, sa carte de presse. Même les débats qui précédaient la création d’un conseil de presse ont, dès l’origine, exclu toute mesure coercitive ou sanction possible à l’encontre de journalistes « contrevenants ». Trop dangereux. Sur quelles bases sanctionner ? Qui pour instruire et juger ? Quelles conséquences pour la liberté de la presse et le droit du citoyen à être informé ?
Compagnonnage, sur le tas, à l’école…
La transmission de ces règles communément admises de bonnes pratiques professionnelles s’est, de tous temps, exercée sur le principe simple du compagnonnage entre journalistes expérimentés et débutants, au sein même des rédactions. Avant que les écoles reconnues ne se développent, ce savoir n’était pas formalisé, les chartes pas obligatoirement transmises ou portées à la connaissance du jeune journaliste et la maîtrise de cette éthique professionnelle s’acquérait de manière empirique, sur un temps plus ou moins long. Les syndicats de journalistes étaient, eux aussi, des vecteurs de transmission de ces bonnes pratiques.
Et comme le relève Thomas Ferenczi6 :
Cette professionnalisation de la formation des journalistes, qui entrent désormais dans l’entreprise mieux formés, mieux préparés à l’exercice du métier, plus sûrs de leurs compétences, rend plus aléatoire la pratique traditionnelle du tutorat des anciens auprès des jeunes. Les jeunes estiment en effet avoir peu à apprendre de leurs aînés et le leur font quelquefois savoir, tandis que les anciens hésitent à jouer auprès d’eux les maîtres d’école.
Aujourd’hui, 19 % des journalistes titulaires d’une carte de presse sortent d’une des 14 filières reconnues (2017). Tous les journalistes ne sont donc pas obligatoirement formés à leur métier dans des cursus spécifiques. Contrairement au médecin, dont le diplôme d’État de docteur en médecine est indispensable pour exercer, le journaliste peut se lancer sans formation spéciale.
Pas de carte professionnelle obligatoire, on l’a vu, mais pas non plus d’école obligatoire. Du moins sur le papier, car on le verra, intégrer aujourd’hui une entreprise de média sans passer par une école professionnelle reconnue relève du parcours du combattant et menace plus encore le jeune journaliste de la précarité.
« L’idée de former les futurs journalistes naît conjointement, à la toute fin du 19e siècle, dans les entreprises médias, les organisations professionnelles et dans l’enseignement supérieur […] c’est à l’École libre des hautes études sociales qu’est lancé le premier cycle de formation en 1899 », rappelle un livret de la Conférence nationale des métiers du journalisme (CNMJ)7.
La démarche ne fait pourtant pas consensus. Léon Daudet, dans son Bréviaire du journalisme8, fait état des doutes qui agitent la profession au début du XXe siècle :
Il a été souvent question d’instituer une école des journalistes, dans le genre de l’école des Sciences politiques, mais je ne vois guère la possibilité d’une pareille institution. Qui professerait à cette école ? Cela me paraît aussi puéril qu’une école d’orateurs, ou qu’une école de parlementaires.
Pour lui, à l’époque, le journalisme est le fruit d’un enseignement non spécifique, même si l’on a depuis montré que si.
En 1998, l’ancien rédacteur en chef du Monde Claude Sales (1930-2016) s’interroge : « Peut-on vraiment enseigner le journalisme ? » dans son rapport9 remis à la ministre de la Culture et de la Communication.
Le journalisme fait partie de ces savoirs non-écrits qui se transmettent plus dans l’action que dans la théorie. Mais dans ce « sur le tas », il n’y a pas seulement une pratique individuelle, il y a mille autres savoirs que sont par exemple le travail en équipe, les échanges avec les confrères confirmés, l’aide qu’ils peuvent apporter, la participation à des conférences de rédaction, la relecture de la copie par la rédaction en chef, l’apprentissage de contraintes techniques et commerciales… la découverte aussi parfois qu’un journal s’adresse à des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour un autre journal. Il ne faut pas seulement aimer l’information, il faut aussi aimer ses lecteurs.
Les responsables d’école sont conscients de la difficulté de cet apprentissage fondamental – commun à tous les journalistes – quel que soit le lieu de leur métier. Mais ils n’insisteront jamais assez sur ces principes de base que sont la recherche de l’information, la vérification des sources, la connaissance des dossiers, le doute sur soi-même, la critique des idées reçues… et la mise en forme, l’écriture pour le lecteur ou le téléspectateur. Tous les exercices qui vont dans ce sens – de la simple réalisation d’une enquête aux journaux-école et cela dans tous les types de presse – sont bénéfiques. Ils ne remplacent pas le « sur le tas », mais le préparent efficacement.
Aujourd’hui, en France, les quatorze filières reconnues par la profession10 doivent satisfaire à un certain nombre de critères examinés par la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ). Les étudiants qui intègrent une école reconnue ont la garantie de recevoir une formation de qualité, notamment en termes de professionnalisation et de stages. Certains médias réservent d’ailleurs leur concours d’accès exclusivement aux étudiants sortants de ces écoles, notamment dans l’audiovisuel public.
C’est une spécificité du milieu : les médias sont très présents dans la formation de leurs futurs journalistes. Par le biais des stages et de l’apprentissage, mais aussi grâce aux prix et concours qui récompensent de jeunes journalistes sous forme de contrats à la sortie de l’école. « Ces prix constituent des rites de passage qui marquent un moment fort à l’heure de la sortie des centres de formation et au moment d’entrer sur le marché du travail. Ils sont la garantie de débouchés minimums pour les écoles et leurs étudiants », analyse Céline Pigalle11, directrice de la rédaction de BFM TV et elle-même ancienne lauréate de la bourse Lauga d’Europe 1, vice-présidente du CA de l’ESJ Lille.
En parallèle des écoles reconnues, il existe une centaine de formations non reconnues au journalisme, parfois onéreuses. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) est très clair sur le sujet12 : « le problème ne se situe pas au niveau des […] écoles actuellement reconnues […] mais résulte bien de l’existence de dizaines d’autres formations qui n’ont souvent de journalisme que le nom, et cultivent une approche de l’information et de la profession qui ne correspond que très partiellement aux objectifs ». Certaines de ces écoles proposent notamment des cursus mêlant journalisme et communication, et en cela franchissent la ligne rouge : on ne forme pas dans les mêmes filières journalistes et communicants.
Dans les écoles reconnues, les programmes reposent sur une double exigence : l’approfondissement des savoirs académiques et déontologiques, ainsi que l’apprentissage concret du métier par la pratique. L’ensemble de la pédagogie repose sur la volonté immuable de poser les jalons de la future vie professionnelle des étudiants. Les responsables de ces établissements, à la fois sur la base du référentiel que de leurs identités, ont bien conscience de la fragilité de l’écosystème qui attend les étudiants. Ils sont eux-mêmes journalistes, ce qui est l’une des spécificités de l’enseignement du journalisme en France.
Le rôle des pairs
C’est en effet une particularité de la formation au métier de journaliste : le rôle des pairs est prépondérant. Créée en 1924, l’ESJ Lille est prise en charge par ses anciens élèves en 1960. Ils fondent, selon la loi française de 1901, l’Association de l’École supérieure de journalisme de Lille, habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre de la formation des cadres moyens et supérieurs. Dans un souci d’indépendance, à l’époque les anciens ont préféré ne pas déléguer la formation de leurs futurs collègues à l’université, et a fortiori à l’État. Idem pour le Centre de formation des journalistes (CFJ), en 1946, qui est également une association indépendante.
Aujourd’hui, le contexte de l’enseignement supérieur a largement évolué et la plupart des écoles ont fini par être rattachées à des universités mais fonctionnent avec des départements indépendants, notamment sur le volet recrutement des permanents et des formateurs. Petites structures avec de modestes effectifs au regard de leurs universités partenaires, elles ont parfois dû développer leurs activités pour assurer leur survie économique. Mais elles ne lâchent pas sur l’essentiel : un budget autonome et une gouvernance dédiée.
Plusieurs centaines d’écoles de journalisme du monde entier réunies à Paris en juillet 2019 en Congrès mondial13, ont tenu à réaffirmer cette nécessité d’indépendance. La Paris Declaration on Freedom of Journalism Education (« Déclaration de Paris pour la liberté d’enseignement du journalisme ») a été solennellement adoptée pour « faire comprendre à leurs autorités la spécificité de l’enseignement du journalisme tant du point de vue académique que de celui des ressources ».
Les signataires y plaident que « la formation au journalisme a un rôle fondamental », et appellent « les départements nationaux de l’éducation, les industries médiatiques, les entreprises privées et les donateurs, y compris les donateurs internationaux, à assurer un financement suffisant à l’enseignement du journalisme tout en respectant son indépendance ». Et d’énoncer comme priorités : « Préserver l’enseignement du journalisme en tant que champ distinct par rapport aux autres domaines de la communication » et « Encourager un esprit critique dans la recherche sur l’enseignement du journalisme, y compris en ce qui concerne les innovations en matière de pédagogie, les expériences, les pratiques journalistiques et les modèles d’affaires ».
Les acteurs du milieu ont donc ressenti le besoin de réaffirmer la spécificité du journalisme et de clamer haut et fort cette nécessaire indépendance.
On l’a vu, la défiance du public est à son comble, la désinformation fait du chemin, les pressions engagées par les communicants à l’égard des journalistes pour leur faire avaler un message dans un sens ou dans l’autre, mais aussi les pressions économiques et politiques poussent les journalistes dans leurs retranchements : plus que jamais, leur formation est fondamentale.
« Agilité intellectuelle »
On enjoint donc les apprentis journalistes à revenir aux fondamentaux du métier : rechercher les informations, recouper les sources, vérifier les faits, connaître ses dossiers, mettre en perspective et contextualiser… Ces principes et valeurs s’enseignent.
Avec un objectif caractérisé, que Rémy Rieffel, alors du directeur du Master professionnel en journalisme à l’Institut français de presse, résume particulièrement bien14:
La plus importante de ces compétences est d’acquérir le sens de la complexité des choses, de faire preuve d’agilité intellectuelle et non pas uniquement de posséder l’art de la simplification comme on a un peu trop tendance à le marteler. Le journaliste n’est pas un pur technicien qu’il conviendrait de former (ou de formater) en fonction des attentes du marché : il est avant tout un capteur et un déchiffreur de la réalité qui nous entoure. La seconde qualité d’un journaliste, outre celle d’être précis et rigoureux, est d’être un médiateur digne de ce nom, autrement dit d’être capable d’aider le public, non seulement à démêler l’écheveau de l’actualité, mais aussi à se sentir concerné par les enjeux du monde contemporain. Enfin, un bon journaliste est un professionnel conscient de ses responsabilités, capable de prendre du recul par rapport à la pratique de son métier, de s’interroger sans cesse sur sa démarche informative et de mettre en œuvre une sorte d’auto-réflexivité.
Et pourtant, les étudiants en journalisme aujourd’hui se sentent beaucoup plus concernés par les cours pratiques que par les analyses qui entourent « le geste », notamment la prise de conscience de leur responsabilité sociale. Charge à leurs instructeurs de défendre une conception exigeante et réaliste du métier. Charge à eux de sortir les jeunes journalistes d’une conception parfois hors-sol de leur vocation.
Qui sont les étudiants
en journalisme aujourd’hui ?
En arrivant dans les écoles pour y intégrer des masters professionnels reconnus, ils ont déjà passé plusieurs années assis sur les bancs de l’université et sont dans les starting block, veulent enfin ouvrir le moteur et y mettre les mains. Bons élèves – pour avoir déjà passé plusieurs filtres sélectifs – ils disposent d’un capital culturel certain et d’un bagage de connaissances théoriques en sciences politiques et en histoire notamment, de même qu’ils maîtrisent un anglais fluent qui sera sans conteste un atout lorsqu’ils exerceront leur métier. Il leur reste notamment beaucoup à apprendre de leur futur environnement professionnel. L’écosystème des médias aujourd’hui ne génère pas de besoins considérables de journalistes traitant des sujets de leur choix. D’autres au contraire, émergent. Le rôle des écoles consiste souvent à rappeler le principe de réalité, sans entamer désirs et enthousiasmes, qui restent de puissants moteurs pour exercer ce métier.
Les écoles de journalisme mettent en avant la pédagogie par l’expérience. Les étudiants réalisent des articles, des sujets télé et radio, en temps réel et s’organisent en rédaction constituée, comme dans une vraie rédaction. C’est en faisant qu’on apprend.
Parfaire ces techniques passe aussi par la confrontation avec le milieu professionnel lors des stages. Dans les écoles de journalisme reconnues, « le cursus de formation doit comprendre obligatoirement plusieurs stages pratiques dans différents médias d’information », selon les critères de reconnaissance de la CPNEJ, réactualisés en 200815.
Stage qui est aussi une voie d’accès au premier emploi. Il peut déboucher sur un contrat, des piges, une collaboration plus ou moins longue et sécurisée entre l’ex-étudiant et le média.
Un écueil relevé par Claude Sales dans Les écoles de journalisme : analyse d’un malaise pose question. Comme le résument Nicolas Pelissier et Denis Ruellan, « les recruteurs dans les médias se montrent soucieux de voir les diplômés possédant une solide culture générale, mais leur problème principal est de disposer de jeunes immédiatement utilisables, sans temps d’adaptation, parfaitement formatés aux techniques et usages… afin notamment de remplacer les absents pour congés ou maladies. »16 Certes, on peut voir des limites à l’utilitarisme et au pragmatisme des médias. Mais l’intégration dans la profession est un objectif, pour les responsables pédagogiques d’une école. Et ces remplacements peuvent être une manière de mettre « le pied dans la porte » pour des jeunes journalistes qui ont à cœur de commencer à travailler.
Car l’insertion est de plus en plus compliquée. D’après l’Observatoire des métiers de la presse, les jeunes sont surreprésentés parmi les contrats précaires17. S’il n’est en rien une garantie, le fait d’être diplômé permet de travailler plus rapidement, l’âge moyen des journalistes encartés pour la première fois reculant de 5 ans pour les journalistes formés « sur le tas » : 31,1 ans en moyenne en 2017 contre 26,4 ans pour ceux qui ont fait une école reconnue. Les journalistes en contrat à durée indéterminée issus d’écoles reconnues gagnent par ailleurs mieux leur vie que les autres (3914 € contre 3506 € en moyenne à poste équivalent).
Les écoles sont tenues d’innover
Mais les cursus ne sont pas exclusivement conçus pour former des jeunes journalistes « employables ». Longtemps, les écoles ont couru derrière les médias en essayant d’adapter leurs contenus de formation aux initiatives mises en place dans les rédactions. « Les écoles de journalisme sont de véritables laboratoires de l’avenir de la profession », défend aujourd’hui Pascal Guénée, directeur de l’IPJ18. On peut identifier trois grandes logiques d’innovation dans ce sens.
La première est une spécificité de l’évolution des méthodes pédagogiques et consiste à travailler en mode projets, en responsabilisant les étudiants sur des projets ponctuels et thématiques. L’objectif est d’éviter l’empilement de sessions pour privilégier le temps long. La deuxième vise à pousser les étudiants à emprunter d’autres voies d’accès au métier que celles qui sont les plus classiques en les sensibilisant à la création de médias, avec des équipes pluridisciplinaires représentant d’autres corps de métier (graphistes, développeurs et commerciaux pour l’essentiel). Enfin, l’innovation pédagogique passe par l’innovation technologique : les écoles expérimentent en la matière (vidéo 360, VR, serious game, animation graphique, utilisation de son binaural…) afin de développer l’agilité et la créativité des journalistes de demain.
Il fut un temps où l’on avait une tendance à considérer que chacun devait rester dans son domaine de compétence, et que les journalistes n’avaient pas à s’intéresser à autre chose qu’à leur mission. Ce temps est révolu, et c’est très probablement une excellente nouvelle, dans l’optique de (re)tisser un lien de confiance solide avec le public. L’enseignement du journalisme n’a de sens que s’il répond aux défis présents et à venir de la profession.
Tous les débats ne sont pas encore tranchés
Chaque année, les contenus des cursus évoluent, intégrant notamment des projets qui diffèrent par essence puisqu’ils sont liés à l’actualité (élections, événements sociaux marquants, tendances sociétales…). C’est une vraie dynamique créative, une souplesse extrêmement salutaire qui permet aux étudiants d’être au plus près des débats qui irradient la profession.
Toutefois, certaines questions ne trouvent pas de réponse définitive. En premier lieu, le dosage de l’expertise dans l’enseignement prodigué. Par définition, et c’est ainsi que la CPNEJ l’indique dans les critères de reconnaissances, les étudiants doivent suivre une formation polyvalente (tous les types de médias) et généraliste (toutes les thématiques). Ils sont appelés à devenir des journalistes généralistes, capables de traiter aussi bien du sport que d’un fait divers, un meeting politique ou une pièce d’opéra classique. On voit bien les limites de l’exercice. Mais c’est dans un souci de compréhension globale du métier, tout autant et de plus en plus, que d’insertion professionnelle, qu’il convient d’avoir plusieurs cordes à son arc lorsqu’on est à la porte des rédactions.
On voit bien aussi l’intérêt des médias dans l’organisation quotidienne des équipes, avec des effectifs serrés, de pouvoir faire tourner les journalistes sur des postes différents en fonction des agendas et des forces en présence plus qu’en fonction de leur profil.
Ce qui vaut en début de carrière s’estompe bien sûr au fil du temps. Sans devenir des spécialistes, les journalistes, à force de traiter plutôt l’économie ou plutôt la chronique judiciaire, finissent par développer une expertise, fort utile lorsqu’il s’agit de croiser le fer avec un expert ou un politique.
Dans son rapport en 1998 déjà, Claude Sales soulevait déjà cette question : « On ne va pas demander à des journalistes de devenir des experts en tout. Mais la multiplication de cette pratique conduit à s’interroger. Il serait dommageable que les journalistes ne soient que les porte-caméra, porte-micro ou porte-plume des experts. »
Autre questionnement : l’écriture s’apprend-elle à l’école ? Les étudiants qui arrivent dans les cursus reconnus ont déjà fait trois ans d’études au minimum. Pour la plupart, ils ont déjà une formation académique et il peut sembler bien tardif de leur apprendre des techniques d’écriture. Pour autant, le temps de formation nous semble idéal pour travailler son style, l’affiner, l’affirmer. Le soin porté à l’écriture nous paraît fondamental, et peut faire la différence au moment du recrutement. À l’ESJ Lille, par exemple, nous organisons des ateliers d’écriture avec des journalistes et des écrivains : en faisant des ponts entre littérature et récit journalistique, les étudiants s’entraînent à raconter une histoire.
De la même manière, on peut s’interroger sur la pertinence de former de jeunes adultes à une forme de « savoir-être », les soft skills si prisées en entreprise. Ce terme regroupe des compétences humaines qui relèvent peut-être parfois plus de l’éducation que de la formation professionnelle, mais qui semblent essentielles aujourd’hui et parfois déterminantes à l’embauche. Généralement, le flair, le bon sens, la créativité, la débrouillardise semblent difficiles à enseigner. Mais ils se travaillent, dans chaque session, lorsque les formateurs débriefent le fond des sujets tout autant que les comportements des étudiants.
Bashing des écoles de journalisme
Le propre de la pédagogie du journalisme est de ne pas être figée. Et, normal, l’état des lieux est soumis à la critique. Les étudiants en journalisme sont observés à la loupe. Moins pour des raisons corporatistes que parce que de leur formation découlent des pratiques qui ont elles-mêmes des incidences sur la manière dont est produite une information de qualité, pilier de la démocratie.
Toujours ce même paradoxe, les concours des écoles n’ont jamais attiré autant de candidats et pourtant, les critiques, parfois véhémentes, se font entendre et trouvent même des caisses de résonance jusque dans les rencontres professionnelles19 sur l’entre-soi qu’elles alimenteraient.
François Ruffin, journaliste formé au CFJ, aujourd’hui député France insoumise, a commencé dès 200320 à les accuser de formatage caractérisé. Il y voit à l’époque une formation à un métier « insipide, aéfepéisé, routinisé, markétisé, sans risque et sans révolte, dépourvu de toute espérance ». Il reproche surtout aux écoles (sélectives, à droits universitaires parfois élevés21) la reproduction des élites tant décriée dans l’enseignement supérieur en France. Et en effet, selon les sociologues Dominique Marchetti et Géraud Lafarge, 52,7 % des étudiants en journalisme ont des pères cadres ou membres de professions intellectuelles supérieures alors que ces catégories ne représentent que 18,5 % de la population active masculine française en 200522. Inversement, les ouvriers, soit 35,3 % de la population active en 2005, sont représentés à hauteur de 10,4 % dans les promotions étudiées.
Mais si uniformité sociologique il y a (et il y a) elle se fabrique bien en amont des écoles de journalisme : accès aux bons établissements, aux bonnes filières menant aux grandes écoles. Le débat est bien plus large, il n’en reste pas moins pertinent. Est-ce que des rédactions uniformes vont rendre compte de la diversité des vies et préoccupations de nos concitoyens dans les médias ? Tout ce qui passe sous les radars médiatiques n’est-il pas invisible parce que la plupart des journalistes, de là où ils viennent, n’ont pas les bonnes lunettes pour l’observer ? Ainsi les journalistes, censés comprendre et décrypter la société ne seraient pas représentatifs – et donc pas aptes à remplir cette tâche. Malgré eux, ils seraient des victimes du déterminisme de la reproduction sociale.
L’entrée sur concours dans les écoles de journalisme fonctionne comme un plafond de verre sur lequel se cognent les jeunes issus des milieux moins favorisés. Ils n’ont pas forcément le bagage culturel exigé (ils en ont un autre, mais il n’est guère sollicité), pas les codes, l’aisance, les voyages et séjours à l’étranger, etc.
Dans ses « Sept propositions sur la formation des journalistes » (2008), le SNJ
pose la question d’une plus grande « socialisation » des études de journalisme, et donc de l’accès aux bourses pour les étudiants qui ne peuvent assumer seuls les frais élevés de la scolarité. Une question qui n’est pas sans conséquence sur le profil des jeunes diplômés et « l’uniformité » de pensée regrettée par certains.
Mais qui pour financer ce bien commun qu’est l’information de qualité, variée et sans œillères ?
Diverses initiatives telles que la Prépa égalité des chances (ESJ Lille) ou La Chance (créée par des anciens du CFJ) viennent contrebalancer ces critiques. Créée en 2009 avec le Bondy Blog, la Prépa égalité des chances est une préparation entièrement gratuite aux concours d’entrée des écoles reconnues pour les jeunes issus de familles aux revenus modestes. Même concept à La Chance aux concours, qui existe depuis 2007 dans le but de rééquilibrer la donne face aux prépas privées. Dans les écoles ensuite, les droits d’entrée sont corrélés aux revenus des parents (et échelonnés pour les boursiers).
Rémy Rieffel le disait il y a plus de dix ans dans : « Une formation idéale serait donc constituée de promotions d’étudiants aux couleurs de l’arc-en-ciel, reflétant la bigarrure de la société actuelle et la mosaïque des conditions sociales. » (op. cit.) On en est loin même si la préoccupation est désormais largement partagée. C’est en effet de la responsabilité de tous, pas uniquement des écoles de journalisme.
Vers un journalisme responsable
Aux yeux du public, le journaliste doit être irréprochable. C’est ambitieux. Œuvrons déjà pour qu’il soit responsable ou même, encore plus modestement, conscient de ses responsabilités, comme le résume Benoît Grevisse, directeur de l’école de journalisme de Louvain23 :
S’il se veut responsable, l’enseignement journalistique doit garder les deux pieds bien campés dans la réalité, et la tête dans la mise en critique perpétuelle. La capacité de prise de distance analytique des enjeux sociaux et politiques, dans le temps de l’action journalistique – c’est-à-dire avec aussi toutes les imperfections, la modestie et la relativité de l’immédiateté – est la compétence intellectuelle essentielle que l’étudiant en journalisme se doit d’acquérir. Sans elle, il lui sera bien difficile de proposer un traitement de l’information répondant aux attentes légitimes du public.
L’étudiant en journalisme est aussi acteur de son destin et peut apporter sa pierre à l’évolution de la profession. Il lui faut être rigoureux, vigilant, attentif et surtout en lien constant avec le public. De nombreux professionnels diversifient leurs activités purement journalistiques pour s’impliquer dans d’ambitieux programmes d’éducation aux médias, convaincus que la pédagogie de l’information est désormais aussi une compétence professionnelle.
Ils fréquentent salles de classe et centres de documentation, dialoguent avec les enseignants, tentent des percées sur le terrain social, centres sociaux et maisons de quartier, animent des sessions pratiques qui amènent les jeunes à se retrouver en position de journalistes. Existe-t-il une meilleure manière de mesurer les enjeux du sens et du poids de l’information que « jouer » à être journaliste ? À l’ESJ Lille, depuis trois ans, les étudiants sont formés à l’éducation aux médias et sortent de l’école armés d’une boîte à outils professionnelle, qui leur permet de répondre à la défiance du public, quand elle les rattrape au coin d’une rue : expliquer, dialoguer, admettre des fragilités et des failles dans le système, descendre de son poste d’observation, voire de son piédestal, pour agir avec d’autres citoyens, d’autres acteurs de la démocratie. Cette compétence, à la fois humble et ambitieuse, peut aussi s’acquérir dans une école de journalisme. 
Charlotte Menegaux est responsable du Master et Corinne Vanmerri, directrice des études
à l’École supérieure de journalisme de Lille.
1
Les auteures de cet article font partie du jury d’admission à l’ESJ Lille.
232e Baromètre de la confiance des Français dans les médias, réalisé par Kantar (ex-TNS Sofres) pour La Croix. Enquête réalisée du 3 au 7 janvier 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1 024 personnes de 18 ans et plus. 69 % des sondés pensent que les journalistes sont soumis aux pressions des partis politiques et du pouvoir, et 62 % aux pressions de l’argent. En 2019, la télévision perd 10 points de crédibilité par rapport à 2018, et chute à 38 % de confiance. Même constat pour la presse écrite qui perd 8 points (44 %). La radio, traditionnellement jugée plus crédible, perd 6 points et sauve à peu près les meubles : un Français sur deux (50 %) la juge fiable. Les médias web sont quant à eux traditionnellement jugés le moins crédible par les personnes interrogées : ce qui est toujours le cas avec un sondé sur quatre qui pense qu’internet est digne de confiance.
3France Info, le 26 avril 2019.
4Arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2016 (15-13.698)
5La Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, ou Charte de Munich, ratifiée au niveau européen en 1971 et posant les dix devoirs et cinq droits de cette profession. Et aussi, la Charte d’éthique professionnelle des journalistes rédigée par le Syndicat national des journalistes en 1918 (et modifiée en 1938 et en 2011), qui rappelle au journaliste « digne de ce nom » que sa responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre.
6Journalisme : la transmission informelle des savoir être et savoir-faire, Bruxelles, AIJ, 2010, p. 27.
7La place des entreprises médias dans la formation des journalistes, Paris, 2017, p. 7.
8Bréviaire du journalisme, Paris, Gallimard, 1936, p. 132.
9La Formation des journalistes, Paris, 1998.
10Le CUEJ à Strasbourg, l’EJCAM à Marseille, l’EJDG à Grenoble, l’EJT à Toulouse, l’ESJ à Lille, l’IJBA à Bordeaux, le CELSA, le CFJ, l’École de journalisme de Sciences po, l’IFP, et l’IPJ à Paris, ainsi que depuis 2018 l’EPJT à Tours, proposent un diplôme niveau Master. Les IUT (instituts universitaires de technologie) de Lannion et de Cannes recrutent quant à eux des bacheliers et les préparent à un DUT (diplôme universitaire de technologie).
11In La place des entreprises médias dans la formation des journalistes, op. cit., p. 30.
12États généraux de la presse écrite – Sept propositions sur la formation des journalistes. Pôle « Métiers du journalisme », contribution du SNJ, le 22 octobre 2008.
13Le WJEC (World Journalism Education Congress) s’est tenu du 9 au 11 juillet 2019 à l’Université Paris Dauphine-PSL, dont l’Institut pratique de journalisme (IPJ) est un des quatorze membres de la Conférence française des écoles de journalisme (CEJ).
14« Éloge des regards croisés », MédiaMorphoses, 24, 2008, p. 40.
15La durée totale des périodes passées en entreprise au cours de l’ensemble du cursus ne peut être ni inférieure à 6 semaines ni supérieure à 26 semaines.
16« Les journalistes contre leur formation », Hermès, 35, 2003, p. 9
17En 2017, 42,8 % des moins de 26 ans ont le statut de pigiste (contre 31,1 % pour les 26-35 ans, puis 15,6 % pour les 36-45 ans). Les moins de 26 ans sont également 36,6 % en CDD (contre 6,7 % des 26-35 ans et 1,2 % des 36-45 ans).
18Entretien publié dans Le Monde, le 8 juillet 2019.
19Débat « Étudiants en journalisme, tous les mêmes ? », 15 mars 2019, Tours.
20Les Petits Soldats du journalisme, Paris, Les Arènes, 2003.
21Pour les non-boursiers, de 3 000 à 14 000 euros l’année selon les écoles.
22« Les portes fermées du journalisme », Actes de la recherche en sciences sociales, 189, 2011. L’étude en question repose sur des questionnaires soumis en 2004-2005 aux 328 admis des écoles reconnues.
23« L’école idéale n’existe pas... Il faut l’inventer. Toujours. », MédiaMorphoses, 24, 2008, p. 52)
Référence de publication (ISO 690) :MENEGAUX, Charlotte, et VANMERRIS, Corinne. Faut-il encore former (ne pensez pas formater) les journalistes ? Les Cahiers du journalisme - Débats, 2020, vol. 2, n°5, p. D31-D41.
DOI:10.31188/CaJsm.2(5).2020.D031






