 |
Nouvelle série, n°5
Été 2020 |
 |
||
|
RECHERCHES |
||||
|
TÉLÉCHARGER LA SECTION |
SOMMAIRE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
NOTE DE LECTURE
Michèle Ouimet : Partir pour raconter
Mathieu-Robert Sauvé
E
n 25 ans de carrière, la reporter québécoise Michèle Ouimet est partie en mission journalistique l’équivalent de trois années complètes. Rwanda, Iran, Pakistan, Afghanistan, Syrie, Mali, Égypte. Crise humanitaire, guerre civile, soulèvement populaire, elle était presque toujours partante quand ses patrons du quotidien montréalais La Presse lui proposaient de l’envoyer au bout du monde, parfois à moins de 24 heures d’avis. Le titre de son livre publié chez Boréal à l’occasion de son retrait de la vie professionnelle, Partir pour raconter, est à l’image de sa prose : sans artifice, sans lyrisme.
« La guerre m’a toujours fascinée : sa brutalité, son absurdité, ses dégâts effroyables », écrit-elle. « La plupart du temps, c’est moi qui proposais de partir pour couvrir un conflit, une révolution ou un désastre naturel. J’avais l’impression de vivre branchée sur la planète, sensible à chaque soubresaut, sentant l’urgence d’aller là où tout chavirait » (p. 204).
Pourtant, elle ne se définit pas comme une journaliste de guerre, un genre qu’elle a côtoyé de près. Des hommes souvent excités par l’action, toujours entre deux avions. « Je ne couvrais pas la guerre à temps plein, loin de là. J’en aurais été incapable. J’étais basée à Montréal et je faisais un ou deux reportages par année, parfois d’avantage, sans plus. Les reporters de guerre ont des nerfs d’acier, ils sont bien organisés et ils semblent n’avoir peur de rien. Là non plus, je ne me reconnaissais pas » (p. 204).
Pour Michèle Ouimet, il y a quelque chose d’irrépressible dans ce besoin de partir à l’étranger quand l’attention médiatique converge vers un endroit chaud. Un bon exemple est ce jour de janvier 2011 quand elle regarde distraitement le téléviseur qui montre des images du soulèvement de la population égyptienne. Elle travaille alors sur la survie d’une maison patrimoniale menacée par le pic des démolisseurs, à Montréal, et se dit qu’elle ne connaît rien de l’Égypte à l’exception des pyramides. Son patron, Éric Trottier, la convoque à son bureau pour lui demander si elle partirait au Caire : « Il faudrait que tu partes ce soir. »
Elle accepte. Elle lira dans l’avion tout ce qu’elle peut sur les manifestations de la place Tahrir et passera plusieurs jours à fréquenter les Égyptiens, parfois au péril de sa vie. C’est que les journalistes ne jouissent plus de l’impunité qui les gardait jadis dans une relative sécurité dans les conflits civils. Ils sont même parfois pris pour cibles, car considérés par certains comme des combattants ennemis. C’est le cas au Caire d’où la journaliste s’extirpera sans encombre.
Un mot sur la formation de Ouimet, ou plus précisément sur sa non-formation, car elle fait partie de cette génération de reporters arrivés sans diplôme universitaire dans les salles de presse. Elle a été caissière, réceptionniste, chargée de cours, vendeuse mais elle n’a jamais pensé devenir journaliste. Elle vend des bijoux dans un centre commercial quand elle se prend à rêver, à 26 ans, d’une « impossible carrière de journaliste ».
Entrée par la petite porte – elle apprend les rudiments de la collecte d’information comme recherchiste pour Télé-Québec puis Radio-Canada – elle obtient un poste régulier pour la presse écrite à 34 ans. En quelques années, elle s’illustrera comme l’une des reporters les plus productives du Canada en zone de conflit.
La lecture d’un dossier complexe dans l’avion n’est pas la façon habituelle de travailler de Ouimet, qui a bourlingué de par le monde dès le début de sa vie adulte. À partir des années 1980, elle deviendra une habituée des pays arabes. Elle promènera son calepin en Algérie en 1992, en Iran en 1995, en Afghanistan en 1996 (elle y retournera deux fois par la suite), au Pakistan en 2001, en Syrie en 2012 et en 2013, et en Arabie Saoudite en 2017. Elle ne refusera pas l’occasion de se rendre au Liban, au Mali et au Rwanda.
Dans Partir pour raconter, les anecdotes sont nombreuses, parfois poignantes. Elle relate sa marche sur des cadavres au Rwanda – elle qui n’avait jamais vu de morts sauf au salon funéraire – et cet enfant de deux ans, Jérôme, qui tétait le sein de sa mère morte. « Je note tout en pleurant et en tremblant. Les tremblements et les pleurs ont commencé à mon réveil. Je suis incapable de les contrôler. Je remets mon calepin dans mon sac et j’embarque dans la jeep. Les tremblements continuent, et les pleurs aussi. Je sens que quelque chose s’est détraqué en moi. »
L’ouvrage de Ouimet est un témoignage précieux de cette sous-espèce spécialisée dans la couverture de zones dangereuses. Au Québec, Jean-François Lépine avait fait œuvre utile en publiant en 2014 Sur la ligne de feu, relatant ses 42 ans de carrière en Afrique du Sud, au Liban et dans plusieurs pays arabes. Ouimet, grande reporter récompensée pour avoir révélé un secret d’État – on torturait les prisonniers en Afghanistan sous l’œil des pays engagés dans la guerre – reprend là où Lépine a laissé, pourrait-on dire. À cette différence près que Lépine n’avait pas à porter de hijab ou de burqa pour faire ses interviews.
Partir pour raconter n’est pas un ouvrage pour théoriciens des communications. Il est en revanche un excellent condensé des défis de l’envoyée spéciale. Même parmi les journalistes, ce missionnaire est parfois mal compris. Quand la nouvelle de son départ en Algérie est confirmée à la salle de rédaction, en 1992, Ouimet ne se sent guère appuyée dans sa démarche. « Une poignée de journalistes travaillent à la section internationale. Ils voyagent peu, ils passent le plus clair de leur temps à récrire des dépêches d’agences de presse. L’un d’eux, Jooneed Khan, me regarde de haut lorsque je lui dis que je pars en Algérie. Qui suis-je, reporter sans expérience, femme de surcroît, pour m’aventurer dans un pays sur le point de basculer ? »
Elle tiendra bon, mais elle a alors beaucoup à apprendre (elle le reconnaîtra par la suite). Et elle apprendra à trouver des « fixeurs » fiables avant de partir et à transporter avec elle suffisamment d’argent pour assurer son autonomie en cas de rupture de courant – ça peut aller jusqu’à 15 000 $ en liquide.
Un chapitre complet de son livre porte sur ces maillons essentiels des baroudeurs de l’info. L’Afghan Akbar1, qui est fixeur pour quelques journalistes étrangers (il maîtrise six langues), voit sa vie menacée quand les talibans l’accusent de travailler pour l’ennemi. « En 2009, un reportage sur les écoles brûlées par les talibans à Kandahar a mal tourné. Le journaliste français avait commis une erreur. Il a inclus dans sa liste une école qui n’avait pas été incendiée par les talibans. Furieux, les talibans ont convoqué Akbar devant un "tribunal" pour qu’il s’explique » (p. 165). Cette comparution a calmé les barbus mais le fixeur est demeuré sur leur liste noire. Un nouveau reportage, en 2013, a failli causer sa perte. « On va te chercher partout et on va vous tuer, toi et ta femme », lui a-t-on écrit.
Akbar, un homme résilient qui avait survécu à de nombreuses situations dangereuses, a dû se cacher pendant plusieurs mois. En 2015, il a embarqué avec ses proches dans un avion pour Paris. La diplomatie française venait d’émettre des visas grâce à l’intervention de la journaliste Valérie Rohart.
Au cours de ses voyages de presse dans les républiques islamiques, la journaliste a dû revêtir le vêtement de circonstance pour éviter les regards désapprobateurs, voire être carrément arrêtée par la police. « J’ai porté le voile intégral en reportage lorsque je n’avais pas le choix. Dès que je le mettais, j’avais l’impression de disparaître, d’être dépouillée de mon identité. Je déteste la burqa ou le niqab. Le voile intégral est encombrant, étouffant, humiliant » (p. 277). Mais derrière le tissu se tenait une représentante de la presse libre. Ça lui a permis de comprendre que certaines femmes épanouies portaient le voile avec fierté. « Je n’ai jamais aimé le voile, mais j’ai appris à le tolérer », écrit-elle.
Sans être un essai théorique, on l’a dit, Partir pour raconter soulève une question capitale et pernicieuse : pourquoi risquer sa vie à tendre le micro à des gens souffrants qui ont besoin de tout sauf d’un journaliste, à l’autre bout du monde ? L’opinion publique occidentale a-t-elle vraiment envie de savoir, entre deux vidéos de chats, que les prisonniers de guerre d’Afghanistan subissent de la torture sous l’œil fermé des pays alliés ? Et que peut-elle réellement contre les folies sanguinaires du prince Mohamed ben Samane ?
Disons que la réponse à cette question relève du choix éditorial. C’est une question de mandat. Mais le journalisme international n’est pas dans ses meilleures années. Selon l’American Journalism Review, 20 grands journaux américains ont fermé leurs bureaux à l’étranger entre 1998 et 2011 (Laurendeau, 2015). Évidemment, ils peuvent se rabattre sur des pigistes, mais ceux-ci sont le plus souvent mal payés et vulnérables, ce que confirme Ouimet dans son livre. Malgré leurs conditions de misère, ils prennent parfois d’énormes risques pour dénicher des exclusivités. Et s’il n’y a pas assez de morts dans leurs textes, ceux-ci sont jetés au panier.
Un des grands reporters internationaux francophones, le Français Paul Marchand, a vécu ainsi sur la brèche pendant plusieurs années avant de s’enlever la vie en 2009. Le réalisateur Guillaume de Fontenay vient de tourner un film basé sur ses mémoires éponymes, Sympathie pour le diable (1997). On le voit suivre avec son calepin des miliciens dans les rues de Sarajevo pour témoigner de la « réalité du terrain ». Il correspond à un type bien identifié par Ouimet : des hommes carburant à l’adrénaline et entretenant « une relation malsaine avec le danger ».
Pierre Sormany, dans Le métier de journaliste, note que la plus grande partie de l’information internationale diffusée au Québec provient de quatre agences de presse : AP, AFP, Reuters et UPI. Les grands réseaux américains – CNN, ABC, NBC, CBS – sont également d’importants fournisseurs d’images. « Heureusement, poursuit-il, les grands médias ont parfois aussi des correspondants à l’étranger. Il peut s’agir d’employés permanents de l’entreprise – ce qui est assez rare au Québec – ou de collaborateurs indépendants en poste dans diverses régions de la planète. Ils envoient aussi à l’occasion des journalistes maison en reportage à l’étranger. »
Actuellement, le seul réseau de télévision québécois qui peut compter sur des correspondants à l’étranger de façon permanente, à part TVA et son reporter à Washington, Richard Latendresse, c’est Radio-Canada. Basé sur le modèle de la BBC britannique, la société d’État a fait beaucoup pour le journalisme international au cours de son histoire. Dans les médias écrits, La Presse a régulièrement envoyé des reporters outre-frontières et Le Devoir tient le fort, surtout depuis l’attribution d’une subvention de 500 000 $ de la compagnie aérienne Air Transat.
C’est un métier où on doit assumer un risque certain. En 2014, 61 journalistes sont morts tandis que 221 reporters croupissaient en prison, selon le Comité pour la protection des journalistes (Laurendeau, 2015, p. 31). Ouimet relate ses contacts avec des journalistes James Foley – décapité en Syrie en 2014 – et Nicolas Hénin, capturé par des islamistes mais relâché après 10 mois de détention. Elle ne tente pas de dissimuler ses émotions. « Au-delà de la crainte des bombes et des enlèvements, je vivais avec une panoplie de peurs (p. 154). Peur d’être malade, peur des longues journées qui commençaient tôt le matin et finissaient tard le soir, une fois mon texte envoyé à Montréal, peur de ne pas tenir le coup. Je craignais aussi de ne pas être à la hauteur. »
Car, avec tout ça, il faut livrer un texte que le rédacteur en chef lira avec satisfaction et qu’il publiera en bonne position dans l’édition du lendemain. Ce facteur n’est pas à négliger ; le coût des journalistes à l’étranger est beaucoup plus élevé que celui d’un spécialiste du monde municipal – et même qu’un excellent chroniqueur. Même les meilleurs reportages n’attirent pas nécessairement des milliers de lecteurs et d’annonceurs.
Dans la série Nos témoins sur la ligne de feu2, de Marc Laurendeau (réalisation : Johanne Bertrand et Mathieu Beauchamp), le journaliste Jean-François Lépine décrit le travail de correspondant étranger comme la quintessence du métier. Lui qui a couvert certains événements historiques majeurs comme la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud dit qu’il est primordial, pour un public, d’avoir des reporters sur place là où l’histoire est en marche. 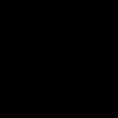
Michèle Ouimet (2019). Partir pour raconter. Montréal : Boréal, 296 p.
Mathieu-Robert Sauvé est journaliste et essayiste.
Notes
1Le patronyme n’est pas précisé.
2La similitude des titres n’est pas fortuite. C’est après son passage à l’émission de Marc Laurendeau que Lépine a décidé d’écrire ses mémoires. L’expression « sur la ligne de feu » fait référence à la série.
Références
Laurendeau, Marc (2015). Le journalisme international en bouleversement. Dans Robert Maltais et Pierre Cayouette (dirs), Les journalistes : Pour la survie du journalisme. Montréal : Québec Amérique.
Lépine, Jean-François (2014). Sur la ligne de feu. Montréal : Libre expression.
Marchand, Paul M. (1997). Sympathie pour le diable. Montréal : Lanctôt éditeur.
Sormany, Pierre (2011). Le métier de journaliste. Montréal : Boréal.
Référence de publication (ISO 690) : SAUVÉ, Mathieu-Robert. Michèle Ouimet : Partir pour raconter. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2020, vol. 2, n°5, p. R111-R114.
DOI:10.31188/CaJsm.2(5).2020.R111






