 |
Nouvelle série, n°6 1er semestre 2021 |
 |
|
DÉBATS |
|||
|
TÉLÉCHARGER LA REVUE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
CHRONIQUE
Délivrez-nous du mal
Privé d’instinct moral à la suite d’un accident de jeunesse, le chroniqueur se penche néanmoins sur des dérives journalistiques bien connues. Mais son incapacité à distinguer le bien et le mal au premier coup d’oeil l’amène à croire contre toute vraisemblance qu’au bout du compte leur dénonciation vertueuse les aide surtout à perdurer.

Karl Aspelin, 1885
Zut, encore une usine de papier journal qui ferme ses portes. Non, deux d’un coup cette fois-ci. Ce n’est toujours pas assez pour être certain que le journal imprimé va disparaître totalement, comme certains prophètes l’annonçaient jadis pour 2010 (il est vrai que le calendrier Maya ne mentionnait pas de rotative après cette date). Tout de même… Il est temps de s’alarmer de la possible disparition d’un refrain indispensable à toute discussion de comptoir digne de ce nom : « les journalistes font ça pour vendre du papier ». On ne mesure pas assez le vide que la presse imprimée laisserait dans notre patrimoine culturel. Quels avis les coiffeurs vont-ils pouvoir donner au reporter assez imprudent pour leur confier à la fois ses cheveux et sa profession ? Ils pourront toujours sauver l’âme des boulangers en leur assénant « vous faites ça pour vendre des croissants » mais, allez savoir pourquoi, même en agitant un index sévère, ça ne sera pas pareil.
Chacun sait bien que le commerce du papier est la vocation profonde des gazetiers. Il suffirait sûrement de sonder les aspirations d’une classe d’étudiants en journalisme pour que tous s’écrient d’une seule voix : « nous voulons vendre du papier ! », la poitrine gonflée d’orgueil anticipé, l’œil luisant de fierté papetière. Bien sûr, il y a toujours des moutons noirs. Certains pourraient dissimuler des motivations moins nobles, comme protéger la veuve et l’orphelin, voyager gratis, porter la plume dans la plaie, rencontrer des célébrités ou encore faire triompher quelque idéologie romantique. Mais au fond, le désir d’audience est bel et bien indissociable du journalisme. Si le péché originel avait une carte de presse, il ressemblerait à ça. Heureux les écrivains, dont il est notoire qu’aucun, jamais, n’a ressenti le désir de vendre un seul livre : ils seront sauvés. Heureux les artistes qui tant s’acharnent à rester inconnus, les chercheurs qui dissimulent si bien leurs travaux, les épiciers qui cachent eux aussi leurs salades : vivant dans l’innocence, ils peuvent à bon droit dénoncer la dépravation des journalistes et ne s’en privent généralement pas.
De façon générale, la tradition a peu d’égards pour les fouille-merde. Adam voulait paraît-il goûter au fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Prométhée a tenté plus ou moins le même coup avec un autre secret. Bien fait pour eux ! Pourtant, un doute me ronge depuis l’enfance. En quoi était-ce si coupable ? Et comme l’abîme appelle l’abîme, un doute de plus m’est venu par la suite. En quoi espérer avoir de l’audience est-il foncièrement « mal » ? Puisque le fruit interdit permet de distinguer infailliblement le bien et le mal, j’en prendrais bien une bouchée : apparemment, que l’on soit coiffeur, intellectuel ou… journaliste, on ne saurait parler de ce métier sans certitudes bien établies.
Pour qui manquerait de convictions préalables, la soif d’attention associée au journalisme ne demande qu’un peu de réflexion. La nier serait absurde : que l’on parle de diffusion écrite, de part d’audience, de clics ou de pages vues, ce métier n’existe que par l’écoute qu’il obtient. Économiquement, bien sûr, mais aussi civiquement, il serait parfaitement vain s’il ne cherchait à intéresser. Jusqu’à quel point ? La question se pose même pour des manifestations extrêmes de cette soif d’attention publique. À l’occasion de l’une de ces nécrologies qui ont jalonné au fil des décennies l’interminable agonie du quotidien France Soir, Patrick Eveno remarquait que l’incapacité notoire des journalistes français à toucher le très grand public n’était pas une si bonne affaire pour la collectivité : « Les conséquences de cet abandon sont redoutables pour la démocratie 1». À moins de vouloir revenir au suffrage censitaire ou à quelque oligarchie encore plus restrictive, il pourrait en effet être souhaitable que la plus grande partie possible du peuple se tienne vaguement informée des questions du jour, même trivialement. Dans le monde anglo-saxon, où la presse tabloïd n’est pas une notion exotique mais une réalité… quotidienne, une flopée de chercheurs a souligné, sans pour autant l’apprécier, que celle-ci était plausiblement plus profitable à la santé de la sphère publique qu’elle ne lui était dommageable. En somme, il n’est pas interdit de se boucher le nez tant que ça n’empêche pas de réfléchir. Mais dès qu’il s’agit de journalisme, les beaux esprits se dispensent volontiers d’en faire preuve.
Ne statuons pas ici sur la légitimité morale des dérives les plus cyniquement mercantiles de l’information lesquelles, sous la houlette de financiers décidés, menacent autant si ce n’est plus dans l’audiovisuel que dans la presse écrite. Je n’éprouve pas plus d’envie de les défendre, même en me bouchant le nez, que de me joindre au chœur chevrotant des déplorations péremptoires. Convenons simplement que c’est une question plus épineuse qu’il n’y parait2, et pour gagner du temps simplifions-la avec Ésope ou, tiens, avec Paracelse : « rien n’est exempt de poison. La dose seule fait que quelque chose n’est pas poison.3 »
Illusion de profondeur
Peut-on pour autant demander à un coiffeur, même soucieux de son pourboire, de lancer à brûle-pourpoint « les journalistes cherchent à vendre du papier, ce qui est normal et même souhaitable, mais peut trop souvent conduire à des excès qu’il conviendrait de soupeser mûrement » ? Ce serait couper les cheveux en quatre. Mais peut-être pourrait-on au moins suggérer à ceux qui font profession de raisonner (au risque de vendre bien malgré eux quelques exemplaires de leurs écrits) de se méfier de l’illusion de profondeur explicative4 consistant à croire que l’on comprend suffisamment quelque chose pour n’avoir pas besoin d’y réfléchir ? Sans oublier son frère, le biais de surconfiance5 qui conduit si facilement à surestimer ses capacités hors de son champ de compétence (oui, je sais, moi aussi…)
Il est vrai que, dans le cas qui nous intéresse ici, la compétence requise est modeste : aucun des points soulevés plus haut ne dépassait ce à quoi tout un chacun pourrait songer en prenant sa douche. Ce qui est en jeu est plutôt une question de foi ou, disons, d’addiction morale. Le besoin impérieux que nous éprouvons tous d’attribuer aux phénomènes une valence axiologique (c’est bien/c’est mal) et de s’y accrocher ensuite. Un art dans lequel bien des journalistes, mais pas tous, se distinguent d’ailleurs par leur remarquable capacité à identifier au premier coup d’œil le méchant et le gentil dans n’importe quelle actualité, même à un stade lacunaire. Là encore, la psychologie sociale aurait bien des choses à nous dire : depuis Festinger dans les années 1950, une masse d’expériences a montré…
— Soit, soit ! mais il y a tout de même des choses qui sont objectivement mauvaises : le sensationnalisme, par exemple, ça existe, non ?
Eh bien justement, ça n’existe pas. En tout cas pas que je sache. Peut-être faut-il développer un tout petit peu, quoique je l’aie déjà fait de façon plus académique6. Pour résumer, pas mal de tentatives ont été faites pour aborder rationnellement cette chose informe en partant soit de caractéristiques linguistiques (emphase, superlatifs, etc.), soit d’indices thématiques (sexe, sang, etc.) Toutes ont échoué empiriquement : quels que soient les critères qu’il vous plairait de choisir, ils engloberont autant de cas non pertinents qu’ils excluront de cas pertinents. Belle incrimination que celle qui ne permet de distinguer le coupable de l’innocent. D’où il résulte que le sensationnalisme, faute d’être objectivement caractérisable, ne peut être qu’un jugement de valeur7. Nous y revoilà…
Mais le plus amusant est que ce jugement que l’on ne sait même pas orthographier (les dictionnaires ne sont pas certains du nombre de n) n’est pas non plus fondé… en valeur : d’un point de vue conséquentialiste, on peut démontrer que des discours a priori condamnables s’avèrent beaucoup plus méritoires que des discours légitimes sur la forme et le fond. C’est, par exemple, le vieux problème de la vulgarisation scientifique.
Un très vieux problème, même. Un de mes auteurs favoris l’expliquait déjà 2000 ans plus tôt aux beaux esprits de son temps :
Nous, c’est le goût des autres qui doit régler notre langage, et le plus souvent il nous faut parler devant des hommes sans culture aucune, et, dans tous les cas, ignorants de l’art dont je viens de parler ; si nous ne savons pas les attirer par le plaisir, les entraîner par la force, et parfois les troubler par l’émotion, nous ne pourrons faire triompher même la justice et la vérité8.
Pendant que j’y suis, j’appellerais bien à témoigner Renaudot, autre locataire de mon Panthéon personnel, mais il y est en pleine discussion avec Condorcet. Oui, oui, le grave, le sérieux Condorcet. Lequel n’en estimait pas moins qu’il était bon de recourir à « ce qui semblerait ne pouvoir être jamais que de pure curiosité » pour éclairer le peuple, puisque « les erreurs que l’on commettrait en ce genre n’auraient que de faibles inconvénients.9 »
Attention, pourrait remarquer un coiffeur-philosophe (et alors ? Il y avait bien le barbier de Séville, non ?), nous sommes en train de foncer à toute vapeur dans un mur aporétique, l’équivalent dialectique des cheveux emmêlés. Car, n’est-ce pas, votre raisonnement permettrait de justifier à peu près n’importe quoi au nom de l’intérêt du public : vous prétendez célébrer la démocratie et vous disculpez en fait les potins les plus superficiels, les pièges à clics les plus sordides, voire les affabulations les plus éhontées.
Merci à toi, ô juste censeur des chevelures rétives. Ton esprit ne se limite pas à la perspicacité avec laquelle tu dégages les oreilles d’autrui car, en effet, tu as deviné la falaise vers laquelle je nous dirigeais à dessein. Reconnaître là une aporie, et de fort belle taille, c’est confirmer le seul point que je comptais en fait établir : les questions de journalisme sont décidément compliquées. Trop compliquées pour être réglées d’emblée par des préjugés paresseux.
Le karaoké de la déploration
Convenons qu’en la matière, les idées toutes faites ont au moins le rare avantage de réunir des cœurs que les hiérarchies socioculturelles séparent mieux que les Capulets et les Montaigus. Dans ce grand karaoké, la chanson est la même que l’on ait à la main une flûte de champagne ou une canette de bière, d’autant que ceux qui songeraient à entonner un refrain moins fruste ont la prudence de se taire. On sait par exemple que les miliciens de base de l’Amérique profonde se distinguent plus par la qualité de leur armement que par celle de leur raisonnement, mais le second point ne les singularise pas tant que ça. Imaginons que dans un lieu quelconque – un dîner mondain, un atelier d’usine, la salle des profs d’un lycée, un cercle littéraire, une manifestation anti-système, un club de golf… – quelqu’un commence une phrase par « Les journalistes… ». La probabilité que la suite donne quelque chose comme « …exercent certainement un métier difficile » ne semble pas tellement plus élevée dans un salon raffiné que dans un vestiaire de foot. Pure spéculation, certes… J’avais proposé à une étudiante de sonder sur ce point des esprits savants et impartiaux : ceux des auteurs de dictionnaires10. Une petite mais vaillante communauté où l’on sait peser les mots. De fait, pour les 20 ouvrages dépouillés, les définitions des divers termes se rapportant aux journalistes ne montraient, par rapport à ceux concernant les enseignants pris pour comparaison, qu’une imperceptible réticence (5,5 % d’énoncés négatifs contre 0 % pour les pédagogues). Mais les vannes de la réprobation s’ouvraient avec les citations livresques sélectionnées comme exemples, dont plus de la moitié (51,3 %) étaient franchement négatives et 5,0 % positives (contre respectivement 9,9 % et 5,6 % pour les enseignants). Trahissaient-elles une secrète répugnance des lexicographes ou simplement celle du corpus d’auteurs dans lequel ils auraient pioché au hasard ? Peu importe, puisque les deux hypothèses entraînaient la même conclusion : celle-là même que les sondages ne cessent de ressasser.
Entendons-nous bien : Les journalistes donnent certainement prise à la critique, comme le signalait Ésope, et celle-ci est même salutaire tant qu’elle se fonde en raison sur les conditions de possibilité et d’utilité de ce métier, bref sur un peu d’attention à ce qu’il peut être ou non. De surcroît, les esprits moralement les plus exigeants ne sont pas toujours les plus sots. Ainsi cet autre membre de mon cénacle imaginaire, qui lançait dans les pages de Combat des appels aussi beaux que profonds à l’élévation du journalisme. Je t’aime trop, Camus, pour te demander si la presse austère dont tu rêvais favoriserait vraiment la société que tu espérais. Surtout à l’époque des réseaux numériques…
Quant aux plus irréfléchis des lieux communs vertueux, leur profusion caquetante ne me dérange pas tant que ça en réalité. À part la secrète jalousie que j’éprouve envers ceux qui se jouent si aisément de questions qui me paraissent à moi diaboliquement tortueuses. Et le petit malaise que j’éprouve à me sentir dans la foule des moralistes comme un agnostique dans une communauté évangélique texane. Instruit par Alphonse Allais (« j’ai perdu tout sens moral à la suite d’une chute de cheval11 »), je soupçonne que je dois simplement mon handicap à un penchant de jeunesse pour les équidés qui n’était pas toujours payé de retour. Le diagnostic s’est d’ailleurs confirmé l’an dernier, au hasard d’une tentative impromptue de retrouver ces joies oubliées, quoique le lieu s’y prêtât plutôt mal (au continent des Harley-Davidson on ne monte pas plus un cheval qu’on ne pilote une moto, on s’assoit dessus). La saison s’y prêtant encore moins, une plaque de glace m’a surtout remémoré le lien entre la locomotion équestre et l’attraction terrestre. Or, contrairement à ma dignité et mon postérieur, mon instinct éthique n’a pas du tout souffert du choc, ce qui confirme bien qu’il n’y avait plus grand-chose à perdre sur ce plan.
Malgré tout, je conserve une foi naïve en la valeur intrinsèque de certaines choses. En autres, l’utilité du journalisme dans la société. Et c’est surtout pour ça que les anathèmes péremptoires me dérangent tout de même un peu. Pas parce qu’ils sont infondés. Parce que leur ascendant irrésistible les rend nuisibles. Toxiques, dirait Paracelse. Adjectifs peut-être un peu forts : « contre-productifs » serait plus juste, mais le côté managérial du terme convient mal à l’élévation d’esprit que l’on est en droit d’attendre d’une chronique. Nuisibles, donc, car en décourageant de penser ce qu’ils dénoncent, ils lui permettent de perdurer et de prospérer en catimini.
Maîtriser le noble art du racolage
Prenons justement le sensationnalisme, dont je n’ai guère vu de professionnel peser publiquement le pour et le contre, quoique beaucoup le pratiquent avec ardeur. Ni entendu quiconque remarquer que l’antonyme de sensationnel est au choix banal, insipide ou casse-pieds… Imaginons maintenant un cours de journalisme qui, toute honte bue, se consacrerait sérieusement au noble art du racolage. Un cours qui, partant de l’axiome selon lequel intéresser le plus grand nombre est un devoir professionnel et civique, aiderait notamment à soupeser plus nettement la dose – variable selon les cas et les publics – à laquelle cet impératif devient bel et bien poison. Irait-on jusqu’à y inviter tel producteur d’émissions de débats pour réitérer publiquement que « la bonne télé c’est du spectacle » ? Pourquoi pas : si j’en crois l’article qui le rapporte12, il pourrait constituer un bel exemple toxicologique du péril des doses trop fortes. Mais dans ce rôle ingrat, il serait peut-être plus utile que cette exécration machinale qui couvre d’un brouillard indistinct ce qu’elle croit combattre. Ainsi les spécialistes de la sécurité aérienne se sont-ils avisés que des avions s’écrasaient au décollage parce que les pilotes, las d’être assaillis pour un oui ou pour un non par des alertes criardes, avaient discrètement pris l’habitude de déconnecter le fusible qui les aurait sauvés.
Un journalisme sourd à toute alarme, privé de fusible ou plongé dans une confusion hébétée par trop d’avertissements futiles et d’injonctions contradictoires : tel est le vrai risque pour les passagers de l’espace public. Et le dossier du sensationnalisme n’en est qu’un exemple.
Voyons par exemple celui de la « circulation circulaire de l’information ». Ainsi Bourdieu – qui, biais de surconfiance ou pas13, n’était pas la moitié d’un imbécile – avait-il désigné la manie bien connue qu’ont les journalistes de se lire entre eux. La perversité de la chose saute en effet aux yeux, tant elle est lourde de conformisme paresseux et d’errances démultipliées. Sûrement, il vaudrait mieux que tout professionnel aborde chaque actualité d’un œil vierge. C’est sans doute pour ça que, sur cette pratique pourtant universelle, les manuels de journalisme sont plus muets qu’un malfaiteur endurci. Regrettable silence, car tout autre discours qui vise à livrer un avis informé et fondé en raison – un diagnostic médical, un jugement légal, une recherche scientifique… – se doit au contraire d’examiner méthodiquement les écrits précédents sur le sujet14. Parce qu’un regard naïf n’est justement que ça : naïf. Je ne sais pas trop s’il serait préférable d’avoir des médecins, des juges ou des chercheurs naïfs, mais personne n’a en tout cas besoin de journalistes naïfs : il y en a déjà bien assez. Nettement trop à mon avis. Ni de journalistes spontanés : les réseaux sociaux peuvent fournir toute la spontanéité que l’on voudra. Le chapitre manquant est précisément celui qui saurait écarter l’alternative rousseauiste entre une perception candide et une perception biaisée de l’actualité, assumant le caractère collectif quoique conjectural de la connaissance factuelle, et donc l’absolue nécessité de lire (entre autres !) ses confrères, mais avec les connaissances, l’entraînement et le recul critique d’un professionnel compétent et vigilant. Bref, d’un professionnel tout court.
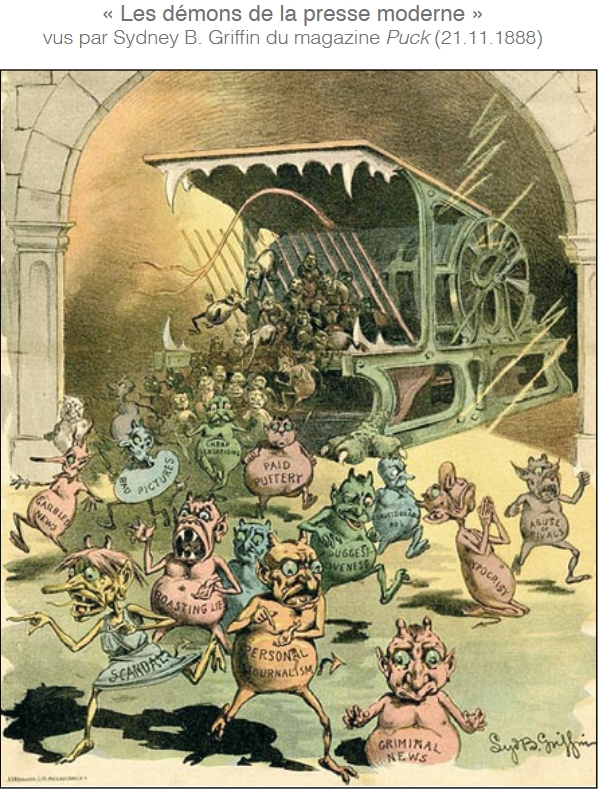
Dans le grand live du mal
Plus on y songe, plus l’abîme s’ouvre dans une vapeur de soufre. Ce n’est pas un chapitre que l’on pourrait écrire avec tout ce que la morale réprouve et que des journalistes peccamineux pratiquent la tête basse, avec les moyens du bord comme jadis les avortements clandestins. C’est un manuel entier. Le grand livre du mal. Voyons la partie sur la course au scoop. Course qu’explique si bien l’obsession atavique de vendre du papier. Te souviens-tu Théophraste, mon vieil ami, de ce savant estimé qui tempêtait contre tes révélations sur la condamnation de Galilée, toi « chétif imprimeur » avide de « vendre trop chèrement des coquilles en les profanant et divulguant comme il le fait avec ses adresses à des gens de peu […] pour en faire tant de bruit et de scandale15 » ?
— Il aurait bien voulu savoir d’où je tenais ce que j’ai publié, s’amuse Renaudot dans ma tête, mais il était sûrement sincère quand il trouvait la Gazette trop chère puisque, si méprisable qu’elle soit, il n’arrêtait pas de me harceler pour la recevoir gratuitement : j’étais peut-être en avance sur bien des choses, mais pas sur la presse gratuite…
Ne dérivons pas de la question. C’est mal, ça, la course au scoop. Très mal. Aucun doute là-dessus. Tout universitaire sait bien que dans son métier, il importe de ne jamais chercher à savoir quelque chose avant les autres et que les connaissances progresseraient mieux si on les laissait simplement tomber des arbres. On raconte que c’est arrivé une fois, en Angleterre. Heureusement, l’actualité est plus généreuse que la nature : au lieu d’une pomme de temps en temps, les organisations publiques et privées dispensent chaque jour avec largesse tout ce qu’il faut pour remplir les tuyaux. Communiqués creux, événements bidons, langue de bois à gogo : il faut décidément être pervers pour vouloir se fournir ailleurs. D’autant que ceux qui dénoncent le plus vertement la course au scoop sont généralement ceux qui fournissent eux-mêmes ce que le public a besoin de savoir : qui pourrait être mieux placé qu’eux pour en juger ?
Malgré tous mes efforts pour adhérer aux canons de la vertu, je ne parviens décidément pas à voir un modèle de bon journalisme dans la reproduction machinale de discours autorisés et de réponses dilatoires. Pire ! Je n’arrive pas à me purger de l’idée malsaine qu’au contraire, la passivité foncière de bien des journalistes est quelque chose de « mal » selon les deux points de vue – commercial et civique – qui conditionnent ce métier. Ni à me convaincre que la proportion du journalisme dit « d’initiative » dans un journal, en particulier les enquêtes opiniâtres et les questionnements nouveaux, est l’indice de sa turpitude plutôt que de sa valeur. Toujours sur ces deux plans.
Mais préférer les chiens de chasse aux chiens couchés (métaphoriquement parlant16) n’empêche pas de comprendre que la course au scoop est une drogue dangereuse. Je pourrais même témoigner de quelques procédés d’extorsion dont j’ai usé jadis et dont je ne suis pas très fier, mais je ne suis pas encore prêt à m’en confesser. D’autant qu’il serait facile de trouver pire, par exemple dans le cas tristement célèbre de la couverture de l’« affaire Gregory ». Bien sûr qu’à une certaine dose le besoin d’être le premier est vénéneux. Il l’est partout. Immanquablement. On réalise aujourd’hui avec effarement à quel point la course aux découvertes scientifiques et médicales est infectée par des publications frauduleuses (filouteries diverses ou affabulations pures et simples) qui égarent ensuite ou retardent toutes les recherches qui s’y fient. Mais alors… comment se fait-il que la même soif d’antériorité que l’on condamne chez les journalistes continue à être célébrée dans le monde universitaire – et d’ailleurs chez les explorateurs, écrivains, sportifs, inventeurs… – comme l’aspiration la plus noble qui soit ? Peut-être parce qu’on y subodore que c’est le moteur de la performance du corps ou de l’esprit : arrêtez-le et tout le monde s’assoit. On pourrait essayer, disons, chez les cyclistes. Plus de classement, puisqu’il entraîne des abus déplorables, dont le dopage et les sprints dangereux : dorénavant, on participera pour le plaisir. Le Tour de France risque d’être un peu long cette année. Long à démarrer, déjà, si l’on espère réunir plus que des amateurs de cyclotourisme. Ceci dit avec tout le respect que je dois aux cyclotouristes : j’en sais de fort estimables, dont un excellent spécialiste des médias et quelques journalistes notables. Mais en termes de spectacle, si l’on abolit le désir d’être premier, le… sensationnalisme de la chose risque d’en prendre un coup. Et du côté de la recherche scientifique, il vaudrait mieux ne pas trop avoir besoin d’un nouveau type de vaccin un de ces jours.
À moins, si je comprends bien, que la course à la primauté soit une valeur hautement recommandable partout sauf chez les journalistes, ce qui est noble ailleurs étant chez eux vil par nature. Je saisis à peu près l’idée mais j’ai vaguement l’impression qu’ils se font avoir quelque part…
Damné pour damné, autant continuer mon dictionnaire du diable. À la lettre C, on se demanderait par exemple s’il se pourrait que les journalistes ne soient pas assez corporatistes (si l’on considère que le vrai corporatisme requiert l’observation de normes communes et d’engagements explicites). Arrivé à I, on ne manquerait pas d’évoquer l’« irresponsabilité » bien connue de ces enfants assez inconséquents pour ne jamais écouter les grandes personnes, et peut-être leur « ignorance » alors qu’il est si facile à n’importe qui d’autre de maîtriser savamment un nouveau sujet tous les jours. À P, on évoquerait la répugnance des médias pour les nouvelles positives : il n’y a pas de guerre en cours entre la Suisse et le Liechtenstein, mais ça, comme par hasard, les journaux n’en disent jamais rien ! D’ailleurs, le genou d’Achille était excellent et on ne parle que de son talon. Ça me révolte.
À S comme scabreux, on applaudirait la pudeur de rosière avec laquelle les « représentants du public » de certains conseils de presse ou autorités de l’audiovisuel militent pour que soit cachée la moindre goutte de sang qui troublerait notre monde idéal. Jusqu’à V, où l’on s’émerveillerait de voir la célébration inconditionnelle du très légitime droit à la vie privée l’étendre aux comportements les plus ostentatoires sur la voie publique (ou sur la place du même nom). Sans compter les menottes des prévenus que l’on ne saurait montrer et les logos qu’il convient désormais d’occulter sur la moindre casquette ou la plus fugitive camionnette en arrière-plan.
Mais tout ça ne servirait guère qu’à prévenir ces touristes qui pourraient s’étonner en France de voir le téléviseur de leur chambre d’hôtel ne montrer que des images floutées : inutile d’appeler la réception, la réparation n’est pas du ressort d’un technicien. Ni de quiconque. On ne peut pas s’opposer à la vertu.
Fatigué de lever le doigt, tout au fond de ma boîte crânienne, un petit restant de morale oublié finit par empoigner un porte-voix : En voilà, une belle discussion de comptoir ! Un Tartuffe contre les Tartuffes, combattant les lieux communs avec d’autres raccourcis…
Décidément, la morale est toujours acrimonieuse mais rarement dépourvue de quelque fondement. Évidemment qu’il faudrait farcir tous ces points avec des précautions et des nuances qui commenceraient toutes par « …mais d’un autre côté ». J’ai dit que c’était compliqué, non ? Et il va de soi que la réprobation des excès dans le journalisme – ou d’ailleurs dans n’importe quelle autre pratique sociale et je doute vraiment que ça soit la pire – l’aide non seulement à s’améliorer dans l’absolu mais aussi à suivre (si possible avec un peu de recul…) l’évolution rapide des sensibilités de la société dans laquelle il s’inscrit.
Mais la répugnance réflexe ou militante qui entoure le métier d’informer, particulièrement virulente aux deux bouts de l’échelle sociale, n’en est pas moins aveugle. Comme une piñata morale, le bâton cogne tout le monde et manque généralement sa cible. Le bon journalisme en sort meurtri, le mauvais s’en moque. Au pays des écrans floutés, par exemple, le chef de service web d’un grand quotidien régional continuera à exiger de stagiaires arrivés pleins de vaillance qu’ils « démarquent » (terme de métier pour « plagier ») des sornettes invraisemblables du Daily Mail17. Dans un autre, on imposera qu’ils racontent en termes flatteurs un événement local auquel nul n’a pu se rendre.
Si, si, ça arrive vraiment. C’est ce qu’on appelle l’« apprentissage par la pratique » dans certaines rédactions, y compris nationales.
Le poisson pourrit par la tête
« Le poisson pourrit par la tête », disaient les sages romains en jetant celle-ci. Dans bien des médias, on jette le corps encore frétillant et on promeut la tête odorante. C’est ainsi que la légendaire « presse pourrie » peut effectivement s’avarier : la moisissure, quand il y en a, part usuellement de l’actionnariat ou de la hiérarchie, rarement des fantassins de l’actualité. Quand ceux-là pèchent, c’est souvent par naïveté factuelle ou candeur idéologique, mais surtout par flemme, par nécessité de produire à jet continu, bref : par découragement. Un découragement alimenté autant par les remontrances symboliques que par les pressions économiques, qui finit par dissuader de réfléchir à ce qu’on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait : on perd vite la foi quand tout vous en écarte. Naïveté, précipitation, découragement… des fautes vénielles qui dépendent largement de la culture interne des entreprises d’information : j’en connais d’admirablement épargnées. Mais pas épargnées par la stigmatisation générale.
La dénonciation condescendante qui accable le journalisme est comme le kantisme selon Péguy : elle a les mains pures, mais elle n’a pas de mains. La similitude s’arrête là, bien sûr : le kantisme part d’une réflexion minutieuse, l’autre part des tripes. L’homme de Königsberg s’épuisait à démontrer, l’homme de la rue (érudits compris) ne peut qu’asséner. Vite, un autre de mes fragments de sagesse romaine préférés : « ce qu’on affirme sans preuve doit se rejeter sans preuve ». C’était un adage juridique, ça ferait une belle maxime pour un cours de journalisme.
Ce qu’on affirme sans argument doit se rejeter sans argument : voilà pourquoi on peut bel et bien être contre la vertu. Pas la vertu informée des praticiens et des spécialistes des médias qui en développent une critique articulée : même quand le doute méthodique n’est pas sa caractéristique la plus visible, mieux vaut une critique discutable que pas de critique du tout. Contre la vertu indiscutable. Celle qui surplombe les faits et les hommes, juchée sur l’assurance de valoir plus que les uns et les autres. Mais puisque j’ai tant de difficulté à entendre (dans les deux sens du terme) les énoncés dont la prémisse est « c’est mal » au lieu d’en être la conclusion, peut-être parviendrais-je quand même à sauver mon âme si j’arrivais à imaginer un journal assez vertueux pour échapper à tant de réprobations.
Inutile de compter sur le chœur des cœurs purs : uni dans le lamento, il plonge dans la cacophonie dès qu’on passe à l’allegro con brio. Faudrait-il une tribune progressiste ou réactionnaire plus exaltée ? Il en existe déjà assez pour que les camés de l’opinion se procurent facilement leur dose : pas de gros potentiel d’innovation dans ce domaine. Non, ce qu’il faudrait c’est un média qui donne enfin la parole aux vraies gens. Flûte, ça existe aussi ! Facebook, Twitter et les autres m’ont pris de vitesse. Ou alors un organe impartial, dont toute frivolité serait strictement bannie. Dommage que le Journal officiel et la Gazette du Canada y aient pensé avant moi…
Je cherche, je cherche… Sursaut d’espoir en retrouvant le manuel de journalisme de Kim Jong-il : il me revient que « le grand leader et bienveillant professeur […était] toujours parmi les journalistes, leur enseignant en détail tous les problèmes concernant leur activité et les conduisant gentiment à écrire ou compiler d’excellents articles18 ». Compiler ? Vraiment ? Bah, au moins le démon du mercantilisme ne menace pas ici. Hélas, mille fois hélas ! Dès la page 17, j’apprends que l’actualité ne doit surtout pas être « affaiblie » et qu’un « langage puissant est requis » puisque les « magnifiques circonstances […] exigent plus qu’un langage élégant ». Sensationnalisme, quand tu nous tiens… J’aurais pourtant dû me souvenir que Trotsky s’élevait aussi contre le terne contenu de la presse soviétique19 et l’exhortait même à ne pas se « détourner de la curiosité et des instincts de l’homme en général ». Un peu plus de sexe et de sang, peut-être ? C’est cela même : « Nous sommes un État révolutionnaire et non un ordre spirituel ni un monastère. Nos journaux doivent satisfaire non seulement la curiosité la plus noble, mais aussi la curiosité naturelle ». Tant pis. De toute façon, les choses étant ce qu’elles sont, il me faut un journalisme qui puisse fonctionner dans une économie de marché. Mais sans pour autant tirer sur sa laisse côté course au scoop et irresponsabilités diverses.

Faites... Ne faites pas... (montage CdJ)
Une terre préservée des excès
J’y suis ! Il existe au moins un modèle de responsabilité journalistique aussi capitaliste que possible. On le doit à la houlette éclairée d’une dynastie pétrolière, c’est tout dire. Bien mieux que la famille Ewing, la famille Irving. L’une habitait au Texas, vers Dallas je crois. L’autre ne se contente pas d’habiter au Nouveau-Brunswick : elle le possède plus ou moins. Le raffinage, bien sûr mais aussi les forêts, une bonne partie des commerces, la construction navale, le pouvoir politique – ça va de soi –, les pommes de terre, un bon nombre d’autres choses et, ah oui… les journaux20. Détenant les principaux quotidiens et hebdomadaires plus l’essentiel de la presse gratuite et imprimant à peu près tout le reste (où j’imagine qu’elle est également un annonceur publicitaire important), elle a poussé l’art de la concentration à un niveau de pureté jamais rêvé ailleurs en occident. Peut-on imaginer de conditions plus propices à un journalisme préservé de la course au scoop et d’autres propensions irresponsables ? Où donc pourrait-on mieux s’abstenir d’importuner les gens sérieux, de perturber l’économie, de troubler le public avec de vaines polémiques ou de l’inquiéter pour un rien ?
De fait, lorsqu’une partie de la raffinerie Irving de Saint-Jean, la plus grande du Canada, s’est transformée en chaleur et en lumière à la suite d’un défaut d’entretien, la presse locale a sagement résisté à l’excitation des nouvelles angoissantes. Il faut savoir être positif. Pour ne pas tourmenter les familles alors réunies autour de la dinde également fumante de l’action de grâce, le Telegraph-Journal a donc titré très responsablement « Le miracle de Thanksgiving ». L’explosion miraculeuse et l’incendie inespéré qui l’avait suivi n’avaient fait que 5 blessés dans le personnel. 80 prétendent les intéressés. Dans les rues pavillonnaires qui entourent l’usine, les achats de cierges ont dû monter en flèche devant une telle efficacité de la grâce divine.
Soyons donc positifs également en saluant l’élévation morale d’une famille qui, bien que productrice de papier (j’avais oublié ça), ne fait apparemment21 rien de trop pour le vendre une fois noirci. En fin de compte, la vertu existe : je l’ai enfin trouvée. Mais on me pardonnera de préférer mes journaux habituels. Le bon journalisme existe aussi : j’en lis tous les jours. Pas toujours sans grogner un peu – croyez-moi ou pas, je me défends assez comme critique de presse22 – mais avec sérénité : Paracelse, qui lit par dessus mon épaule, m’affirme que je ne risque rien. 
Bertrand Labasse est professeur à l’Université d’Ottawa
et professeur invité à l’École supérieure de Lille.
1
« France Soir, déclin d’un journal populaire », Le Monde, 11.04.2006, p. 25.
2Même le cas assez extrême de la presse tabloïd reste débattu : si divers travaux soutiennent qu’elle a au bout du compte un rôle plutôt positif sur les connaissances civiques, certains autres trouvent un effet nul, voire légèrement négatif. Quant à son hystérisation du débat public, savoir s’il vaut mieux permettre à des opinions primaires de se purger plutôt que de gonfler sous un bouchon posé par la respectabilité n’est pas simple non plus.
3Septem Defensiones, 1538, dans Paracelse. Œuvres médicales, PUF, 1968, p. 13.
4Leonid Rozenblit et Frank Keil, « The misunderstood limits of folk science : An illusion of explanatory depth », Cognitive Science, n° 26, 2002, p. 521–562.
5Souvent appelé « effet Dunning-Kruger » à la suite d’un article des auteurs éponymes, largement médiatisé mais plausiblement entaché lui-même d’un biais (statistique en l’occurrence). D’autres travaux ont cependant montré cette tendance générale.
6« Sexe, sang et physique des particules : le ‘‘sensationnalisme’’ est-il partout… ou nulle part ? », Les Cahiers du journalisme (première série), n° 24, p. 114-149.
7Ça existe bel et bien, « un peu comme la pornographie », objecte un collègue fort avisé en lisant le brouillon de cette chronique. Tout à fait d’accord sur cette analogie très parlante (la notion floue de pornographie varie spectaculairement d’une époque à l’autre et d’un pays à l’autre), mais est-ce là une objection ou une confirmation ?
8Quintilien, Institution oratoire, L. V, ch. XIV, trad. Bornecque, 1933, p. 275-277.
9Œuvres de Condorcet, Didot, 1847, p. 391-392.
10Marie-Christine Corbeil, « Les représentations des journalistes dans les ouvrages ‘‘de référence’’ », PIRPC (dir. B. Labasse), Université d’Ottawa, 2013.
11Silvérie ou les fonds hollandais, 1898.
12Mathieu Deslandes, « “Le journalisme, c’est pas du spectacle” : rencontre avec un repenti des chaînes info », INA – La Revue des médias, 14.10.2020.
13Son livre sur le journalisme a été légitimement flagellé par des spécialistes des médias pour ses lacunes, erreurs ou raccourcis sur ce sujet, mais je ne suis pas convaincu que les approximations qui parsèment ce bref essai le privent pour autant d’intérêt dans ce… champ.
14Dans un souci écologique qu’on ne manquera pas de saluer, je recycle ici aussi quelques bribes d’une publication plus académique, donc impropre à la consommation courante et de ce fait promise à l’enfouissement (« Du journalisme comme une méso-épistémologie », Communication, 33(1), 2015).
15Lettres de Peiresc aux frères Dupuy 1634-1637, tome III, Imprimerie nationale, 1892, p. 15-16 et 28 (orthographe modernisée par moi).
16En pratique, il s’avère plus commode de caresser un chien couché que de courir après un limier galopant on ne sait où.
17Mais non, je ne me contredis pas sur la presse tabloïd, en tout cas pas plus qu’Ésope.
18République populaire démocratique de Corée, 1983, The great teacher of journalists : Kim Jong-il, édition anglaise par Fredonia Books, Amsterdam, 2002.
19Léon Trotsky, 1923, « Le journal et son lecteur », dans Les questions du mode de vie. Chicoutimi, Les Classiques des sciences sociales, 2010, p. 29.
20On exagère à peine. Pour un panorama plus précis, se reporter à Jacques Poitras, Irving vs. Irving (Penguin Random House, 2014) et, en ce qui concerne le journalisme, à Elisa Serret « Au Nouveau-Brunswick, on ne mord pas la main qui nous nourrit » (Radio-Canada, 27.11.2019).
21Je ne sais plus que penser… Pour le simple plaisir de me perturber, Jamie Irving, vice-président de Brunswick News Inc. et aussi (tiens ?) de l’association canadienne des médias d’information, signe ce matin même dans La Presse (29.03.2021) un article plutôt brillant contre Google et Twitter, qu’il accuse à juste titre d’avoir créé dans plusieurs états américains de « vastes “déserts d’information” ». Il y souligne, toujours à juste titre, que « des reportages locaux honnêtes sont essentiels à la santé d’une démocratie » et soutient les législateurs qui s’opposent aux « monopoles » : « Maintenant, ce sont Facebook et Google qui représentent la richesse et le pouvoir. Et ils ont cruellement besoin d’être perturbés à leur tour. » Non seulement j’aurais pu signer son texte sans en changer une virgule, mais j’hésite à ne voir sous cette plume qu’un cynique plaidoyer pro domo. Même si le Nouveau-Brunswick avait sévèrement été qualifié de « zone dévastée du journalisme » (journalist disaster zone) dans le paysage médiatique canadien, je crois sentir une certaine sincérité dans son propos et possiblement un réel goût pour le journalisme. Personne n’est tout noir ou tout blanc. Et puis… le second titre du Telegraph-Journal, le petit en bas, parlait quand même d’une « explosion terrifiante ». Décidément, rien n’est simple dans ce domaine…
22Acharné à me compliquer la vie, le hasard m’envoie, en même temps que le manifeste d’Irving, un ouvrage tout frais de François Jost (« Médias : Sortir de la haine ? », CNRS Éditions) qui semble justement porter sur le thème de cette chronique. Pour ne pas lui permettre d’interférer importunément avec celle-ci, je crois que je vais plutôt en faire une brève note de lecture plus loin.
Référence de publication (ISO 690) : LABASSE, Bertrand. Délivrez-nous du mal. Les Cahiers du journalisme - Débats, 2021, vol. 2, n°6, p. D41-D51.
DOI:10.31188/CaJsm.2(6).2021.D041






