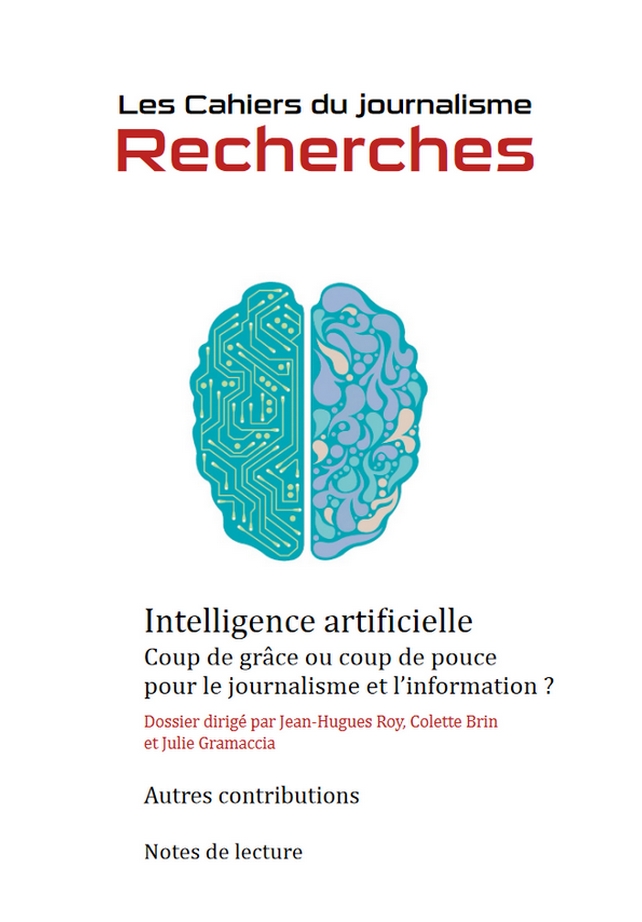 |
Nouvelle série, n°7
2nd semestre 2021 |
 |
||
|
RECHERCHES |
||||
|
TÉLÉCHARGER LA SECTION |
SOMMAIRE |
TÉLÉCHARGER CET ARTICLE |
||
Technique et crise : l’impact de l’intelligence artificielle sur les dimensions sociopolitiques du journalisme
Roland-Yves Carignan, Université du Québec à Montréal
André Mondoux, Université du Québec à Montréal
Résumé
L’intelligence artificielle et l’immense jeu de données personnelles sur lequel elle repose s’insèrent dans un nombre sans cesse croissant d’activités humaines en occultant toujours davantage la régulation politique et institutionnelle des rapports sociaux. Le journalisme se trouve ainsi éloigné de son rôle social institutionnalisé (représenter la société à elle-même pour ouvrir un espace de débat politique) puisque cette technologie, qui n’est aucunement redevable au peuple, intègre à la fois la représentation du réel (devenue numérique) et la prise de décision (devenue algorithmique) à l’opération d'un « système ». S’il veut remplir son rôle de chien de garde de la démocratie, le journalisme ne doit pas tant s’adapter à cette nouvelle forme de régulation des rapports sociaux que contribuer au développement d’une pensée critique à son égard, dans tous les domaines, afin de maintenir le peuple aux commandes de sa propre trajectoire, en lien avec les idéaux démocratiques.
Abstract
Artificial intelligence and the huge set of personal data on which it is based are inserted into an ever-increasing number of human activities while increasingly obscuring the political and institutional regulation of social relations. Journalism is thus far removed from its institutionalized social role (representing society to itself to open up a space for political debate) since this technology, which is in no way indebted to the people, simultaneously integrates the representation of reality (which has become digital) and decision-making (now algorithmic) to the operation of a "system". If it wants to fulfill its democratic watchdog role, journalism should not so much adapt to this new form of regulation of social relations as contribute to the development of critical thought towards it, in all areas, in order to keep the people in control of their own trajectory, in line with democratic ideals.
DOI: 10.31188/CaJsm.2(7).2021.R091
A
vec le déploiement des technologies numériques et celles qualifiées « d’intelligence artificielle », le journalisme serait confronté à une crise (Latar, 2018), réelle ou appréhendée (Ruellan et LeCam, 2014). Mais est-ce bien nouveau ? N’était-il pas déjà « éclaté » (Charron, 1992), en « crise de sens » (Casanova, 1996), en « crise politique » (Neveu, 1997), destiné à « une certaine mort annoncée » (Nobre-Correia, 2006) ou encore victime de crises financières (Benson, 2018) et démocratiques (Pickard, 2020) ? La crise contemporaine du journalisme est de fait multiple : crise financière (déclins des revenus publicitaires), crise technique (bousculade de nouveaux outils numériques de production, mise en circulation et consommation des messages), mais aussi crise de sens et de vérité (baisse de l’autorité médiatique en général et du journalisme en particulier, multiplication des sources, fausses nouvelles, régime de post-vérité, etc.) et, enfin, crise institutionnelle (déclin du journalisme en tant qu’institution sociale).
Face à tous ces défis, les notions de paradigme et de mutations, fréquemment convoquées, se font en quelque sorte rassurantes puisqu’elles (pré)supposent essentiellement que le journalisme en s’adaptant ou s’intégrant à tout nouveau contexte pourrait éviter l’épreuve de sa propre disparition ; les crises successives n’étant que des passages obligés d’un parcours général assuré (paradigme) ou l’évolution d’une même entité (mutations). Nous postulons que le maintien de l’institution journalistique, c’est-à-dire son individuation (pris ici au sens simondien d’« existence-dans-le-monde »), est avant tout une question sociale (collective) qui va au-delà des pratiques professionnelles saines, bonnes ou mauvaises ; que cette crise du journalisme est aussi, et d’abord, une crise de la société elle-même à laquelle participent les technologies numériques de mise en réseau du social ; et que cette remise en question du journalisme fait plutôt écho à l’« oubli de la société » (Freitag, 2002) auquel elle n’est certes pas étrangère.
La visée de cet article n’est pas de refuser en bloc l’intelligence artificielle (IA), mais bien de souligner la nécessité d’une pensée critique pour participer à son déploiement dans la perspective d’un idéal démocratique au sein duquel le journalisme est appelé à jouer son rôle : c’est cet idéal et ce rôle qui sont ici en jeu. Pour ce faire, nous mobiliserons dans un premier temps un cadre théorique gravitant autour d’une idée à la fois simple et complexe : une société cherche constamment à résoudre par elle-même (politiquement) les conflits et crises qu’elle traverse et c’est ainsi qu’elle existe et se transforme historiquement. Nous ferons ici appel aux notions de crise, de praxis (cette pratique politique de l’ensemble social), de rapport aux valeurs et de modes de reproduction sociétale, tout en regardant le rôle qu'y jouent le journalisme et la technique. Nous pourrons alors, dans un deuxième temps, analyser les défis posés par l’émergence d’une nouvelle forme de régulation des pratiques sociales reposant sur l'automatisation et la massification, qui correspond à une externalisation de la praxis vers l’entité technique nommée «IA», et ce au regard de la crise contemporaine du journalisme.
Précisions épistémologiques
Lorsque nous conceptualisons l’intelligence artificielle, nous ne faisons pas référence à une ou des technologies spécifiques, mais bien, sur un plan plus philosophique, à la technique, c’est-à-dire à un ensemble d'outils technologiques, de moyens ou d'instruments via lequel l'humain entre en rapport avec son monde et les autres. Ainsi, nous entendons aborder l’IA en tant que dispositif social plutôt que purement technique, c’est-à-dire en tant qu’ensemble de technologies déployées de plus en plus largement affectant les rapports sociaux dont il est à la fois porteur et porté. Le lecteur qui souhaiterait une critique d’un logiciel déployé dans une salle de presse sera déçu: notre analyse vise à montrer comment l’ensemble « intelligence artificielle », sans égards à son domaine d’application, affecte les médiations symboliques propres aux dynamiques de reproduction1 sociale — affectant le journalisme dans la foulée.
Cet ensemble d’outils partage plusieurs caractéristiques, dont celles que nous retiendrons, soit l’automatisation et la massification. L’automatisation renvoie au traitement algorithmique (quasi) autonome des données, souvent « personnelles »2, dans une perspective qui conduit en même temps à la nécessité de récolter et de colliger toujours plus de ces données (données massives, Big data). S'insérant dans un nombre toujours grandissant de domaines liés à l’activité humaine — du commerce à la médecine en passant par la mobilité et la gestion des services municipaux — l’IA modifie la façon dont la société se structure elle-même, affectant dès lors la conception du rapport au monde propre aux socialités humaines.
Enfin, nous sommes conscients que notre texte se situe dans la tradition de la sociologie avec ses assises et approches épistémologiques. Nous croyons cependant qu’une rencontre avec le journalisme est essentielle. Dès lors que l’on conçoit le journalisme en tant que représentation de la société à elle-même ouvrant la possibilité d’un débat politique sur les rapports sociaux qui y ont cours, dans une perspective de régulation par et pour le peuple, on ne peut que constater que l’institution journalistique est bien l’une des médiations constitutives de l’ensemble social.
De la crise comme praxis
Notre analyse repose donc sur des bases sociologiques et plus précisément sur les notions de crise et de praxis qui sont interreliées. L’étymologie du mot crise provient du grec κρίνω, krínô qui signifie décider, prendre une décision. En ce sens, une crise ne renvoie pas tant à la nécessité de prendre ou non la bonne décision que d’être confronté à un choix où aucune décision ne s’impose en elle-même comme bonne ou mauvaise. La crise, c’est d’être confronté à un problème dont la résolution réside dans la prise de décision elle-même dans ce qu’elle a de plus irréductible, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut être fondée que dans un rapport aux valeurs :
Pour autant que la vie a en elle-même un sens et qu’elle se comprend d’elle-même, elle ne connaît que le combat éternel que les dieux se font entre eux ou, en évitant la métaphore, elle ne connaît que l’incompatibilité des points de vue ultimes possibles, l’impossibilité de régler leurs conflits et par conséquent la nécessité de se décider en faveur de l’un ou de l’autre. (Weber, 1959, p. 91)
Sous sa forme contemporaine, le terme praxis de tradition marxiste désigne quant à lui l’activité collective de transformation des conditions socioéconomiques où « [t]ous les mystères qui détournent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique » (Thèses sur Feuerbach par Karl Marx), ce qui inclut également le « lieu et origine des concepts » (Lefebvre, 1965, p. 13). La praxis désigne ainsi l’activité de transformation du sujet agissant, c’est-à-dire son action politique sur la société de laquelle il émane.
En termes plus aristotéliciens, contrairement à la zôê simplement animale, la zôê de l’homme évoque à travers des alternatives fondamentales comme celle du bios politikos et du bios theôrêtikos, différentes possibilités d’être qui supposent la possibilité d’une décision ou d’un choix. (Pageau-St-Hilaire, 2018, p. 113)
Ainsi, dès lors qu’une société cherche, sur la base de ses propres valeurs, à résoudre les conflits internes qui émergent des rapports sociaux en son sein, elle se trouve à produire ses propres conditions d’existence. La crise réfère donc à la praxis, et inversement, c’est-à-dire à une responsabilité collective de prise en charge du devenir sociétal comme mode d’existence humaine. En outre, si une société existe en faisant constamment et continuellement face à un choix existentiel ou fondamental, sur la base des valeurs déjà représentatives de la société elle-même, on constate que la crise, comme la praxis, renvoie alors à une activité de réflexivité comme mode d’être.
Il est à noter que la liberté — individuelle — de conscience ne couvre pas ainsi tout le registre ontologique de l’être humain. En effet, le rapport à l’autre (le politique) que comporte sa socialité est également essentiel et incontournable à son individuation ; cette liberté de conscience — de choisir — ne peut se réaliser et s’objectiver en dehors de celui-ci.
À plusieurs égards, la praxis consiste donc à continuellement choisir et est à ce titre une « crise » de tous les instants. Autrement dit, la société ne se présente plus comme un bloc monolithique sujet au changement (notion de révolution politique, technique ou autre), mais bien comme reproduction (changement) permanente dont le legs est une trajectoire sociohistorique.
La crise et la praxis sont donc sociohistoriquement individuées et c’est donc sous cet angle qu’il faut considérer, selon nous, la crise que traverse le journalisme de même que la contribution de l’intelligence artificielle. Nous constatons que ces dimensions ont tendance à être occultées.
En effet, premier constat, le journalisme se définit fréquemment, autant chez les praticiens que les chercheurs (Hartley, 2007), par le terme « pratique journalistique », ce qui cadre le débat sur l’IA autour des usages3, une dimension très présente dans les technologies en général et les technologies numériques en particulier. Sous cet angle, le questionnement revient alors à faire l’adéquation entre les technologies et l’intégrité du journalisme tel que circonscrit par sa pratique (éthique, déontologie, protocoles, etc.). C’est ainsi que le choc de l’IA consiste à s’adapter (les « bonnes pratiques ») aux caractéristiques des technologies déployées, sans nécessairement les interroger puisqu’elles sont entre les mains des « experts ». Le « monde du journalisme » constate ainsi qu’il :
évolue à une cadence inférieure à celle des technologies. Dans les mémos numériques précédents, nous avons souvent avancé qu’il était important que vos modèles d’affaires soient adaptés à cette réalité. Selon plusieurs experts, l’intelligence artificielle n’est pas assez implantée dans le milieu du journalisme et plusieurs médias sont en train de passer à côté de cette occasion, qui sera déterminante pour leur futur. (Association des médias écrits communautaires du Québec, 2021, p. 12)
C’est ainsi que tous les enjeux sociaux (santé populationnelle, consommation, information, éthique, éducation, etc.) deviennent peu à peu destinés à être « gérés » et réduits à des dimensions techniques. Ainsi, résoudre la crise des fausses nouvelles, par exemple, consisterait à mieux déployer des algorithmes plus « efficaces », comme si cette crise était essentiellement de nature pragmatique. Tout ce discours fait écho à ce que plusieurs qualifieraient de solutionnisme (Morozov, 2013), c’est-à-dire prôner des solutions techniques à des problèmes essentiellement définis de façon technique — plutôt que sociale — pour proposer ainsi une vision du monde (idéologie) où la technologie serait une panacée (Ellul, 2008 [1954]). Cette position est insuffisante en soi puisque a) elle ne rend pas compte de la dynamique de changement social ; b) elle manifeste le primat accordé à l’usager qui devient ainsi implicitement défini comme degré zéro du social4, une position qui rappelons-le est au fondement du néolibéralisme5 ; et c) elle pose une dichotomie entre la pratique et les dimensions sociopolitiques où les rapports d’altérité (la société) sont habituellement relégués à un second plan qui n’est pas mobilisé lors de l’analyse de l’usager et ses activités.
Deuxième constat : les technologies numériques sont trop souvent considérées comme essentiellement neutres, ce qui est loin d’être acquis (Guchet, 2010). En effet, telle que déployée par la pensée heideggérienne, la technique va au-delà de la « représentation anthropologique-instrumentale » (Heidegger) pour jouer un rôle ontologique en tant que participante au dé-voilement du monde qui caractérise le mode d’existence de l’être. En outre, ce rôle de la technique a été mis en évidence par les approches la définissant comme « extension du vivant hors du vivant » (Leroi-Gouran) ou « mémoire » (Stiegler), mettant ainsi en évidence qu’elle est porteuse de valeurs, donc pas neutre. De fait, pour Heidegger, de se confiner à la représentation anthropologique-instrumentale (usage individuel), et ainsi négliger son apport ontologique (pouvoir de révéler le sujet en son existence dans le monde), conduirait l’être à confondre son destin avec celui de la technique, ce que d’autres n’hésiteront pas à définir comme une forme de surdéterminisme6 technologique (Ellul, Simondon, Stiegler, Morozov).
Cadre d’analyse
Notre analyse de la crise du journalisme s’articulera donc autour des axes suivants : a) une approche liant simultanément sujet/usager (« je ») et société (« nous ») où chacun des termes reproduit l’autre selon b) une théorie du changement où chacun de ces termes est une phase d’une dynamique d’individuation dans laquelle c) la technique est mobilisée.
Nous adoptons en outre une posture épistémologique fondée radicalement sur le rapport aux valeurs : celui des sujets comme mobilisation à l’action orientée et celui propre à la société comme vecteur d’institutionnalisation de ces valeurs. Autrement dit, ce qui unit pratiques sociales et société est le rapport aux valeurs, à une symbolique partagée. L’action symboliquement orientée du sujet nécessite en effet pour sa production et compréhension un cadre normatif commun a priori (culture, langue, valeurs institutionnalisées, etc.) qui est le propre de la sociétalité et qui est lui-même reproduit par le sujet.
Sous cet angle, la praxis s’incarne donc dans l’action orientée par et dans les institutions (politiques, culturelles, etc.) médiatisant objectivement l’existence du lien social. Elle devient ainsi un moment ontologique de réflexivité de la société sur elle-même.
[C]ette reconnaissance de soi que le sujet atteint lorsqu’il saisit réflexivement les résultats de son action dans le monde et d’abord le monde lui-même tel qu’il se dévoile à la forme déterminée de son action [se conçoivent] comme une manifestation de [l’]identité normative propre, c’est-à-dire du témoignage de l’appartenance de sa liberté au monde, et de l’accessibilité du monde à sa liberté. […] [P]rend alors pour [le sujet] la forme d’une reconnaissance de sa propre liberté particulière dans les résultats de son action, de l’appréhension réflexive de sa propre posture prise dans le monde et de la marque laissée sur lui par l’exercice de son identité propre… (Freitag, dans Fillion, 2006, p. 158)
La société n’existe donc qu’à travers cette « re-présentation contraignante, transcendante d’elle-même » (Martin, 2007, p. 66), c’est-à-dire par ce rapport aux valeurs. Cette réflexivité normative (un miroir de « qui nous sommes ») est le mode de constitution et de reproduction de la société. C’est ce qui lui permet d’être, c’est-à-dire de se reproduire dans le temps.
Ajoutons que chez Stiegler, la technique joue un rôle important (voire ontologique) à cet égard : la teknè est une artefactualisation du vivant (Stiegler, 2006), une prothèse mnémonique permettant aux valeurs du passé d’être présentes sous une forme synthétique sociohistorique et de participer ainsi, comme co-institutant, à l’orientation normative de l’action, tout en étant le fruit de cette action7.
Ce cadre épistémologique, reliant l’individu, la société et la technique dans un rapport réflexif aux valeurs, s’applique bien à l’analyse du journalisme, précisément parce qu’il s’agit d’une pratique réflexive codifiée en fonction de son institutionnalisation et que c’est ce qui lui permet de jouer un rôle défini dans la praxis de l’ensemble social (son statut de quatrième pouvoir que nous décrirons plus loin). Évidemment, le but de l’analyse n’est pas de porter un jugement sur les valeurs comme telles, mais bien sur les modalités sociohistoriques de reproduction de ces valeurs et sur l’apport de la Technique (l’IA et la numérisation du réel). En d’autres mots, nous souhaitons explorer « de quelle manière la médiation mnémotechnique […] surdétermin[e] les conditions de l’individuation et reconfigur[e] les rapports du ‘je’ et du ‘nous’ » (Stiegler, n.d.).
La notion de mode formel de reproduction symbolique de Freitag s’avère ici un point de départ des plus utiles, car la crise qui retient notre attention repose justement sur l’émergence d’un nouveau mode de régulation des pratiques et rapports sociaux.
Modes formels de reproduction sociale
À la base, au sein de la sociologie dialectique de Freitag (1986a, 1986b), ce qui constitue une société en tant qu’entité observable sont les régulations et normes qui la traversent et qui sont redevables des rapports entre les sujets et celle-ci. Pour Freitag, ces régulations sont d’ordre symbolique et à ce titre porteuses de rapports réflexifs aux valeurs.
La cohérence d’ensemble d’une modalité formelle de régulation de l’action assure en même temps l’intégration des pratiques sociales en une structure d’ensemble à l’intérieur de laquelle elles sont en « réciprocité formelle », et la reproduction globale de cette structure à travers l’accomplissement « discret » des actions particulières. (Freitag, 1998, p. 92)
Chez Freitag, la société n’« est » pas (par exemple, au sens d’une entité constituée d’un ensemble de lois objectives et impersonnelles) mais « advient » via un mode formel de reproduction inscrit dans la contingence sociohistorique. Il s’agit d’« une conception expressive selon laquelle le "vivre ensemble" n’a pas d’autre fin que lui‐même » (Bischoff, 2008, p. 150). Le rapport au monde s’effectue donc inévitablement à travers des médiations symboliques, c’est-à-dire par le détour d’un rapport aux valeurs qui permet l’intégration de l’ensemble social. C’est par ces médiations que la société existe et se reproduit dans le temps, en déployant les régulations et normes inspirées par et inspirantes de pratiques sociales orientées (praxis et rapports aux valeurs).
Freitag élabora une typologie des modes formels de reproduction en trois idéaltypes8. Le premier mode, dit culturel-symbolique, est le propre des communautés et sociétés dites « primitives », sans réelle organisation structurelle distincte pour assurer le fonctionnement et la régulation, et où le rapport à l’autre (intersubjectivités) n’est pas marqué par une contradiction — au contraire, ces sociétés jouissent d’un consensus profond puisque la « culture » y est vue comme une seconde nature où tout a déjà été posé (ordre préexistant à respecter) :
Toute pratique conforme à la culture est en même temps confirmation et reproduction de celle-ci. Cela ne signifie pas que ces sociétés ne connaissent ni changement ni conflit. Simplement, le changement n’y est ni voulu ni thématisé comme tel, il est fondamentalement nié, car c’est la fidélité au passé qui fonde l’unité et l’identité collectives. (Bonny, 2002, p. 1)
Ce mode de régulation des rapports sociaux repose sur des médiations symboliques d’ordre purement transcendantal où le pouvoir reste encadré culturellement et fonde sa légitimation sur un ordre cosmologique/religieux. Il n’y a donc pas ici de réel « devenir » de la société (« évolution » ou « progrès »), celle-ci tendant à ne pas déroger à un âge d’or pour ainsi investir un éternel présent.
Le deuxième mode de reproduction, politico-institutionnel (qui se subdivise en « traditionnel » et « moderne »), est lui aussi fondé sur des médiations symboliques de nature transcendantales (valeurs « universelles »). Cependant, à partir de la tradition et la royauté (cycle « traditionnel »), ce mode en vient à reposer sur l’institutionnalisation du rapport à la transcendance via une légitimation s’appuyant sur des modalités définies (la Loi, la Constitution, l’État) axées sur le lien entre la volonté collective et les actions orientées des individus — c’est l’idéal de la démocratie (cycle « moderne »).
Dans ces conditions, la forme d’exercice par excellence du pouvoir n’est plus juridictionnelle mais législative, le pouvoir étant chargé de créer la loi conformément à la volonté des citoyens et abstraction faite de la tradition. Pour autant, la modernité ne va pas s’affranchir de toute référence transcendantale. C’est en effet la Raison qui va faire office de nouvelle idéologie de légitimation, permettant d’inscrire les institutions clefs de la nouvelle société dans une théorie de la justice. (Bonny, 2002, p. 42)
Par la Raison, les notions de progrès et d’évolution, auxquelles est souvent associée la technique, favorisent l’essor d’une rationalité instrumentale. Ceci permet aux sujets d’être autonomes, dans la mesure où les rapports à la transcendance (Raison) sont respectés, pavant ainsi la voie à une réflexivité sociopolitique sur laquelle s’appuiera la praxis :
Le deuxième cycle du mode de reproduction politico-institutionnel se rattache aux sociétés « modernes » à l’intérieur desquelles cette capacité d’institutionnalisation a elle-même été « institutionnalisée ». Les sociétés modernes sont donc caractérisées par le déploiement d’une pratique de troisième degré de « régulation formelle des médiations formelles », c’est-à-dire une pratique de régulation institutionnelle des institutions. (Pineault, 1999, p. 58)
Avant d’aller plus loin, il importe d’expliciter l’ancrage du journalisme dans ce deuxième mode formel de reproduction sociale, c’est-à-dire de montrer en quoi le journalisme est un rouage de la modernité tout en dépendant d’elle. Nous verrons également à situer l’apport des technologies de médiatisation des rapports sociaux dans l'émergence d’une dynamique de dépassement de cette modernité — ce qui ouvrira finalement sur un troisième mode de reproduction.
Mode de reproduction politico-institutionnel et journalisme
La pratique journalistique, telle qu’on la définit encore aujourd’hui, s’est instaurée puis codifiée historiquement en appui à l’émergence de ce mode de régulation politico-institutionnel des sociétés démocratiques, en développant une capacité à offrir au peuple la réflexivité requise pour qu’il puisse imaginer une socialité non plus imposée (par un dieu, un pape, un roi, etc.), mais à construire à partir de sa propre volonté (praxis).
Le journalisme est ainsi l’une des médiations institutionnalisées du rapport au monde, au sein des sociétés modernes, et les contenus journalistiques médiatisés sont des « "formes culturelles" qui s’inscrivent dans un certain état de la culture démocratique tout en contribuant à son évolution » (Muhlmann, dans Park, 2008, p. 21). Le journalisme incarne donc un moment de la praxis où la société démocratique peut se distancier d’elle-même, se représenter et se reconnaître dans la synthèse produite par la pratique des journalistes, et où les citoyens obtiennent en outre la possibilité de « faire usage de la Raison » (Kant, dans Picoche, 2011), c’est-à-dire participer d’eux-mêmes, via un ensemble de pratiques liées à la culture et aux valeurs transcendantales, à l’élaboration collective de la norme constitutive de la société, norme qui pourra éventuellement prendre la forme de nouvelles règles formelles par l’action des institutions politiques.
C’est pourquoi le journalisme peut se définir en tant que moment de réflexivité dans le processus de reproduction formel de l’ordre social où la réflexion produite est autant une image de la société renvoyée à elle-même qu’une capacité collective à se penser, se réfléchir autrement dans un « projet à réaliser » (Pichette, 2007).
Aux fondements du fonctionnement démocratique des sociétés dites modernes, c’est-à-dire de leur mode formel de reproduction,
[l]e journalisme permettait ainsi la mise en forme symbolique du conflit social : indissociable de l’idéal démocratique, il ouvrait à la parole la possibilité de construire pacifiquement, à travers le débat, une représentation différente du monde pouvant devenir moteur de transformation de la société. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que le journalisme — ni d’ailleurs le politique ou le projet éducatif moderne — a connu un âge d’or où il aurait été à la hauteur de cet idéal mais de rappeler que seule cette volonté d’instaurer une distance critique face à la réalité a permis à la pratique journalistique d’apparaître légitime dans le mouvement de constitution d’un espace public de débat. (Pichette, 2007)
Cette « distance critique », requise pour qu’il y ait réflexivité, permet de distinguer un insaisissable réel « im-média » (sans médiation symbolique) de sa représentation synthétique (construite, elle, par le détour d’un rapport aux valeurs normalisant les pratiques sociales). C’est seulement dans cet écart entre le réel et sa représentation que peut prendre place un espace voué au débat, la sphère publique. Les individus peuvent dès lors participer à la résolution politique du conflit social et en fin de compte prendre en charge leur devenir collectif. Bref, le journalisme, en tant que moment réflexif, est bien un rouage essentiel à la praxis des sociétés démocratiques.
En outre, si c’est dans la sphère publique de représentation que le débat politique sur les normes sociales est instauré, l’action de la presse permet de relier ce débat aux pratiques des institutions formelles représentatives des citoyens, chargées de codifier leur volonté (pouvoir législatif), de la mettre en pratique au niveau formel (pouvoir exécutif) et d’en assurer le respect (pouvoir judiciaire). Elle assure en même temps la pratique concrète de la liberté d’expression au sein de l’espace de débat politique, en tant que dépositaire de cette liberté au nom des citoyens (Hartley, 2007).
Le quatrième pouvoir qu’incarne la pratique journalistique s’est donc institutionnalisé de manière indépendante, dans l’interaction entre les trois « premiers » pouvoirs et les citoyens, prenant de ce fait une responsabilité sociale bien définie dans le fonctionnement politico-institutionnel de régulation des rapports sociaux propre à l’idéal de la démocratie.
Ainsi, l’institution journalistique a pour rôle de surveiller et faire rendre des comptes aux instances de régulation formelle des rapports sociaux — c’est un « chien de garde » protégeant le lien démocratique entre les valeurs partagées par l’ensemble des citoyens et la régulation formelle de leurs rapports (praxis). Il rend non seulement publiques les pratiques des acteurs sociaux, mais assure également la représentation des différents points de vue sur ces pratiques, dans le même espace alors voué à leur réconciliation préalable à toute formalisation.
Vu sous un autre angle, c’est dans cette dynamique de représentations et de débats politiques au sein de la sphère publique, liée à la presse, que s’élaborent l’opinion publique puis les normes sociales, sur la base d’une intégration socioculturelle préalable (symbolique), et que ces normes deviendront éventuellement des règles formelles imposées par l’action des institutions démocratiques (Park, 2008 [1941] ; Muhlmann, 2004) et visant à réguler les comportements individuels et les rapports sociaux. C’est le propre de la praxis des sociétés démocratiques, la manière dont la crise est continuellement dénouée, la façon qu’a la société de se reproduire — jusqu’ici.
Notons que dans cette reproduction de la socialité humaine, il y a une distinction toute kantienne entre la pratique du dire (usage de la Raison dans la sphère publique) et celle du faire (l’agir individuel) : les individus sont libres de s’exprimer dans l’élaboration des règles communes (la liberté d’expression au sujet des règles), mais doivent orienter, et orientent concrètement, leurs comportements en fonction du cadre normatif (régulation) qui en résulte, et en particulier des lois et autres règles formelles. Kant lui-même résume cet impératif du processus démocratique de régulation des rapports sociaux : « Raisonnez autant que vous voulez et sur tout ce que vous voulez, mais obéissez! » (Kant, dans Picoche, 2011).
Mode de reproduction politico-institutionnel et apport de la technique
Or, cet appel à la Raison propre à la modernité portait également les germes d’une désymbolisation du rapport au monde prenant la forme d’une promesse de progrès et d’évolution que la technique viendra nourrir. Kant avait déjà remarqué que la sphère publique pour exister concrètement requiert en effet l’action de la presse (Picoche, 2011), c’est-à-dire à la fois du journalisme et de cette technologie (d’imprimerie) qui lui est associée, technologie qu’il faut dès lors penser en tant structure de médiatisation des rapports sociaux. On remarque alors une médiation technique qui, si elle ne remplace pas directement la médiation symbolique, s’interpose dans la praxis en permettant de rendre publics les différents points de vue au sein du débat nécessaire à la reproduction de l’unité sociale.
Sous l’effet de la technique, cadrée dans un contexte d’industrialisation et de libéralisme économique, l’accès à ce qui devait être une sphère de représentations synthétiques du social et de débats sur les normes qui s’y appliquent a ainsi été graduellement soumis à des fins économiques par les entreprises de presse désireuses de financer — par la publicité — le projet journalistique lié aux valeurs libérales des Lumières. La sphère publique est ainsi devenue de plus en plus traversée de représentations d’ordre privé ayant de moins en moins vocation à participer au débat politique (Habermas, 1978 ; Miège, 1995), mais cherchant plutôt à capter l’attention et à tenter d’orienter directement les comportements (d’achat, en particulier, mais aussi en lien avec la santé, la sécurité et la paix sociale) des individus.
Notons que c’est précisément sur cette capacité à capter l’attention et à agir sur les comportements individuels que les médias traditionnels se sont fait couper l’herbe sous le pied par des technologies socionumériques structurées essentiellement en fonction de ces objectifs9. Peu axées vers la représentation collective, ces dernières ont tôt fait de récolter des données individualisées sur les comportements : cela permet en retour de personnaliser (individualiser) la communication/représentation du monde et agir directement sur les comportements individuels sans faire appel à la transcendance.
Dans le contexte de communication qui en résulte, la sphère publique a toujours en partie une vocation politique — nous ne le nions pas. Mais sa forme nouvelle et l’essentiel de l’information qui y circule (les données) semblent viser d’autres fins, « inscrivant potentiellement toute activité sociale dans un contexte de production de valeur marchande » (Casilli, 2016, p. 13), occultant le commun et la transcendance nécessaires à la praxis, et empêchant par conséquent le journalisme « d’être au service du vivre-ensemble collectif » (Martin, 2007, p. 1).
Par son appel la Raison, la modernité portait déjà en elle la possibilité de son propre dépassement (Freitag, 2002), ouvrant la voie à un nouveau mode de régulation des comportements. On constate que la technologie y a joué un rôle dès le départ et que son individuation s’est faite en ce sens (Stiegler, 1996), c’est-à-dire dans le sens d’une structure de médiatisation puis de régulation des rapports sociaux, en lieu et place de la médiation symbolique (transcendance). Il s’agit de l’émergence d’un troisième mode formel de reproduction, qui va bousculer la modernité en ses fondements.
Mode de reproduction décisionnel-opérationnel
Le troisième mode de reproduction formelle des sociétés, dans la typologie de Freitag, s’inscrit donc dans le prolongement du mode politico-institutionnel qu’il dépasse ou contourne, plutôt qu’il ne le remplace, en se présentant sous le signe de l’efficience pragmatique et optimisée, en lien avec le déploiement en réseau de nouvelles technologies — ce qui inclut au premier plan celles relevant de l’IA.
Précisons d'abord que Freitag ne conçoit pas le capitalisme d’abord en tant qu’outil de « production et d’accumulation », à la manière de Marx. Il le conçoit exclusivement comme un système inédit de régulation des rapports sociaux fondé sur une logique de contrôle.
Cette régulation, développée d’abord au sein de l’entreprise capitaliste, va chercher à étendre sa logique organisationnelle et opérationnelle à l’ensemble de la société. Il en résulte un processus de dissolution des frontières du politique et de l’économique qui plonge ses racines dans la modernité elle-même : dans son projet de reconstituer un ordre sociétal fondé entièrement sur l’« individu », et dans sa défense d’une conception totalement abstraite de la « liberté » réduite à l’idée de « libre arbitre ». (Bischoff, 2008, p. 152)
Sont alors valorisées les identités individuelles — le triomphe de l’individualisme que redoutait Tocqueville —, ou celles fondées sur les affinités ou sur une différence à affirmer, à un point tel que toute forme d’identité collective — qui serait négociée culturellement et politiquement — est désormais perçue comme un joug disciplinaire qui tente de s’imposer en opposition aux visées d’émancipation et de liberté individuelles. C’est dans ce contexte, par exemple, que même la religion devient un choix personnel, une occasion d’affirmation individuelle plutôt qu’une médiation symbolique normative de l’ensemble social. C’est cette dissolution de la transcendance qui mène à un dépassement de la modernité et de son mode de régulation.
[O]n assiste dans la transition vers la postmodernité à une dissolution progressive de l’identité politique comme identité collective dominante au profit d’une hiérarchie lâche, quoique de plus en plus médiatiquement intégrée, d’identités culturelles, elles-mêmes entendues désormais en termes de « modes de vie » et de « niveaux de vie », et faisant grand cas, idéologiquement-motivationnellement, des principes d’« affirmation de la différence », de « libre choix des affinités » et de l’irréductibilité des formes de l’expérience existentielle. Ainsi, l’identité collective tend elle aussi à fusionner avec la structure diversifiée des identités individuelles mobiles ou mobilisées, qu’elle intègre directement en elle de manière dynamique (on pourrait dire : cybernétique). (Freitag, 2002, p. 209)
La nouvelle logique qui émerge alors favorise désormais une régulation et une reproduction d’ensemble des rapports sociaux centrée non plus sur le collectif, mais sur l’individu : c’est le mode de reproduction décisionnel-opérationnel que Freitag lie à la postmodernité. Ce mode vise l’efficience, l’efficacité, les opérations utilitaires ou stratégiques et repose sur une structure de médiation technologique (dont l’Internet est une composante importante) qui en assure le fonctionnement en agissant sur les actions individuelles. Cela évoque ce que Foucault appelle la gouvernementalité10 :
Parler de gouvernementalité, c’est pour Michel Foucault souligner un changement radical dans les formes d’exercice du pouvoir par une autorité centralisée, processus qui résulte d’un processus de rationalisation et de technicisation. Cette nouvelle rationalité politique s’appuie sur deux éléments fondamentaux : une série d’appareils spécifiques de gouvernement, et un ensemble de savoirs, plus précisément de systèmes de connaissance. (Lascoumes, 2004)
C’est ici que l’apport de l’IA, en tant qu’automatisation désormais intégrée à la production des rapports sociaux, participe d’un mode de régulation dit « décisionnel-opérationnel » parce qu’il se déploie selon une logique formelle et opératoire, systémique et autorégulée (Freitag, 2002)11.
Toute décision étant désormais inscrite dans l’opérativité du « système », nous sommes alors loin du rapport au monde propre au mode formel politico-institutionnel de reproduction sociale qui misait sur des rapports symboliques transcendantaux.
Le mode de régulation décisionnel-opérationnel ne réalise donc pas l’unité sociale a priori (les finalités communes institutionnalisées) puisqu’il doit d’abord se déployer en système sur la base de sa concrétude, soit ses opérations. Il n’est pas producteur d’identité collective ni porteur de sens commun, directement ou non. Ce mode n’a « aucune préoccupation pour [les] retombées lointaines ou collectives » (Freitag, 2002, p. 43), car il procède plutôt de manière technocratique et technologique12 à « la transformation, en théorie et en pratique, des médiations culturelles et institutionnelles en information cybernétique, neutre, quantifiable et efficiente » (Fillion, 2006). L’information (les données numériques) ne circule plus désormais qu’entre les éléments d’une structure totalisante — accumulation des données à des fins d’accumulation — sans totalité (finalité « externe » ou transcendantales), mais bien selon ses propres opérations qui deviennent ainsi des fins en soi.
Le propre de ce mode de reproduction est en effet de produire de l’information au sens cybernétique du terme, de manipuler les orientations significatives dont sont porteurs les acteurs, mais d’épuiser les réserves de tradition et de court-circuiter les discours de justification et d’orientation collective. L’idéologie correspondante passe bien plus par la mobilisation immédiate que par l’argumentation et la justification. (Freitag, 2002, p. 43)
L’individualisme trouve ainsi un mode de fonctionnement qui lui correspond : libéré du « joug » de la transcendance, l’individu peut nourrir la prétention d’advenir par et pour lui-même (hyperindividualisme, Mondoux, 2011, 2018, 2021) ; son individuation repose moins sur une dimension sociopolitique que « sur des pratiques d’autoreprésentation et sur des stratégies de mise en scène du soi et de quêtes identitaires » (Mondoux, 2011, p. 197).
Ainsi l’ordre social se trouve-t-il établi non pas en tant que fruit de médiations politiques, c’est-à-dire comme la résultante du jeu des rapports entre les acteurs et entre les acteurs et leurs institutions, mais bien comme la résultante des rapports processuels de production, c’est-à-dire d’un fonctionnement en soi (ici le réseautage). (Mondoux, 2011, p. 199)
Dans cette société/économie de communication numérique, les comportements humains tendent donc à être « dérèglementés » politiquement — au nom de la liberté d’expression individuelle sur les plateformes dites « sociales » — et plutôt régulés individuellement et localement selon une logique et des dynamiques cybernétiques, c’est-à-dire une gestion rationnelle des intrants et extrants en vue d’assurer un équilibre (homéostasie). Ce mode de régulation se caractérise par des interventions algorithmiques automatisées qui agissent sur l’environnement en définissant le champ des possibles (Mondoux, 2011) ; par des sujets qui en fin de compte ne sont que des particularités d’un système à titre de producteurs de données ; et par une forme de contrôle où les attentes n’émanent pas d’un pouvoir identifiable reposant sur un socle sociopolitique commun13, mais bien sur la préséance de l’opérationnalité elle-même.
Si par le passé cette dynamique était décrite par ce qu’elle n’était plus (postmodernité), à l’instar de plusieurs nous définissons positivement ce mode de régulation désormais « algorithmisé ».
Algorithmic regulation refers to decision-making systems that regulate a domain of activity in order to manage risk or alter behaviour through continual computational generation of knowledge by systematically collecting data (in real time on a continuous basis) emitted directly from numerous dynamic components pertaining to the regulated environment in order to identify and, if necessary, automatically refine (or prompt refinement of) the system’s operations to attain a pre-specified goal. (Yeung, 2017)
Concrètement, dans le contexte d’une société, cette forme de régulation est celle d’une gouvernementalité algorithmique, c’est-à-dire :
[un] mode de gouvernement nourri essentiellement de données brutes, signaux infra-personnels et a-signifiants mais quantifiables, opérant par configuration anticipative des possibles plutôt que par règlementation des conduites, et ne s’adressant aux individus que par voie d’alertes provoquant des réflexes plutôt qu’en s’appuyant sur leurs capacités d’entendement et de volonté (Rouvroy, 2012).
Cela entraîne plusieurs conséquences, dont une crise des médiations symboliques, que ce soit la crise de la représentation (Bougnoux), la misère symbolique (Stiegler) ou la perte d’efficience symbolique (Žižek), qui se voient ainsi privées de toute référence transcendantale (« universelle ») parce qu’inévitablement accusée d’être empreinte « d’idéologisme ». C’est ainsi que les enjeux socio-institutionnels sont occultés au nom d’une pratique qui consiste justement à les « dé-institutionnaliser », c’est-à-dire à former une synthèse du social qui ne relèverait plus du débat public ou d’une réflexivité (ce qui était le mandat du journalisme), mais d’une reconstitution qui se prétend fidèle et objective (via une technique « socionumérique »14 présumée neutre) et par l’amalgame de données personnelles, plus souvent qu’autrement de nature comportementale, fournies volontairement ou non.
Alors que les précédents modes formels de reproduction sociétale étaient caractérisés par la saisie du rapport à la transcendance (la mise en commun des valeurs), c’est-à-dire par un moment réflexif (incarné en partie par le journalisme), le mode décisionnel-opérationnel associé à la gouvernementalité algorithmique exclurait ou neutraliserait de facto toute forme de praxis alors contournée et posée comme obsolète. Dès lors, plus rien n’empêche socialement, politiquement et économiquement, d’automatiser les médiations symboliques, dont celles traditionnellement réservées aux institutions, incluant le journalisme. C’est précisément ce que propose aujourd’hui l’intelligence artificielle, qu’elle soit définie en tant que champ de recherche scientifique ou en tant qu’application concrète. Il y a bien une crise : la socialité humaine est confrontée à une nouvelle forme de régulation sociale qui n’émane pas de la praxis, dans laquelle le journalisme trouvait sa raison d’être.
Mode de reproduction décisionnel-opérationnel et IA
C’est donc dans ce contexte que s’inscrit l’action de l’intelligence artificielle, mobilisée dans un nombre sans cesse croissant d’activités (santé publique, justice, défense, consommation, etc.) en tant que capacité à traiter l’énorme quantité de données (données massives) produite au sein du réseau mondial de communication numérique sur lequel elle repose, et en tant que justification de l’accroissement constant de la récolte des nouvelles données (Bader, 2016) nécessaires au fonctionnement de cette structure totalisante. Ainsi, c’est grâce à toutes les données que recueillent continuellement des objets dits « autonomes » ou « intelligents » que l’IA régule leurs comportements en fonction d’obstacles ou de situations anticipées, et ce sur la base de calculs probabilistes faits à partir d’un ensemble de données toujours de plus en plus large. La même logique de contrôle s’applique aux comportements humains que l'on souhaite anticiper grâce à leur constante communication — que ces comportements soient volontaires (consommation, etc.) ou non (problèmes de santé, etc.) :
Self-optimising AI software also works independently on analysing our behaviour on the basis of thousands of pieces of information from our web searches, online monitoring systems, cameras, sensors and more recently, heating thermostats and smoke detectors, for example. This permanent "datafication" in the form of recording and implementation of our behaviour into mathematical dimensions and machine language is being used to predict our future behaviour more and more effectively. Most important here, of course, is our behaviour as consumers, which is not only predicted on the basis of big data, but will also be programmed and initiated according to specific purchasing behaviour. (Bader, 2016, p. 5)
Située en regard de la praxis, l’apport de l’intelligence artificielle est double. D’une part, elle situe la représentation (purement numérique) des acteurs sociaux et de leurs comportements dans le dispositif « opérationnel » de la circulation elle-même (production, diffusion et consommation de données), plutôt que dans une synthèse réflexive comme celle que produit le journalisme au bénéfice de l’idéal démocratique. D’autre part, elle situe également la prise de décision (algorithmique) sur le devenir de ces comportements dans l’opération même du système, plutôt que dans un débat politique au sein d’une sphère publique (commune et faisant appel à la transcendance) que le journalisme peut relier aux institutions démocratiques.
En d’autres mots, il n’y a plus de réflexivité dans le champ du social: la représentation et la prise de décision sur les normes ne sont plus liées à la pratique du journalisme et du politique, mais sont plutôt absorbées par les opérations de la régulation elle-même (comme dans le système technicien d’Ellul). En ce sens, l’IA participe de l’émergence du mode de reproduction opérationnel-décisionnel propre à la postmodernité : son fonctionnement est pragmatique, il repose sur la circulation de l'information et vise à automatiser une réponse préemptive à des situations ou comportements anticipés.
Concrètement, l’IA requiert et produit, tout à la fois, un virage épistémique vers le tout-numérique dans tous les domaines — vers ce qu’il convient d’appeler une épistémè numérique (Stiegler 2014). Elle favorise ainsi le rabattement des rapports sociaux vers des plateformes techniques « dérèglementées » politiquement et imprègne finalement la régulation de l’activité humaine en subsumant le rôle institutionnalisé du journalisme à l’opération du « système » (Martin, 2007 ; Carignan, 2021).
C’est au sein des médias socionumériques, à proprement parler, que l’impact sur la fonction sociale du journalisme se fait la plus visible. La représentation du réel qui y est offerte aux individus, personnalisée et individualisée, les éloigne d’une praxis en les cantonnant plutôt dans l’auto-expression immédiate (hyperindividualisme), une forme de participation n’ayant pas comme vocation première le débat politique15, mais bien la circulation des informations (données) au sein du réseau. Ce « réel personnalisé » est en outre constamment reproduit par l’action de l’IA en tenant compte de la trajectoire comportementale des individus (pour retenir l’attention, motiver l’acte d’achat ou lutter contre la radicalisation, par exemple). Ainsi, les sujets n’ont plus accès aux règles de l’orientation des actions individuelles et collectives qui se trouvent hors de leur atteinte, indétectables et indiscutables puisque déjà intégrées à ce « réel personnalisé » produit par une entreprise en fonction de la trajectoire comportementale elle-même programmée et donc anticipée (contrôle).
Au final, « c’est la capacité même de délibérer réflexivement sur l’écart entre la norme et le fait qui est abolie » (Ouellet, 2017, p. 27), et c’est donc la légitimité du journalisme qui encaisse le coup, celle-ci, rappelons-le, étant justement liée à l’existence d’une « distance critique face à la réalité » (Pichette, 2007). Le journalisme est relégué à une simple source d’informations parmi toutes celles possibles dans les vastes réseaux de circulation des données où tout est admis pourvu que la circulation elle-même soit reconduite (Dean, 2009).
C’est cette logique qui régit et structure aujourd’hui les principaux lieux de distribution et de « consommation » de l’information journalistique, c’est-à-dire les tous les espaces numériques et en particulier socionumériques16 comme Facebook — « champion dans le suivi des comportements humains à des fins commerciales » (Deglise, 2020). Et désormais, c’est aussi cette logique qui s’étend à la production des informations en s'insérant dans la pratique même du journalisme au sein des salles de presse.
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil à Sophi, l’outil d’intelligence artificielle développé par le Globe and Mail et présenté comme l’une des applications les plus poussées de cette technologie dans le milieu professionnel journalistique. Sophi procède essentiellement à l’analyse des données comportementales des lecteurs afin de personnaliser l’offre de contenus en temps réel (« automated content curation ») et aider les reporters à identifier les tendances, ce qui permettrait ainsi d’augmenter à la fois le taux de clics et le nombre de nouveaux abonnés payants — focalisant davantage la pratique journalistique sur la fonction phatique de la communication. Dans les mots mêmes de ses concepteurs17, Sophi est « un système d’intelligence artificielle qui aide les éditeurs à prendre des décisions stratégiques et tactiques vitales » et qui contribuerait à résoudre la crise du sens en « transformant les données en sens » afin de déterminer « quel contenu offre une valeur réelle, en temps réel » (2021). L’IA est ici une technologie qui considère les contenus « à travers le prisme de la performance et du potentiel » et permettrait une augmentation de « 99% » de l’automatisation des choix éditoriaux du site web. Il y a là la promesse d’un véritable service clé en main ralliant les valeurs d’une société technicienne (Ellul) : efficience, pragmatisme, optimisation, rentabilité avec, à l’horizon, une dé-politisation annonciatrice d’une totalisation inquiétante.
Tout comme Michael Bader, nous nous demandons alors qui, en fin de compte, a encore la capacité de décider :
But in this model of the future, who sets the room temperature ? Who sets the goals for the planned cybernetic self-controlling systems ? Where — to put it precisely — does the common good still remain as an actual reference of social development, the yardstick for politics and democracy ? (Bader, 2016, p. 17)
Journalisme, crise et praxis
La crise du journalisme, sous cet angle d’analyse, est donc également la crise d’une société aux prises avec des changements profonds dans son mode d’existence, soit ses modalités de reproduction symbolique. Ne pas aborder cette dimension, qui inclut le rôle institutionnel du journalisme, fait courir le risque de la normalisation d’un mode de régulation sociale (la gouvernementalité algorithmique) où le politique lui-même serait occulté au profit d’un « système » dont la finalité est l’efficience de ses propres opérations (performance) ; une « dé-transcendantalisation » du rapport au monde où le commun est subsumé aux impératifs techniques (le mode décisionnel-opérationnel et le primat des opérations sur les finalités).
Cette tendance s’observe dans la montée de l’hyperindividualisme, soit la valorisation d’un sujet (« je ») dit enfin émancipé de toute forme disciplinaire (transcendance, « nous ») qui est la condition même d’une mise en commun. À son paroxysme, cette vision de la liberté individuelle conduit le sujet à être « dés-orienté » (Stiegler, 1996), comme en font foi les problématiques et enjeux sociaux liés à la personnalisation des rapports sociaux telles que la radicalisation des positions et l’émergence d’un régime de post-vérité : fausses nouvelles, désinformation, propagande, complotisme, mésinformation, etc. Dans ces dynamiques sociales, l’opinion personnelle, l’émotion et la croyance l’emportent sur une réalité comportant désormais des « faits alternatifs » légitimés au nom du libre arbitre, reléguant ainsi à l’arrière-plan ce qui était le travail traditionnel du journalisme, soit la validation des faits.
C’est ainsi que les représentations du social et de la société n’ont plus la cote. D’une part, même si admises, elles sont souvent laissées pour compte (réification de l’individu et son usage d’une technique posée comme neutre) et ainsi non mobilisées dans les analyses qui indirectement s’avouent ainsi impuissantes à problématiser « l’éclatement du social » par sa mise en mosaïque (multiplication des identités et des cultures).
D’autre part, les représentations synthétiques (globales) du social ont de plus en plus tendance à être absorbées dans des médiations d’ordre technique. Ainsi, le Big data peut être vu comme une collecte d’informations sur les sujets qui reproduit une représentation de la société où ces derniers sont dispensés de formuler leur avis explicite (praxis), comme en témoigne l’usage grandissant des dispositifs (« boussoles électorales », quizz sur les médias socionumériques, etc.) permettant de lier statistiquement18 des comportements individuels quotidiens (achats, préférences personnelles, intérêts de loisirs, historique de navigation, etc.) à des choix politiques anticipés.
À ce social dépolitisé correspond de nouvelles modalités de régulation, soit d’être techniquement « géré », contournant ainsi la dimension sociopolitique du vivre-ensemble qui oblige constamment à subir l’épreuve du politique.
Dans un tel contexte, la praxis n’a plus lieu d’être puisque le « social » devient autonome (le « système » autorégulé des sujets hyperindividualistes émancipés), contrôlable et prévisible (par séries statistiques et calculs probabilistes) et, surtout, sans avenir (horizon de possibilités refermé sur lui-même, la rétroaction et l’homéostasie reproduisant toujours au même), du moins sans autre avenir qu’un futur déjà engagé par les opérations en cours. Cette occultation de la praxis et de l’institutionnalisation affecte le journalisme et constitue en soi une crise ; une crise qui tend cependant à être neutralisée par « l’époque de la technique » en tant que « règne du sans-question, l’évidence équivoque d’une fonctionnalité parfaite » (Dubois, 2000, p. 211).
Conclusion
La crise que traverse le journalisme, conçu en tant que moment réflexif au sein des sociétés politico-institutionnelles démocratiques, s’inscrit donc dans une crise plus large liée au dépassement de ces sociétés par la postmodernité décisionnelle-opérationnelle. Cette crise sociale repose sur l’incapacité croissante des citoyens à produire leurs propres conditions d’existence par la praxis, celle-ci étant, avec le « social », subsumée à la processualité systémique dont participe l’IA. Cela mène à l’occultation du politique et à l’émergence d’une gouvernementalité algorithmique où le journalisme a de moins en moins prise.
Le danger pour le journalisme serait de ne pas développer pour lui-même et pour l’ensemble de la société une compréhension critique de l’intelligence artificielle et de la forme de gouvernementalité qui lui est associée — dans tous les domaines de l’activité humaine. Il s’agit surtout de ne pas de tomber dans le technologisme (Morozov, 2013), c’est-à-dire soit d’adopter toute technologie au prétexte qu’elle instaure une forme de progrès auquel il faut s’adapter, soit de la refuser au nom du respect des valeurs constitutives de la société. Au contraire, il s’agit de chercher une véritable sortie à la crise sociale en commençant par articuler une pensée critique permettant à la profession, voire à la société entière, une participation concrète à l’évolution de l’intelligence artificielle, pour l’amener ailleurs, c’est-à-dire vers une forme de gouvernementalité respectueuse des individus en tant que citoyens unis par une vie politique démocratique. C’est un retour vers la praxis que doit défendre le journalisme puisque c’est précisément son rôle institutionnalisé — c’est la mission que les citoyens lui ont déléguée19.
L’essence de la crise que traverse le journalisme n’est pas une difficulté à se financer20 et à produire de l’information, ni même à questionner les institutions politiques établies responsables de la production « traditionnelle » des règles et lois régulant les rapports sociaux. La crise est plus profonde et touche le cœur même de la mission journalistique, son statut de quatrième pouvoir et son rôle de « chien de garde » de la démocratie, dans le contexte actuel où ces rapports sont de plus en plus soustraits au politique et où émergent de nouvelles formes et même de nouvelles instances de régulation, algorithmiques.
La sortie de crise passe donc par une capacité renouvelée du journalisme à « instaurer une distance critique face à la réalité » (Pichette, 2007) et à trouver les moyens de surveiller et rendre concrètement responsables devant les citoyens toutes les instances de régulation formelle des rapports sociaux, fût-elles algorithmiques, en défendant constamment dans ce cas la primauté du politique sur toute autre modalité décisionnelle. Ce n'est pas une mince tâche.
En somme, dès lors que le fonctionnement politico-institutionnel cède sa place à la processualité algorithmique, il importe de se demander comment et par quels moyens le journalisme parviendra à poursuivre sa mission sociale, c’est-à-dire lier le devenir de la société à la volonté collective des citoyens réunis dans un rapport politique. Il en va de sa légitimité et de son existence institutionnelle. 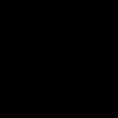
Roland-Yves Carignan est professeur invité à l’Université du Québec à Montréal,
André Mondoux est professeur à l’Université du Québec à Montréal.
Notes
1Notons que nous employons le terme « reproduction » non pas comme répétition au même, mais plutôt comme « (re)production », soit une production incessante qui n’est pas à l’identique, induisant ainsi une dynamique de devenir historique — en l’occurrence sociohistorique.
2Rappelons qu’en anglais, le mot intelligence est polysémique, désignant à la fois l’intelligence et le renseignement — pensons à la CIA, la Central Intelligence Agency. De fait, l’intelligence artificielle repose sur la collecte et l’utilisation de renseignements, de données visant autant que possible à développer une réponse préemptive à des situations ou comportements anticipés.
3La notion d’usage renvoie à une instrumentalisation individuelle, alors que celle de praxis quant à elle tient davantage aux dimensions sociales et de ce fait politiques.
4L’usager étant également une production du social, il ne saurait être considéré comme le point de départ exclusif des transformations de la société.
5« Il n’y a pas de société, que des familles et des individus », Margaret Thatcher.
6Il y a un déterminisme humain sur la technique, tout comme il y a un déterminisme technologique sur l’humain. La notion de surdéterminisme fait donc appel au primat de l’un sur l’autre.
7C’est le concept de transduction chez Simondon : une mise en rapport de deux termes qui reproduit individuellement chacun des termes dudit rapport.
8Même si cela peut ressembler à un détour, il nous apparaît important de bien décrire chacun de ces modes afin de cadrer le journalisme dans son lien avec le deuxième et les technologies numériques et l’IA avec l’émergence du troisième.
9Jaron Lanier, essayiste et chercheur en informatique américain, résume la situation dans le documentaire The Social Dilemma de Jeff Orlowski (2020). Selon lui, ce que produisent ces technologies de médiatisation numérique n’est pas fondamentalement du temps d’attention individuelle vendu à des annonceurs. « C’est le changement graduel, léger et imperceptible de vos propres comportements et perceptions qui est le produit. »
10À ne pas confondre avec gouvernance en tant que manière d’administrer et diriger les activités d'un pays, d'une région, d'un groupe social ou d'une organisation privée ou publique.
11À l’image des mouvements de la matière (atomes, planètes, systèmes solaires et galactiques).
12Pensons à « l’algorithmisation » des rapports sociaux: numérisation, quantification, automatisation, toutes choses qui nous amènent à considérer l’IA.
13C’est ainsi que Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, propose de gérer la radicalisation et d’aider à maintenir la cohésion sociale, par exemple, en structurant grâce à l’intelligence artificielle le fil d’actualité personnalisé des usagers sur la base de comportements individuels antérieurs et dans l’anticipation de ceux à venir : « We can design these experiences not for passive consumption but for strengthening social connections. ». (Zuckerberg, 2017)
14Le terme s’applique ici à l’ensemble des technologies fonctionnant sur la base d‘une numérisation du social, incluant celles relevant de l'IA. Nous ne faisons pas spécifiquement référence, ici, à la technologie des médias socionumériques.
15Ce qui ne signifie pas que les algorithmes ne puissent être utilisées pour tenter d’influencer le comportement d’électeurs, comme ce fut le cas lors des élections américaines de 2016 — montrant que le politique continue pourtant d’exister, mais en extériorité au système technique où s’exerce une influence.
16Selon un sondage du Pew Research Center (2020), 86 % des Américains s’informent sur des appareils numériques. La situation est semblable au Canada, où 52 % de la population s’informerait principalement en ligne, selon un sondage fait pour le Centre d’études sur les médias (2021).
17« From automated content curation to predictive analytics and paywalls, Sophi is an artificial intelligence system that helps publishers make vital strategic and tactical decisions to transform their business. » « These cutting edge tools allow you to see your content through the lens of performance and potential, as defined by your own measures of success. »
18Rappelons qu’un corollaire n’est pas en soi une causalité.
19Ce qui pose la question : comment les journalistes peuvent-ils développer une pensée critique de l’IA si ce qu’on leur demande est d’en adopter les outils ?
20Mentionnons cependant que le journalisme défend son indépendance (financière et autre) face aux instances de régulation des rapports sociaux que sont les gouvernements : il doit désormais adopter la même attitude dans son rapport aux entreprises régulant les rapports socionumériques — au premier plan desquelles figurent les GAFAM qui se mêlent de plus en plus du financement du journalisme et de travaux de recherche universitaire. Cet aspect mérite aussi réflexion.
Références
Association des médias écrits communautaires du Québec (2021). L’intelligence artificielle et le futur du journalisme. [En ligne] amecq.ca, 28.08.2021.
Bader, Michael (2016). « Reign of the algorithms: how artificial intelligence is threatening our freedom », 12 mai 2016. [En ligne] gfe-media.de, 05.09.2021.
Benson, Rodney (2018). « Le journalisme à but non lucratif aux États-Unis : Un secteur sous la double contrainte de la "viabilité" et de "l’impact" », Savoir/Agir, 46, 89-96.
Bischoff, Manfred (2008). « Une brève présentation de la sociologie dialectique de Michel Freitag », Économie et Solidarités, 39(2), 46–153.
Bonny, Yves (2002). « Introduction : Michel Freitag ou la sociologie dans le monde », dans L’oubli de la société : Pour une théorie critique de la postmodernité. Presses universitaires de Rennes.
Bougnoux, Daniel (2006). La crise de la représentation. La Découverte.
Carignan, Roland-Yves (2021). « Le journalisme et la représentation des rapports sociaux numériques », mémoire de maitrise, Université du Québec à Montréal.
Casanova, Béatrice (1996). « L’influence de la télévision sur les pratiques journalistiques ». Les Cahiers du journalisme, 7, 160-167.
Casilli, Antonio (2016). « Réinterroger les sciences sociales à l’heure du numérique. Sociabilité, vie privée et digital labor », discours liminaire du XXe congrès international des sociologues de langue française, AISLF, Montréal, Québec.
Charon, Jean-Marie (1992). « Journalisme : l’éclatement », Réseaux, 52, 97-114.
Dean, Jodi (2009). Democracy and other neoliberal fantasies. Duke University Press.
Deglise, Fabien (2020). Coronavirus: Le projet d’application de recherche de contacts de Mila crée tout un émoi. Le Devoir. 02.06.2020.
Dubois, Christian (2000). Heidegger. Introduction à une lecture. Seuil.
Ellul, Jacques (1954). La Technique ou l’enjeu du siècle. Armand Colin.
Filion, Jean-François (2006). Sociologie dialectique : introduction à l’œuvre de Michel Freitag. Nota bene.
Freitag, Michel (1986a). Dialectique et Société, Vol. 1. Introduction à une théorie générale du symbolique. Saint-Martin et L’Âge d’Homme.
Freitag, Michel (1986b). Dialectique et Société Vol. 2. Culture, pouvoir et contrôle : les modes de reproduction formels de la société. Saint-Martin et L’Âge d’Homme.
Freitag, Michel (1998). Le naufrage de l’université : Et autres essais d’épistémologie politique. Nota bene.
Freitag, Michel (2002). L’oubli de la société : Pour une théorie critique de la postmodernité. Presses universitaires de Rennes.
Guchet, Xavier (2010). Pour un humanisme technologique : Culture, technique et société dans la philosophie de Gilbert Simondon. Presses Universitaires de France.
Habermas, Jürgen (1978). L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société. Payot.
Hartley, John (2007). « Journalism as a human right : the cultural approach to journalism », dans Global Journalism Research Theories, Methods, Findings, Future. Peter Lang Publishers, 39-51.
Heidegger, Martin (1958). « La question de la technique », dans Essais et conférences. Gallimard.
Latar, Norman (2018). Robot journalism : can human journalism survive ? World Scientific.
Le Cam, Florence, et Ruellan, Denis (2014). Changements et permanences du journalisme. L’Harmattan.
Le Cun, Yann, Bengio, Yoshua, et Hinton, Geoffrey (2021). « Deep learning », Nature, 521(7553), 2015, p. 436-444.
Lefebvre, Henri (1965). Métaphilosophie. Éditions de Minuit.
Martin, Éric (2007). « Le journalisme et la désymbolisation du monde. Pour une critique dialectique de la crise contemporaine du Journalisme », mémoire de maitrise, Université du Québec à Montréal.
Mattelart, Tristan (2020). « Comprendre la stratégie de Facebook à l’égard des médias d’information », Sur le journalisme, 9(1), 24-43.
Miège, Bernard (1995). La pensée communicationnelle. Presses Universitaires de Grenoble.
Mondoux, André (2011). Histoire sociale des technologies numériques : de 1945 à nos jours. Nota Bene.
Mondoux, André (2018). « Internet des objets : épistémologie d’une démocratie sans société » dans Mondoux, André et Ménard, Marc (dir.), Big data et société. Industrialisation des médiations symboliques. Presses de l’Université du Québec.
Mondoux, André, et Ménard, Marc (dir.) (2018). Big data et société : Industrialisation des médiations symboliques. Presses de l’Université du Québec.
Mondoux, André, Ménard, Marc et al. (2022). Gouvernementalité algorithmique et le politique, dans Gouverner par la donnée. ENS, France. (À paraitre).
Morozov, Evgeny (2013). To Save Everything, Click Here : the Folly of Technological Solutionism. PublicAffairs.
Muhlmann, Géraldine (2004). Une histoire politique du journalisme XIXe – XXe siècle. Éditions Points, Presses universitaires de France.
Nobre-Correia, José-Manuel (2006). « Journalisme : une certaine mort annoncée… », Communication & Langages, 147, 15-24.
Ouellet, Maxime (2017). « L’empire de la communication », Liberté, 318, 25-27.
Pageau-St-Hilaire, Antoine (1998). « Qu’est-ce qu’être humain ? Heidegger et Arendt autour de la praxis aristotélicienne », Philosophiques, 45(1), 109-142.
Park, Robert. E. (2008 [1941]). Le journaliste et le sociologue Robert E. Park : textes présentés et commentés par Géraldine Muhlmann et Edwy Plenel. Seuil.
Pichette, Jean (2007). « Penser le journalisme dans un monde en crise », À babord, 18. [En ligne] ababord.org, 04.09.2021.
Pickard, Victor (2020). « Restructuring democratic infrastructures : a policy approach to the journalism crisis », Digital Journalism, 8(6), 704-719.
Picoche, Nolwenn (2011). « La construction du lien social par la presse », Implications philosophiques. [En ligne] implications-philosophiques.org, 04.09.2021.
Pineault, Éric (1999). « Sociétés, monnaie et politique : éléments pour une théorie de l’institution monétaire et une typologie des formes historiques de sa régulation politique », Cahiers de recherche sociologique, 32, 47–83.
Rouvroy, Antoinette (2012). « Mise en (n)ombres de la vie même : face à la gouvernementalité algorithmique, repenser le sujet comme puissance », Mediapart. [En ligne] blogs.mediapart.fr, 06.09.2021.
Simondon, Gilbert (1989). Du mode d'existence des objets techniques. Aubier [Méot, 1958].
Simondon, Gilbert (1964). L'individu et sa genèse physico-biologique (l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information). PUF.
Simondon, Gilbert (2007). L'individuation psychique et collective. Aubier.
Sophi (2021). Sophi – Analytics [En ligne] sophi.io, 29.08.2021.
Stiegler, Bernard (1996). Technique et le temps (désorientation). Galilée.
Stiegler, Bernard (2004). De la misère symbolique. Galilée.
Stiegler, Bernard (2006). Mécréance et discrédit 2. Les sociétés incontrôlables d’individus désaffectés. Galilée.
Stiegler, Bernard (2014). « Pharmacologie de l’épistémè numérique » dans Stiegler, B. (dir.) Digital studies. Organologie des savoirs et technologies de la connaissance, Limoges, 13-26.
Stiegler, Bernard (s.d.). « Individuation ». Ars industrialis. [En ligne] arsindustrialis.org.
Weber, Max (1959). Le savant et le politique. Plon.
Yeung, Karen (2017). « Algorithmic regulation : a critical interrogation », Regulation & Governance, King’s College London Law School Research Paper 2017 (27). [En ligne] ssrn.com, 04.09.2021.
Zeh, Juli, et Trojanow, Ilija (2010). Atteinte à la liberté : les dérives de l’obsession sécuritaire. Actes Sud.
Référence de publication (ISO 690) : CARIGNAN, Roland-Yves, et MONDOUX, André. Technique et crise : l'impact de l'intelligence artificielle sur les dimensions sociopolitiques du journalisme. Les Cahiers du journalisme - Recherches, 2021, vol. 2, n°7, p. R91-R110.
DOI:10.31188/CaJsm.2(7).2021.R091






